Le temps sacré des cavernes de Gwenn Rigal
Aux éditions Corti
Fiche de lecture publiée le 30 août 2018

En ce début d’août, la visite à Lascaux II, le premier fac-similé de la grotte ouvert en 1983, partait mal. Celle que je croyais être notre guide parlait trop. A un parent inquiet de savoir si ses jeunes enfants se comporteraient bien pendant la visite, elle répondait : » ils se comporteront bien car je sais passionner les enfants ». Pourquoi mes enfants hurlent-ils et pourquoi mes élèves bavardent-ils dans ce cas ? Est-ce parce que moi je suis trop nulle pour passionner quiconque ? Le premier contact était crispant…
Mais non, notre groupe partait une demi-heure plus tard avec pour guide un immense bonhomme à poils roux qu’on avait aussitôt envie de suivre. Passionnant sans avoir besoin de le dire, il donnait à cette visite l’impression qu’elle était trop courte. J’en étais à me demander s’il fallait ou non lui donner un pourboire, quand il a parlé de son livre. Mieux valait acheter son bouquin que lui glisser une pièce, geste dont je ne sais jamais s’il est bienvenu ou condescendant.
Ma lecture fut lacunaire : celle d’une mère qui ne lit que d’un oeil pour surveiller ses gosses dans la journée, et qui ferme carrément ses deux yeux ou bout de trois pages le soir quand elle ne les surveille plus. Et pourtant, ce livre est assez clair et intéressant pour que j’en sorte enrichie, curieuse de m’intéresser plus avant à ce sujet, et désireuse de visiter d’autres sites préhistoriques.
Je le relirai, mais déjà j’en retiens les richesses entrevues d’hommes des cavernes qui ne grognaient pas, qui ne manquaient pas forcément de tout (en dehors de la roue et du téléphone portable peut-être), qui avaient des savoir-faire qu’ils savaient transmettre, une culture peut-être religieuse qu’ils partageaient et pouvaient mettre en scène, des enfants comme les miens dont certains ont laissé l’empreinte émouvante de leur petites mains dans les grottes.
Gwenn Rigal montre du respect pour l’intelligence de son lecteur sans chercher à l’écraser par la supériorité de ses connaissances. Sans élitisme obscur ni méprisant, sans codifications sectaires réservées aux universitaires, sans entre soi savant. Sans non plus de simplifications réductrices, ni de vulgarisation trop poussée qui vide le propos de la majeur partie du contenu scientifique.
Gwenn Rigal ne défend pas sa thèse et ne montre pas sa poire. Celui qui fut peut-être un amateur passionné devenu guide chevronné, ne se présente pas comme chercheur. Il réussit par contre le difficile exercice de rendre compte de la Science. C’est à dire aussi bien des découvertes que des lacunes, des controverses, et de ce qui est peut-être perdu pour toujours.

Au lecteur de choisir, s’il le souhaite, parmi les interprétations présentées celle qui le convaincra le plus, tout en sachant qu’elle peut être partiellement ou totalement fausse. Celle qui m’a le plus séduite est celle des grottes servant de passage entre le monde naturel extérieur et un monde surnaturel au centre de la Terre d’où serait née la Vie. Parce qu’elle est belle. Parce qu’un instant j’ai eu la vision magnifique du bestiaire de Lascaux prenant vie et se mouvant sur les parois pour effectuer son voyage entre les ténèbres et la lumière.
Je suis sortie de ce livre en sachant qu’on ne sait pas (tout), mais la vie de notre prédécesseur sapiens m’est devenue plus importante et plus proche. Est-ce ce que voulait nous dire l’artiste visionnaire qui a façonné pour le préhistoparc de Tursac ouvert en 1984 à quelques kilomètres de Lascaux, cet homme de Cro-Magnon si semblable à nos contemporains dans le métro ?
Mère disparue de Joyce Carol Oates
Aux éditions Philippe Rey 2007 pour la traduction française
Fiche de lecture publié le 24 décembre 2018
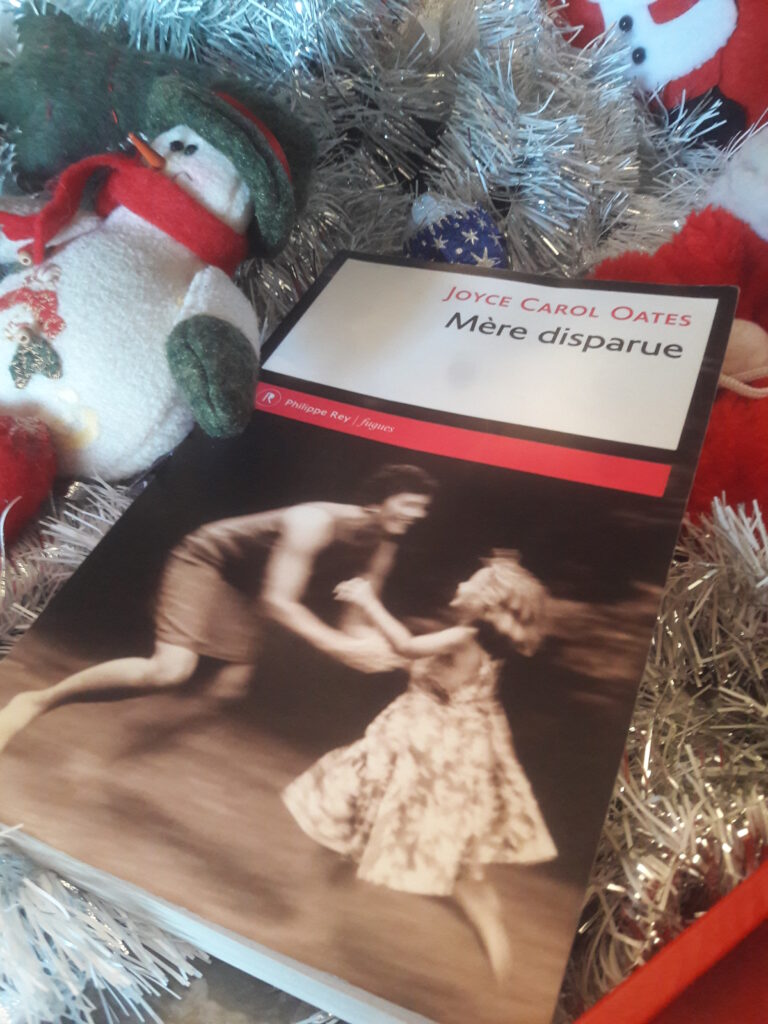
Adolescente je lisais beaucoup, à plat ventre sur la moquette de ma chambre, un gros chat couché sur mes fesses. J’allais dans les librairies, historiques, petites, élitistes, du Centre Ville. J’y étais à mon aise. J’y allais tant par plaisir réel que parce que par là passait la construction de mon image.
Et puis ma vie de lectrice a connu deux éclipses.
La première en classe préparatoire scientifique. A vingt ans, brisée par le travail éprouvant et par des résultats humiliants, j’ai cessé de lire. Ma rééducation au livre fut longue, mais réussie. Je retournais dans les librairies.
La deuxième quand je devenais mère pour la première fois, à trente et un ans. Je décidais de profiter des tétées de trois quarts d’heure toutes les trois heures pour lire en intégralité et dans l’ordre Les Rougon-Macquart. Tout alla bien pendant quelques mois, jusqu’à l’éveil de la conscience du bébé téteur, qui jaloux de Zola, tendait le bras sans cesser de pomper son lait pour arracher une à une les pages du livre : « sois toute à moi ». J’ai abandonné le Docteur Pascal et les librairies.
C’est ainsi que huit ans plus tard je me suis retrouvée, étrangère et désemparée, dans l’une de mes librairies, historique, petite, élitiste, du Centre Ville de mon adolescence.
Incapable de revenir au passé, répugnant de replonger dans mes lectures classiques d’antan, celles que je choisissais toujours de langue française et antérieures à Proust, j’ai été attirée par un livre de Joyce Carol Oates, écrivaine américaine contemporaine : Mère disparue.
Submergée comme je l’étais par la maternité, ce choix me faisait l’effet d’être indécent. Trop de mères, ras le bol. Etait-ce le mot « disparue » qui m’attirait ? Quand je l’ai acheté, sans lire la quatrième de couverture, je n’avais même pas compris que « disparue » signifiait « morte ».
Ce livre est resté encore un an sur mes étagères.
Et puis je l’ai ouvert, et je l’ai lu, pleine d’appréhension. Et je l’ai relu, avec admiration.
Nikki Eaton est une journaliste un peu punk rebelle zarrebi de 31 ans. Sa mère meurt assassinée.
Un polar ? Une enquête haletante ? Non pas. L’assassin est retrouvé au bout de quelques pages et n’a que peu d’intérêt. Rien ne se passa comme à la télé ou comme dans les films dit Joyce Carol Oates. « Rien de poétique, ni rien de très mystérieux ».
Nikki Eaton, la branchée non mariée est un peu agacée par sa mère – vivante et sûrement éternelle – une femme au foyer, veuve et ordinaire qui fait du pain. Peu préparée à sa perte brutale, Nikki, s’effondre et s’installe dans la maison familiale sous le prétexte de la vider pour la vendre. Page après page, suivant le programme annoté sur un calendrier par la morte, elle se glisse dans les habitudes quotidiennes de sa mère disparue.
Va-t-on découvrir une schizophrénie chez la fille et une double vie chez la mère ? Non pas. La mère n’était pas agent secret et n’avait pas d’amants. Nikki n’empaille pas sa mère ni ne met en scène son cadavre dans la chambre à coucher. Nikki cohabite avec le vieux chat qui a survécu à sa maîtresse, met des pulls faits main et apprend à faire du pain.
A la dernière page de ce roman qui dure un an, Nicole Eaton sortira plus forte et moins pétée de sa quête entre vieilles tantes et croquettes pour chat.
Il ne fallait pas que je raconte la fin ? Connaître la fin ne change rien. Pas plus que connaître le nom du meurtrier, un raté sans intérêt. Ce qui compte c’est le récit de la découverte post-mortem d’une mère par sa fille, au travers des objets, des amis, des témoignages et du quotidien. Une vie sans clandestinité ni sensationnel, une vie de femme sans drame apparent ni prestige qui avait pourtant une vie propre et que sa fille ne connaissait que mère.
Lectrice de ce récit sans tapage, j’ai tour à tour été Nikki la rebelle branchée, Clare sa sœur bourgeoise admirée rangée et frustrée, et leur mère cuisinière et tricoteuse au foyer. Et j’ai eu envie de faire du pain.
Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas
Aux éditions de l’Olivier 2010
Fiche de lecture publiée le 19 avril 2019
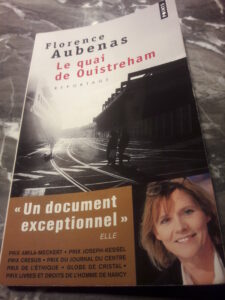
Florence Aubenas, grand reporter, journaliste à Libération puis au Monde est connue – entre autres – pour avoir été enlevée à Bagdad en 2005 et retenue cinq mois en otage. J’écris ça en lisant Wikipédia sur une autre fenêtre de mon ordinateur car j’ai la fâcheuse tendance à ne pas me souvenir de tous les événements d’importance et connus de tous dont il faudrait se souvenir.
Pour moi elle est l’auteur d’un livre que j’ai dévoré deux fois avec le même intérêt et le même plaisir : Le quai de Ouistreham.
Peut-on parler de plaisir quand il s’agit de la lecture d’un livre dont le sujet est la recherche presque désespérée d’un travail, non pas sur le haut du panier, mais dans « le fond de la casserole » des chômeurs de Pôle Emploi ? Oui. Ni docte, ni condescendant, ni angéliste, ni misérabiliste, le ton est simple, enlevé, drôle. Aucune description grandiloquente, aucune théorie, mais des anecdotes et des personnages qui passent devant le petit bout de la lorgnette et qui font voir grand un monde qu’on ne connaît pas. Que je ne connais pas. Je le vois chaque jour dans la rue ou au supermarché, mais je ne le vis pas.
En 2009 Florence Aubenas a tout lâché pour aller s’installer à Caen . Elle a loué une petite chambre, elle a gardé son nom mais elle a caché son métier de journaliste et s’est inventé un ex-conjoint garagiste qui l’aurait entretenue pendant une vingtaine d’années mais dont elle serait récemment séparée, ce qui la contraindrait à travailler.
Voici donc une héroïne de 48 ans, sans diplôme autre qu’un bac littéraire, sans expérience professionnelle, battant le pavé et les agences de Pôle Emploi d’une ville inconnue. Elle est « le fond de la casserole » : un cas désespéré.
D’anecdote en anecdote, d’agence d’intérim en stages de Pôle Emploi, on découvre la CRISE. La peur d’être radié ou mal vu. Les stages d’une journée pour laver par terre ou faire un CV. Les salons de l’emploi qui n’ont pas d’annonces d’embauche à proposer. Les conseillers de Pôles Emploi pris en sandwich entre la crainte d’être licenciés à leur tour et celle d’être trucidés par un chômeur longue durée en pleine crise de démence et de désespoir.
On découvre la « carrière » de femme de ménage et les sacrifices à faire pour se voir confier de plus en plus d’heures par les employeurs. On découvre la course aux contrats de deux heures sur deux jours. On découvre qu’une heure de ménage payée est parfois à une heure de route. On découvre qu’un travail de 3h15 payé 3h15 se fait en 6 heures. On découvre les horaires découpés, les contrats et les patrons multiples d’une seule journée, sur plusieurs villes. On découvre la perte de la notion du temps et du sommeil quand on rentre d’un ménage à 23h30 pour se lever et marcher vers un autre lessivage à 4h30. On découvre la précarité des contrats courts de quelques jours soumis aux maladies d’une vieille voiture en fin de vie.
On découvre que le métier de caissière fait rêver.
On s’attache aux personnages : des « vrais » gens dont les noms ont été changé. Il y a bien quelques rivalités et mesquineries, mais on y voit beaucoup plus encore la solidarité pour dénicher une voiture, ou pour partager un repas, des biscuits et quelques histoires de vie : des récits d’un temps meilleur d’avant la crise et des rêves d’avenir dans lesquels la possession d’un camion pizzas ou un agrément d’assistante maternelle sont des châteaux en Espagne.
On apprend pourquoi le supermarché et la jardinerie un dimanche peuvent être une promenade en famille ou entre amis. Avant je ne comprenais pas ces couples glissant dans les rayons aux heures de pointe leurs caddies pleins d’enfants.
Florence Aubenas écrit qu’elle s’attendait à trouver des emplois pénibles et mal payés, mais pas à ne rien trouver. Son premier contrat, présenté comme le pire qu’elle pouvait trouver, a été le ménage du ferry de Ouistreham. Une vacation en forme de course contre la montre d’une heure par jour de 21h30 à 22h30, six jours par semaine, soit 250€ par mois et l’essence à payer entre Caen et Ouistreham. Le pied à l’étrier et le début d’une quête épuisante pour décrocher enfin un CDI au bout de six mois. Ce but atteint marque la fin de l’expérience et du livre.
Touriste d’un jour sur la plage de Riva-bella à Ouistreham, j’ai vu le ferry décharger voitures et passagers, puis reprendre la mer. Sa courte escale a duré le temps d’un goûter et d’un château de sable. A bord pendant ce temps, une équipe de femmes de ménage.
Hommage à la Catalogne de George Orwell
Aux éditions 10/18, 1938 pour la première édition
Fiche de lecture publiée le 24 mai 2019
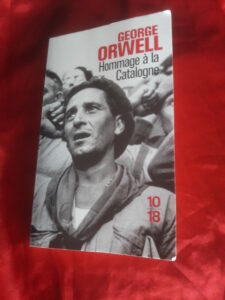
De George Orwell je ne connaissais que 1984, une lecture scolaire, adolescente, marquante. J’y pense chaque fois que je clique sur OK pour accepter des « cookies » sur mon ordinateur, sans savoir trop ce que ce geste implique, sans savoir si Big Brother vit déjà dans la mémoire de mon ordinateur, sans autre volonté immédiate que celle d’ouvrir la page que j’ai demandée, et qui, peut-être, ne m’intéressera pas.
Dans la ville où je travaille, il y a une librairie magnifique, qui présente une importante littérature « de gauche », peut-être autant pour des raisons idéologiques que pour des raisons commerciales dans ce qui reste l’une des rares banlieues rouges. J’y ai régulièrement découvert, fait rare vu dans nulle autre librairie, étalés sur une table ronde à l’entrée de la boutique, des ouvrages sur la guerre d’Espagne.
Ce fut le cas de ce livre, Hommage à la Catalogne de George Orwell, achevé en 1938 alors que l’issue de la guerre d’Espagne était encore incertaine.
Quand on se trimballe un nom comme le mien, c’est qu’on a quelque part un lien avec la guerre d’Espagne. Cette guerre civile a donc fait partie très tôt de mon paysage enfantin, nourrissant ma légende familiale. Mes enfants eux-mêmes savent que leur naissance n’est pas étrangère aux mouvements de populations de certaines guerres, d’Espagne ou d’Algérie.
Dans la légende de mes jeunes années, il y avait les gentils dont faisait partie mon grand-père, républicain anarchiste aragonais obligé de fuir en 1938 son pays pour se réfugier en France, et il y avait les méchants, les fascistes, menés par le général Franco. On m’avait expliqué que les méchants avaient momentanément gagné, plongeant l’Espagne dans la dictature et séparant pour longtemps les membres de ma famille, jusqu’à une fin – en toute justice – heureuse en forme de retrouvailles du clan familial. J’aime cette histoire et je la transmettrai.
En 1936, George Orwell âgé de 33 ans, s’est engagé dans la guerre d’Espagne pour combattre, aux côtés des républicains (les gentils), les fascistes (les méchants). Pourquoi j’insiste sur cette vision manichéenne de la guerre d’Espagne ? Parce qu’elle fut celle de mon enfance, et qu’elle fut celle aussi d’un George Orwell idéaliste s’engageant – par l’intermédiaire du Parti travailliste indépendant (I.L.P.) anglais – avec les milices étrangères aux côtés des Espagnols de gauche.
La première moitié de l’Hommage à la Catalogne décrit de l’intérieur le front d’Aragon sur lequel a combattu Orwell avec les milices du P.O.U.M. (parti ouvrier d’unification marxiste de Catalogne). C’est une description crue et vivante d’une guerre de tranchées, dans laquelle les combattants ont parfois quinze ans, dans laquelle les armes manquent ou sont défectueuses, dans laquelle l’ennui semble plus présent que le danger malgré la boue, les poux, les rats et les balles – parfois perdues – qui semblent tuer au hasard. Orwell finira par prendre une balle dans la gorge et, miraculeusement, en réchappera. Et c’est un hommage au courage de ces hommes tenant le front, sans expérience ni matériel, par leur foi en une politique nouvelle, appliquant dans leur microcosme boueux l’abolition des différences sociales et l’égalité dans une milice sans grades, sans chefs, sans ordres.
C’est en mai 1937, à l’occasion d’une permission à Barcelone, qu’Orwell va voir la légende des gentils et des méchants se fendiller. Le camp des gentils va exploser en une bataille de rues suivie de conflits politiques féroces entre les « trotskystes » (membres du P.O.U.M. et de la C.N.T. le syndicat anarchiste) d’une part et les communistes staliniens d’autre part. Georges Orwell se retrouve malgré lui embarqué dans ce conflit qui semble absurde entre républicains, alors que sur le front d’Aragon les miliciens de la République, scandaleusement bien moins armés que la police communiste de Barcelone, contiennent les troupes franquistes.
Pour conclusion de cette bataille et d’une campagne de propagande des communistes staliniens, le P.O.U.M. sera accusé de fascisme par ses anciens alliés et déclaré illégal. Ses membres, ainsi que les miliciens étrangers ayant combattu à ses côtés, seront arrêtés, entassés arbitrairement dans des prisons de fortune, et pour certains fusillés.
Le livre se conclut sur la purge des combattants du P.O.U.M. et de ses milices. Sur la fuite vers la France de George Orwell et de sa femme, traqués par les staliniens. Et sur la mort révoltante de combattants espagnols et de miliciens idéalistes – anglais, belges, américains… – fusillés comme traîtres fascistes ou oubliés à mort dans des prisons alors qu’ils avaient volontairement combattu Franco sur le front d’Aragon.
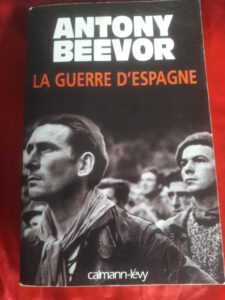
Un grand livre.
Un autre livre magnifique et très complet sur ce sujet, un livre d’historien : La guerre d’Espagne de Antony Beevor aux éditions Calmann-Lévy.
Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie
Aux éditions Gallimard 2014
Fiche de lecture publiée le 31 mai 2019
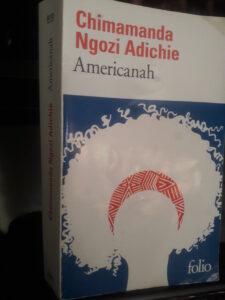
Pour mes quarante ans mes amis m’ont offert des livres.
Tous, passant la porte de mon appartement, ont mis dans mes mains un paquet parallélépipédique : un livre qu’ils aimaient et qu’en raison de nos affinités de goûts et de vies, j’allais aimer aussi.
Ces cadeaux furent précieux.
Il m’arrive de lire et d’oublier mais je n’oublierai pas ma lecture d’un épais roman turc* dans lequel la vie d’un marchand ambulant de yaourt se déroule, envoûtante, et s’étire lentement, densément, comme un gros chat enivrant dont le corps chaud, massif, occupe, petit à petit, tout le lit et mon esprit.
Et comment oublier le livre le plus gonflé qu’on puisse offrir en cadeau d’anniversaire : celui d’un psychanalyste** se proposant de soulager les angoisses face à la mort de ses patients et de ses lecteurs vieillissants ?
Un des paquets parallélépipédiques enveloppé de papier coloré était Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie. Je crois bien que c’est par Americanah que j’ai commencé la lecture de mes cadeaux.
De l’Afrique je ne connais rien. Des ethnies encore moins.
A 24 ans quand j’ai pris mon premier poste de prof en Seine-Saint-Denis, je m’étonnais que mes élèves de type maghrébin soient de la même famille que mes élèves à la peau franchement noire. Il y a donc beaucoup de métissage, pensais-je ? C’était une constatation rassurante pour qui craint le communautarisme, mais aussi une pensée inquiétante de se dire que dans cette banlieue, tous étaient « cousins », ce qui supposait une pratique sans doute dangereuse des mariages consanguins. Il m’a fallu quelques mois pour comprendre que mes élèves pouvaient s’interpeller « eh ! cousin ! » à longueur de journée, sans avoir dans leur arbre le plus petit degré de cousinage.
Plus tard, plus expérimentée, j’ai assisté à un conseil de discipline en tant que représentante élue du personnel. Incrédule, la bouche clause pour éviter de dire une connerie, j’ai écouté l’argumentation défensive d’un élève – noir – qui avait insulté une prof – noire – sous prétexte que celle-ci avait tenu à son encontre des propos racistes. N’étaient-ils pas NOIRS tous les deux ? Ce jour-là j’ai compris des choses et mon univers ethnocentré s’est un peu élargi.
Et puis mon univers a attendu Chimamanda Ngozi Adichie pour s’ouvrir un peu plus. Accrochée, j’ai lu ce livre chez moi, dans le bus, dans le métro, au lycée en mangeant, dans la rue en marchant, et quand je levais les yeux sur les passants, possédée par l’histoire, je ne savais plus si les visages que je croisais étaient du livre ou de ma réalité.
Dans Americanah, Ifemelu est une jeune femme nigériane qui est amoureuse d’Obinze. Obinze est un jeune homme fasciné par les États-Unis qui est amoureux d’Ifemelu. Lycéens puis étudiants, ils doivent quitter leur pays dans lequel les universités sont presque toujours en grève s’ils veulent suivre sérieusement des études et réaliser leurs ambitions. Ifemelu part aux États-Unis avec un visa étudiant. Obinze part en Angleterre en clandestin. Honteuse après avoir subi l’agression sexuelle d’un faux employeur pervers, Ifemelu n’ose plus répondre à Obinze. Ils se perdent. Ifemelu reste treize ans aux Etats-Unis et rencontre deux autres hommes. Elle trouve du travail, écrit un blog à succès ayant pour thème « la race » aux Etats-Unis, obtient une bourse pour étudier à Princeton. Elle réussit. Obinze, renvoyé au Nigeria, finit, après une période difficile, par faire fortune dans les affaires immobilières. Il se marie. Il a un enfant. Et puis l’Americanah, Ifemelu, en mal du pays, rentre au Nigeria. Et Obinze se rend compte qu’il aime toujours Ifemelu. Ils se retrouvent.
Une histoire d’amour qui finit bien, et l’occasion de parler du contexte politique au Nigéria, des militaires, de la culture, de la littérature, de la religion, des cheveux tressés, de la société américaine, des noirs américains, des noirs africains, des latinos, de la difficulté de trouver un emploi, de l’immigration, de l’intégration, des clichés, de la clandestinité, d’Obama, du mépris, de la condescendance, de la violence, des relations, du copinage, du cousinage, des affaires douteuses, de la corruption, du snobisme, de l’ambition, de la famille. Tout un monde vu par une femme nigériane. La langue et le propos sont magnifiques.

Un autre livre extraordinaire de la même auteur (pardon, je n’aime pas le mot « autrice ») : L’autre moitié du soleil, sur la guerre du Biafra, guerre civile au Nigéria entre 1967 et 1970.
Montrez-moi vos mains de Alexandre Tharaud
Aux éditions du Seuil 2018 (2017 pour l’édition orginale)
Fiche de lecture publiée le 16 juin 2019
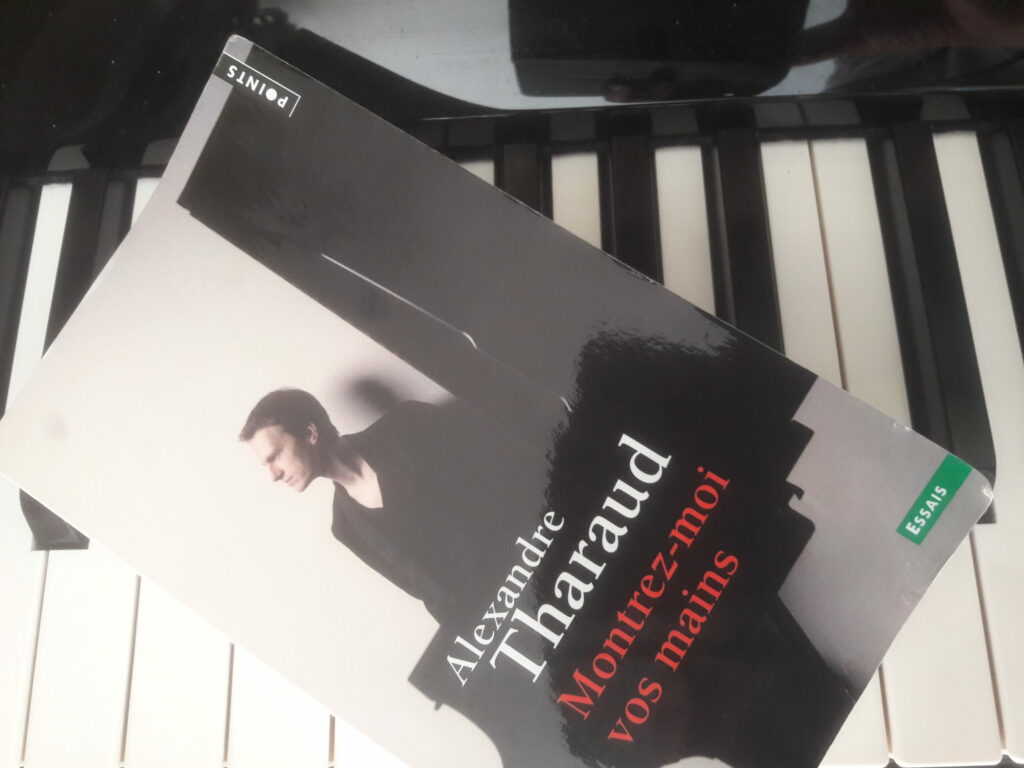
Il m’arrive de choisir un livre parmi ceux qui s’empilent, non lus sur mes étagères, pour son petit format. C’est l’occasion d’un long trajet en métro ou d’une attente chez le médecin qui va le sortir de la pile, lui donner la priorité sur tous les autres bouquins remis à plus tard. Il rentre parfaitement dans mon sac, ou dans ma poche, il est facile à tenir d’une main.
C’est le cas de l’essai d’Alexandre Tharaud : Montrez moi vos mains. Pas même deux cents pages écrites pas trop petit. On me l’a prêté. Je n’avais pas trop envie de le lire, mais je l’ai glissé dans mon jean et je suis sortie.
Je redoute les discours savants sur la musique. Je ne m’y retrouve pas, et même si la musique a beaucoup d’importance pour moi puisque je pratique, bien imparfaitement mais presque quotidiennement, deux instruments, j’avoue que j’ai arrêté de m’intéresser à des questions aussi cruciales que celle de savoir si des croches doivent être liées, piquées ou lourées dans telle mesure de tel morceau. Je m’apprêtais donc à me faire chier grave à la lecture de ce petit opus dont la couverture, jouant sur le noir de l’habit et le noir du piano, n’invitait pas particulièrement à rire.
Aucun ennui pourtant. Je dirais que cette lecture m’a extraite de la réalité dans laquelle je lisais. Peut-être étais-je bercée par le tangage du métro ? Ce livre est un voyage à travers le monde, d’une scène à l’autre. Je l’ai lu, prise par le roulis des bus et des rails, sillonnant Paris.
Alexandre Tharaud parle de concerts qui ne se réduisent pas aux instants sur scène, mais aux heures qui les précèdent et qui leur succèdent : avions, chambres d’hôtel, réflexions, concentration, natation, rencontres humaines, mode de vie et insomnies.
Me suis-je identifiée au héros ? L’ai-je rêvé ? Au contraire. Tout ceci m’a confirmé que la vie d’artiste n’aurait pas été pour moi. Il n’est pas inutile de savoir ce qu’on n’est pas pour ne pas fantasmer le romantisme d’une existence de concertiste.
Un jour je regardais un chef d’orchestre à la carrière assez belle qui s’agitait sur la scène de la Philharmonie de Paris. Quel beau destin, pensai-je. Et puis il s’est trouvé un jour que j’ai croisé le chemin plus ordinaire de son frère qui m’a dit à propos du chef international, tant admiré sur son piédestal : « Oh là là, il en a ras le bol des avions ! »
Naïve idéaliste, j’en fus surprise, mais en fait oui, j’en aurais ras le bol aussi.
Alexandre Tharaud n’en a pas ras le bol. Une telle divergence entre ce que je lisais et ce que je pensais m’a mise mal à l’aise. C’était comme faire la connaissance d’un étranger vivant aux frontières de ma compréhension. C’était entrevoir une toute autre forme de pensée, comme construire une toute nouvelle branche des mathématiques en changeant les axiomes de départ. Deux univers parallèles dont aucun n’est plus légitime ni meilleur que l’autre.
Il faut bien pourtant que l’auteur et le lecteur se rencontrent quelque part au fil des pages. C’est du moins ce qui me semble indispensable pour aimer un livre. J’ai trouvé un accord – est-il Majeur ou mineur ? – dans le regard qu’Alexandre Tharaud pose sur les gens. Il voit comme j’aimerais voir, avec justesse, humour et sans hauteur. Il en parle bien, et c’est heureux pour la transmission de son expérience car son point de vue me sera à jamais inaccessible.
Je vois la scène depuis la salle, et lui la salle depuis la scène.

Smoke de Paul Auster
Aux éditions Actes Sud 1999
Fiche de lecture publiée le 26 juin 2019

J’ai commencé à lire Paul Auster il y a vingt ans parce que je voyais sa photo dans les librairies et parce qu’il était super beau. Un regard cerclé de noir, comme maquillé.
Alors que j’écris cette fiche de lecture, je jette à coup d’œil sur Internet et je revois la photo des librairies de la fin des années 90. Il y en a d’autres maintenant aussi. Paul Auster a vieilli mais je constate qu’il a beaucoup écrit depuis que j’ai arrêté de m’intéresser à lui. J’ai du temps à rattraper.
Paul Auster n’était pas qu’une belle promesse en photo : j’ai adoré ses livres. Il est le premier auteur américain que j’ai aimé. Et puis je l’ai doucement oublié. Son souvenir m’est brusquement revenu la semaine dernière. Je photographiais pour la centième fois peut-être les nuages rosés du soir depuis ma fenêtre, et je me suis demandée si je n’étais pas un peu pitoyable, femme sans emploi, accrochée tous les jours à mon chez moi, qui n’avait rien d’autre à faire et pas d’autres perspectives que celle de photographier mon banal morceau de ciel quotidien.
Où avais-je vu ça ?
Me sont revenues alors l’histoire et l’image d’Auggie, le gérant d’une boutique de cigares à Brooklyn dans Smoke de Paul Auster. Smoke est un livre de Paul Auster – un scénario – et un film de Wayne Wang.
Auggie est peut-être un personnage pitoyable, sans grand destin, accroché à son petit emploi, qui photographie chaque jour la même vue à heure fixe de son petit quartier. Changent les saisons, le temps, les passants. Son client puis ami Paul Benjamin, écrivain, comprend mal l’intérêt de ces photos toutes pareilles, soigneusement développées, rangées et datées, jusqu’à ce qu’il y découvre, parmi les passants d’un matin, sa femme, morte peu après dans la fusillade du braquage d’une banque.
Smoke est une histoire de quartier qui finit bien. C’est une histoire où les gens gentils ordinaires s’en sortent, et s’unissent. C’est l’histoire de 5000 dollars volés par des méchants mais ramassés par un mec bien, qui rembourseront les 5000 dollars de marchandises gâchées d’un Auggie bourru trop sympa, pour finalement servir à une mère voulant sortir sa fille de la galère. Le circuit vertueux d’un argent bien mal acquis servant de prétexte à des rencontres, des retrouvailles, des cicatrisations de plaies anciennes, des dialogues drôles, émouvants dans la légèreté, sans guimauve.
Alors que le soleil se couchait devant mon balcon, j’ai lâché mon téléphone et mes photos pour rechercher Smoke dans ma bibliothèque. Je l’avais lu assez tardivement finalement : le marque page laissé dans le livre était une convocation datée de novembre 2006, signée de mon premier proviseur adjoint, à une réunion de crise portant sur une classe difficile… Déjà ? J’avais oublié cette difficulté, idéalisant peut-être mes premières années.
J’ai relu Smoke, et la photo de couverture représentant Harvey Keitel dans le rôle d’Auggie m’a donné envie de regarder de nouveau le film pour lequel ce scénario a été écrit en 1995.
Cette envie fut le point de départ d’une soirée entière d’errances sur la toile. You Tube ne connaissait Smoke en français que par courts extraits, et de multiples sites de streaming soi-disant gratuits, se proposaient toujours de m’abonner pour finir par clairement me facturer ou par maladroitement me demander – sans raison financière bien sûr – mes numéros de carte bancaire. J’ai fini par lancer Smoke dans une version de mauvaise qualité doublée en espagnol. Je ne sais pas pourquoi les doublages espagnols me paraissent toujours grotesques, mal joués, sans variété, à l’intonation stéréotypée. Est-ce l’impression laissée par une langue que je ne maîtrise pas complètement ? Est-ce parce que le débit de mitraillette de l’Espagnol s’accommode mal sans paraître artificiel du rythme anglo-saxon ? Est-ce parce que les doubleurs espagnols sont au nombre de deux – un homme et une femme – dans tout le pays et qu’ils font tous les personnages de tous les films en usant toujours de la même intonation ?
Mais j’ai été heureuse de revoir les personnages d’Auggie, de Paul, de Jimmy…
Smoke – le scénario et le film – est indissociable de Brooklyn Boogie – le film et le scénario. Brooklyn Boogie a été écrit et tourné dans la foulée de Smoke, parce que l’équipe ne voulait pas se séparer. Les personnages de Smoke sont restés, des guest stars sont arrivées, et Brooklyn Boogie s’est construit sous la forme de scénettes d’un monde qui défile dans la boutique d’Auggie.
20 ans avec mon chat de Mayumi Inaba
Aux éditions Philippe Picquier 2016
Fiche de lecture publiée le 13 septembre 2019

Un vieux monsieur s’assoit en face de moi. Calée contre la fenêtre du métro, mon sac serré contre mon ventre, je m’enferme dans ma lecture. Le regard du bonhomme est insistant : c’est mon livre qui l’intéresse. Peut-être le bouquin est-il un prétexte à celui qui a envie de discuter ? Plus facile d’engager la conversation avec quelqu’un qui lit qu’avec quelqu’un qui tapote son téléphone en jouant à Crush Candy.
_ 20 ans avec mon chat ? C’est beaucoup, aucun de mes chats n’a vécu 20 ans.
Le mien vient de mourir à 20 ans. Il vivait chez mes parents, dans son jardin de toujours, bien mieux que dans un appartement parisien. Je réponds au vieux monsieur bavard et curieux. Tout en acceptant du bout des lèvres ce début de conversation, je baisse les yeux sur mon livre posé sur mon sac. Le sac est ouvert. On m’a volé ma carte bleue. Je me lève d’un bond et sors, pour téléphoner, pour faire opposition, là sur le quai bruyant depuis lequel je hurlerai, les mains sur les oreilles, mon numéro de compte à un conseiller financier.
J’ai laissé le vieux monsieur avec ses questions. Le titre de mon livre avait piqué sa curiosité, tout comme la mienne quand je l’avais vu dans une librairie, petit bouquin d’une femme écrivain qui m’était inconnue.
Je trouve peu d’informations sur Mayumi Inaba, mais beaucoup de photos d’elle et de photos de son chat. Femme de lettres japonaise, décédée en 2014, auteur de romans et de poèmes, elle a obtenu de nombreux prix.
20 ans avec mon chat n’est pas le livre d’une mémère à son Youki*.
20 ans avec mon chat est une autobiographie, dont le fil conducteur est une chatte, Mî, sauvée chaton de la rue, recueillie, aimée.
Mî est l’élément de stabilité de vingt ans de vie, marqués par le travail, par des déménagements, par un divorce, et surtout par une vocation naissante puis triomphante d’écrivain. La vie tourne et change autour de Mî.
Mî, fragile chaton grandit et vieillit. Sa fin de vie, crue dans le récit de ses faiblesses, de ses maladies, des soins, de la tendresse et des inquiétudes, est réaliste sans être insoutenable. C’est juste comme ça, le récit mat et sans maquillage, de vingt ans de partage pendant lesquels l’existence de Mayumi Inaba, ses souvenirs, ses choix, son chemin vers l’écriture, sont indissociables de l’existence de Mî, de sa découverte et de son adoption, et de sa mort.
Un beau livre, simple, court, sans fioriture main plein de poésie, à lire si on aime les chats et regarder la ville autour de soi.
Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell
Aux éditions 10/18, 1933 pour la première édition
Fiche de lecture publiée le 16 novembre 2019
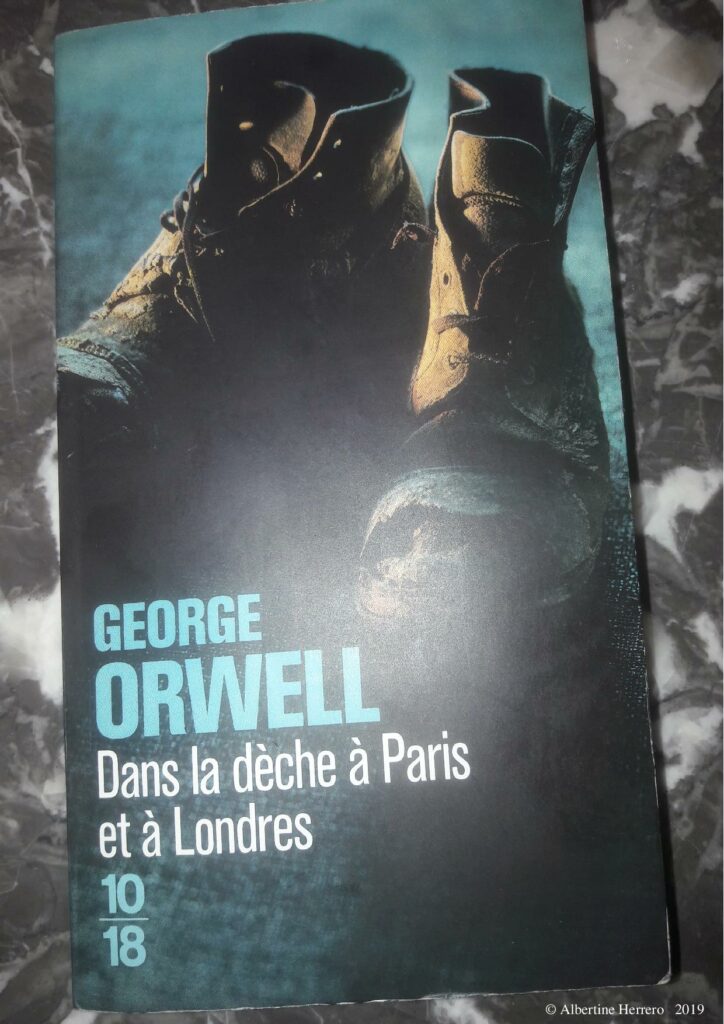
Il y a quelques mois je découvrais que George Orwell n’était pas que l’auteur de 1984. C’est ainsi que je lisais Hommage à la Catalogne, récit autobiographique de l’engagement d’Orwell aux côtés des anarchistes catalans pendant la guerre d’Espagne*. Et avant ça ? Avant, à la fin des années vingt, Orwell – tout éduqué qu’il soit – avait connu la grande misère, et appris à survivre sur le pavé de deux capitales : Paris et Londres. De cette expérience est sorti un livre. Rare témoignage sans doute que celui d’un homme possédant une telle plume dans le monde obscur de ceux qui vivent avec quelques pièces au jour le jour.
Je lis sur la quatrième de couverture ce qu’en a dit un critique littéraire de l’Express, Jean-Baptiste Michel : « Un documentaire picaresque, d’une précision photographique, sur une Europe qui vivait encore à l’heure de Dickens, à des années-lumières de l’État-providence et de nos lois sociales. On en mesure tout le prix, à la lecture de cet admirable reportage. » Je rejoins l’enthousiasme de ce commentaire, même si je ne suis pas certaine d’en partager l’optimisme qui consiste à affirmer que tout ce que décrit Orwell est révolu.
Quelques passages de ce livre sont gênants : ceux dans lesquels Orwell évoque des Juifs rencontrés sur son chemin de galère. Tout juste croisés et jamais approfondis, ces personnages n’offrent au lecteur rien de plus que le rappel de tous les stéréotypes liés aux Juifs : « avarice et grands nez ». A la pointe des idées politiques de gauche, Orwell n’était – semble-t-il – pas aussi éveillé à la cause des Juifs qu’à celle des ouvriers. Il n’en sort donc là que les lieux communs racistes d’une époque antisémite.
Le reste de l’ouvrage me paraît au contraire bien clairvoyant. A Paris Orwell sera plongeur dans plusieurs restaurants. A Londres il errera sans travail s’occupant uniquement de la vitale nécessité d’avoir pour le soir, l’argent d’un lit dans un dortoir et quelques piécettes pour un thé, des tartines et de la margarine. Plutôt que de rendre compte (mal) de ce que décrit (bien) George Orwell, je préfère citer des passages :
Page 162 : « Un hôtel chic, c’est avant tout un endroit où cent personnes abattent un travail de forçat pour que deux cents nantis puissent payer, à un tarif exorbitant, des services dont ils n’ont pas réellement besoin. […] Je crois que cette volonté inavouée de perpétuer l’accomplissement de tâches inutiles repose simplement, en dernier ressort, sur la peur de la foule. La populace, pense-t-on sans le dire, est composée d’animaux d’une espèce si vile qu’ils pourraient devenir dangereux si on les laissait inoccupés. Il est donc plus prudent de faire en sorte qu’ils soient toujours trop occupés pour avoir le temps de penser. Si vous parlez à un riche n’ayant pas abdiqué toute probité intellectuelle de l’amélioration du sort de la classe ouvrière, vous obtiendrez le plus souvent une réponse du type suivant : « Nous savons bien qu’il n’est pas agréable d’être pauvre ; en fait, il s’agit d’un état si éloigné du nôtre qu’il nous arrive d’éprouver une sorte de délicieux pincement au cœur à l’idée de tout ce que la pauvreté peut avoir de pénible. Mais ne comptez pas sur nous pour faire quoi que ce soit à cet égard. Nous vous plaignons – vous, les classes inférieures – exactement comme nous plaignons un chat victime de la gale, mais nous lutterons de toutes nos forces contre toute amélioration de votre condition. […] Ainsi donc, chers frères, puisqu’il faut que vous suiez pour payer nos voyages en Italie, suez bien et fichez-nous la paix. »
Page 236 : « […] à y regarder de plus près, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre les moyens d’existence d’un mendiant et ceux de bon nombre de personnes respectables. Les mendiants ne travaillent pas, dit-on. Mais alors, qu’est-ce que le travail ? Un terrassier travaille en maniant un pic. Un comptable travaille en additionnant des chiffres. Un mendiant travaille en restant dehors, qu’il pleuve ou qu’il vente, et en attrapant des varices, des bronchites, etc. C’est un métier comme un autre. Parfaitement inutile, bien sûr – mais alors bien des activités enveloppées d’une aura de bon ton sont elles aussi inutiles. […] Dans la pratique, personne ne s’inquiète de savoir si le travail est utile ou inutile, productif ou parasite. Tout ce qu’on lui demande, c’est de rapporter de l’argent. […] Affrontés à ce critère, les mendiants ne font pas le poids et sont par conséquent méprisés. Si l’on pouvait gagner ne serait-ce que dix livres par semaine en mendiant, la mendicité deviendrait tout d’un coup une activité « convenable ». »
Page 291 et fin : « Je tiens toutefois à souligner deux ou trois choses que m’a définitivement enseignée mon expérience de la pauvreté. Jamais plus je ne considèrerai tous les chemineaux comme des vauriens et des poivrots, jamais plus je ne m’attendrai à ce qu’un mendiant me témoigne sa gratitude lorsque je lui aurai glissé une pièce, jamais plus je ne m’étonnerai que les chômeurs manquent d’énergie. Jamais plus je ne verserai la moindre obole à l’Armée du Salut, ni ne mettrai mes habits en gage, ni ne refuserai un prospectus qu’on me tend, ni ne m’attablerai en salivant par avance dans un grand restaurant. Ceci pour commencer. »
*Voir Fiches de lecture, mai 2019.
Voyage de classes de Nicolas Jounin
Aux éditions La découverte 2014
Fiche de lecture publiée le 01 février 2020.
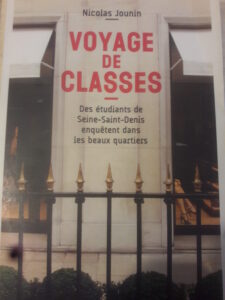
Quand vous faites un burn out et qu’on vous diagnostique un choc post-traumatique pour avoir enseigné dix-huit ans en Seine-Saint-Denis, tout le monde vous comprend : « Ah oui, les élèves ! ».
Ben non, justement, pas les élèves. Les conditions de vie, les quartiers abandonnés de nos élèves plutôt. Ces conditions indignes contre lesquelles mon impuissance est devenue insupportable jusqu’à la maladie. Jusqu’à devenir folle, schizophrène, car fonctionnaire d’un État qui me paie pour enseigner à des enfants alors qu’il est conscient qu’il me laisse avec eux pourrir au fond d’un trou de plus en plus profond et boueux dans lequel enseigner avec succès relève non seulement de l’exploit mais même de la désobéissances aux réformes et aux nouvelles lois.
L’important est de laisser le 93 au fond du trou, mais sous un couvercle surmonté d’un beau discours.
Je ne supporte plus les discours sur le 93. Je ne supporte plus les bonnes âmes qui vivent à dix kilomètres de Saint-Denis sans savoir le placer sur une carte et sans y avoir jamais mis les pieds. Je ne supporte plus ceux qui se croient bons car il veulent bien faire un pas vers les habitants des banlieues, mais à condition que ceux-ci fassent l’autre partie du chemin en apprenant à se comporter correctement et à éduquer leurs enfants. On veut bien aider les pauvres, mais à condition qu’ils fassent un effort pour devenir comme nous. Bref, à condition qu’ils fassent un effort pour ne plus être pauvres.
Je ne supporte plus le discours des riches sur les pauvres. Qu’ils soient accusateurs, moralisateurs ou condescendants.
Mais il existe une étude de pauvres sur les riches qui mérite d’être lue. Même plusieurs fois.
J’ai relu cette semaine avec le même plaisir qu’avant traumatisme le livre Voyage de classes de Nicolas Jounin, chercheur et maître de conférences en sociologie à l’université Paris VIII de Saint-Denis. Dans une passionnante introduction, Nicolas Jounin, explique comment il a décidé d’initier à la recherche des étudiants de Saint-Denis en première année de sociologie, en les envoyant enquêter sur le très riche VIIIème arrondissement de Paris.
Pourquoi est-il intéressant pour nous de découvrir le travail d’étudiants encore jeunes et peu compétents de 1ère année de fac ?
Parce que ce livre prend « à contresens la voie ordinaire de la curiosité institutionnelle. Des grandes « enquêtes sociales » du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas plus enquêtés que les pauvres ». Parce que dans ce travail nous découvrons, en même temps que les étudiants, les principes d’une enquête sociologique sur le terrain. Parce qu’il est ahurissant de réaliser qu’« une demi-heure de transports en commun sépare les quartiers parmi les plus pauvres de la France de ses zones les plus riches ». Saint-Denis et les Champs Élysées sont sur la même ligne de métro : la ligne 13.
Cet ouvrage rend compte d’une expérience dans laquelle l’enseignant lui-même a ressenti son décalage – ne serait-ce que vestimentaire – avec la très grande bourgeoisie.
Dans ce livre on découvre les boutiques de luxe dans lesquelles je n’ai jamais osé entrer et dans lesquelles les étudiants du livre ont dû essayer de se faire accepter. On ressent la méfiance, la prudence ou l’hostilité.
On observe le parc Monceau, plus ouvert, dans lequel j’ai fait de nombreuses promenades et constaté, comme les sociologues en herbe, que les enfants blancs ont des nounous noires.
On se frotte à la sécurité des rues, des commerces, des institutions, de l’ambassade d’Algérie. On comprend que les immigrés riches ne posent aucun problème.
On suscite aux terrasses la curiosité de clientes et le mépris de serveurs qui servent des cafés hors de prix.
On s’introduit dans des appartements, des hôtels particuliers, des bureaux d’élus. On subit avec les étudiants, des rappels à l’ordre social, de la condescendance, du mépris.
On apprend que certains commerçants acceptent même d’embaucher des vendeurs et des vendeuses du 93, car oui, oui bien sûr, il y a aussi quelques gens bien dans ces banlieues là. Ceux qui ont fait la moitié du chemin en acceptant de se civiliser assez pour être dignes de servir ? Les bons sauvages ?
On réalise que le meilleur accueil reste humiliant, car il est celui du supérieur humaniste qui tend la main à son inférieur.
En relisant ce livre, et même si je n’aurai plus jamais la force d’enseigner dans le 93, j’ai de nouveau ressenti tout le respect et l’affection que j’ai toujours eu pour mes élèves et pour leurs parents qui gèrent au quotidien et souvent en héros des difficultés qui nous dépasseraient.
En relisant ce livre j’ai aimé l’idée – peut-être fausse, peut-être vraie – que par ma fonction ou ma proximité géographique, j’ai croisé dans ma classe, dans un couloir ou dans la rue certains des étudiants sociologues de ce livre. J’en serais fière. Merci à eux.