Les textes qui suivent ont été publiés dans mon précédent blog entre le 31 mai 2018 et le 27 mai 2022, jusqu’au jour où tout le site a planté. J’ai décidé de les archiver dans ce nouveau blog en les classant par thèmes. Ceux qui suivent racontent mon expérience de mère de trois jeunes enfants dans une ville de petite couronne parisienne.
Matin – Publié le 31 mai 2018

Tu as l’air fatiguée !
Un mois de régime, une couche de mascara, du fond de teint et j’ai l’air fatiguée. Pas moyen d’être pimpante, encore moins resplendissante.
La Grande court vers la porte de l’école avec ses dix kilos hebdomadaires de cahiers à signer sur le dos. Le Moyen suit, une bretelle du cartable à l’envers, la capuche de travers, le sac de piscine sous le bras. Ils ont leur goûter pour l’étude, leur bouteille de flotte pour la récréation, la petite voiture pour échanger avec le copain, le collier « amie pour la vie » à offrir à la copine.
Il ne me reste que le Petit, le Riquiqui dans sa poussette qui hésite entre sucer ses doigts et son doudou. Il faudrait deux bouches, ou une plus grande. Sous ses fesses j’ai calé le paquet de couches pour la semaine et les rechanges en cas d’accidents pipipuréecacavomiboue.
Il ne me reste que le Petit et ma sale tronche de fatiguée.
Tu as l’air fatiguée, qu’est-ce que tu as ?
J’ai quarante ans, un boulot et trois gosses.
J’ai corrigé des copies, cuisiné et repassé jusqu’à minuit. Le Petit a perdu son doudou à 2h du matin, il a eu froid à 4h et sa couche a débordé à 5h. Le Moyen a eu mal au pied à 3h15 et a fait un cauchemar à 5h30. Le réveil de mon mari a sonné à 6h30 et le mien à 7h10. Une nuit ordinaire, somme toute assez bonne, sans terreur nocturne de la Grande, sans nez bouchés ni bébés gravissant au milieu de la nuit et à tour de rôle le lit parental avec quatre lapins et trois oursons pour prendre toute la place, s’étaler, donner des coups de pieds et finir par se casser la gueule sur le tapis dans un fracas suivi de cris stridents.
La porte de l’école s’est refermée. Je savoure une seconde cette petite victoire du quotidien d’être arrivée à l’heure avec trois enfants coiffés, dont l’estomac est plein, dont les dents et les mains sont propres. Certains escaladent un sommet, sautent à l’élastique, gagnent des guerres ou des élections, sauvent le monde en se jetant d’un avion. Je suis le James Bond du petit-déjeuner équilibré, des chaussures lacées et du cartable bouclé.
Plus que le Petit à consigner chez la nounou. Un bisou baveux sur le pas de la porte et ne me restera de ma charge matinale que mon sac à dos, mes feutres à tableau et mes stylos pour courir vers le métro.
Mère de bât – Publié le 01 juin 2018

La maternité est une charge.
Charge de famille.
Charge financière.
Charge morale.
Charge émotionnelle et affective.
Charge d’emploi-du-temps.
Et pourquoi pas, surtout, charge de la mule ?
Poids de la poussette. Poids des couches, des paquets de yaourts et des cartables. Poids des enfants qu’il faut hisser sur le toboggan ou dans le manège. Dix fois, cent fois, mille fois, sur le jeu il faut les remettre. Poids des enfants fatigués qui ne veulent ni marcher ni se laisser rouler. Poids des enfants endormis sans force qu’il faut soulever et poser sur le pot à minuit. Mais poids des enfants enjoués qui veulent faire l’ascenseur jusqu’au plafond et jusqu’au bout de la nuit quand viennent à dîner des amis.
Poids de la sortie à la plage. Du sac de jouets – moules, seaux, pelles, ballons, bouées, jeu de boules et jeu de bulles. Du sac des serviettes de bain, des nattes, des rechanges et des vestes pour le frais tombant du soir, de la crème solaire pour le chaud de l’après-midi. De la glacière du goûter et de la grosse bouteille d’eau. Du plus petit rejeton qui ne veut pas marcher dans le sable, et du parasol dont on s’est chargée pour le protéger des méchants UV, influencée et culpabilisée par toutes les recommandations médicales, sachant pourtant que l’enfant, insensé et insensible aux prescriptions, refusera – attiré par l’immensité de la plage – de jouer un instant sous sa chiche ombre protectrice. Poids du sable enfin, et de la progression lente et difficile dans le sol meuble, ennemi de la mère, mais terrain de jeu des deux plus grands qui courent et volent jusqu’à la mer après vous avoir glissé sous un bras ou accroché au seul petit doigt disponible, leurs tongs.
J’ai porté pendant les quatre mois de rénovation de l’ascenseur, chaque soir ouvrable, de retour du travail, la poussette pliée de la main gauche, la fille de deux ans sur le bras droit, le sac à langer de chez la nounou autour du coup et, dans le ventre, un fœtus farceur en pleine essor.
Je porte quand vient le soir, sur le chemin qui mène au conservatoire, le violon sur mon dos, l’étui de la flûte traversière en bandoulière et les cahiers de solfège ballottés dans un sac sur l’épaule opposée. Il faudrait un joug. Sur le chemin du retour s’ajoutent les courses d’appoint faites dans le quartier pendant les cours de musique : une boîte de sauce tomate, des œufs, du fromage en promo et du pain.
Mère de bât.
Il en faudrait dans les zoos, dans les fermes et dans les bestiaires.
Le gène de la chaussette (Partie 1) – Publié le 08 juin 2018

Une mère est un homme orchestre.
La mère, rentrée du travail chargée d’une baguette, de quelques bananes et d’enfants fatigués récoltés au saut du bus à l’école élémentaire puis chez la nounou, n’est pas encore au bout de sa tâche. Quand Jésus a dit : « à chaque jour suffit sa peine », ce devait être sans penser à la mère.
Il est 18h30 après l’étude. Tout en coupant des légumes pour la soupe du soir, et parfois également pour le déjeuner du lendemain si l’organisation d’un mercredi ou d’un samedi l’impose, la mère envoie sa grande fille encore petite se doucher seule. L’autonomie s’apprend au fur et à mesure du dépassement des parents.
Quand le dîner mijotera – en autonomie lui aussi – la mère baignera le Petit tout en hurlant au grand frère, depuis la salle de bains, des menaces non approuvées par les pédopsychiatres dans l’espoir de lui faire ranger sa chambre. La mère tenue de rester à une distance inférieure à la longueur de son bras de la baignoire en plastique bleue – un autocollant triangulaire jaune jamais décollé lui rappelle sans cesse le risque de noyade du Petit qui patauge joyeusement – fera venir à elle sa fille pour lui sécher les cheveux ou lui faire réciter une fable ou quelques tables de multiplications.
Le Petit sortira de sa toilette, propre et frais, semblable à une boule de coton dans un pyjama blanc et doux, les fesses pommadées, les oreilles bouchonnées et le nez récuré à l’eau de mer. La mère, enfin libérée de la chaîne invisible qui la retenait près de la baignoire, constatera l’inefficacité de ses menaces susdites en allant butter sur toutes les petites voitures circulant comme aux heures de pointe dans la chambre du Moyen. Elle s’enfoncera au passage un lego dans la plante du pied. Elle rangera donc tout, ce qui est finalement plus rapide et moins fatigant que de se mettre en colère, et enverra le Moyen souffler quelques minutes dans sa flûte avant de le coller dans la douche où il apprendra l’autonomie encore plus jeune que sa sœur, gâchant pour cela une quantité d’eau qui suffirait à l’irrigation d’un champ.
Reprenant le chemin de la cuisine, elle attrapera le Petit au vol avant qu’il ne ressorte tous les jouets, et le scotchera devant un dessin animé en replay. C’est ainsi que, profitant de sa fascination pour l’image, elle lui vissera dans le bec un biberon de purée de légumes – maison et peut-être bio ? – allongée de lait.
Si pendant ce temps la soupe du soir et le ragoût du lendemain n’ont pas attaché au fond, elle ira mettre la dernière main au dîner et s’occupera du couvert, tout en criant de temps en temps sur le chemin de la cuisine au salon : « plus haut ! », « plus bas ! », « encore ! », non qu’un être imaginaire lui gratterait le dos, mais pour corriger à distance les notes fausses frottées par la Grande dans son exercice quotidien du violon.
A 20h les enfants devront être propres et en pyjama, les devoirs vérifiés, les carnets de correspondance contrôlés, les chambres rangées, la musique travaillée, les vêtements du lendemain préparés, le dîner posé sur la table, et vidé le biberon de purée de légumes allongée de lait.
C’est le moment où la mère, alignant ses trois enfants proprets, devrait accueillir le père d’un sourire et d’un baiser, mais parfois, fatiguée, la mère n’est qu’une mégère.
Le gène de la chaussette (Partie 2) – Publié le 08 juin 2018

Doucher, ranger, cuisiner, surveiller les devoirs, guider la pratique musicale des jeunes enfants hésitants, préparer les sacs et les vêtements du lendemain. En même temps.
Pour que toute la complexe machine familiale fonctionne chaque soir sans se gripper, il faut chasser la moindre perte de temps.
Tout doit être à sa place.
La main droite qui, au-dessus de la gazinière, cherche, à l’aveugle dans un placard, la planche à découper les oignons pendant que la main gauche touille régulièrement et inlassablement le sauté de veau ou la béchamel, doit être immédiatement victorieuse. Hélas ! Souvent la main tâtonne, s’étonne puis abandonne. De planche à découper, point. Il faut alors ouvrir tous les placards, même les plus hauts, et pour cela déplacer plusieurs fois dans un épuisant mouvement de translation le tabouret sur lequel il faudra monter, puis descendre, puis monter encore, à seule fin de trifouiller dans tous les casiers perchés au plafond de la cuisine, à la recherche de la planche perdue. La planche à découper est toujours retrouvée, avec les moules à gâteaux ou les boîtes en plastiques (qui, toutes, invariablement, seront tombées par terre, dans la poubelle ou sur la tête de la mère pendant la prospection). Mais en raison du temps perdu dans la recherche, la béchamel est souvent ratée.
Que les petites cuillères jaunes soient rangées avec les petites cuillères bleues n’est pas un problème, que la planche à découper joue à cache-cache est contrariant.
Que dire de la préparation des vêtements ?
Impossible de se rendre compte à 8h le matin qu’il n’y a pas de slips propres ni de T-shirt repassé s’harmonisant avec la jupe de la Fille. Toute erreur serait funeste, entraînant les moqueries de camarades, ébranlant le fragile équilibre relationnel de la cour de l’école et favorisant pendant des mois la montée de crises d’angoisse le soir à l’heure déjà difficile du coucher.
Trois enfants, trois armoires, trois piles de vêtements qui sont donc alignées chaque soir sur le bureau du salon. La Mère se doit d’ouvrir chaque armoire une fois pour constituer d’un geste efficace chaque pile contenant pour chaque enfant un slip, une paire de chaussettes, une sous-chemise, un T-shirt, une jupe ou un pantalon, un gilet.
Si les chaussettes de la Fille sont dans l’armoire de la Mère et le gilet du Petit dans le tiroir du Moyen, le nombre de portes d’armoires à ouvrir, de tiroirs à tirer, de piles de vêtements en équilibre précaire à fouiller et de va-et-vient dans l’appartement se trouve considérablement augmenté.
Qui range les chaussettes et la planche à découper ?
Souvent la Mère, parfois le Père.
Le Père agit plus en féministe qu’il n’en parle. C’est bien. Le contraire est plus fréquent. Le Père s’occupe des enfants et range parfois l’appartement. Mais le Père ne fait qu’une chose à la fois et dit qu’il NE PEUT PAS savoir dans quelle armoire se rangent quelles chaussettes. C’est impossible, inimaginable, immuable, génétique.
Et moi ? Pourquoi à travail et niveau d’études équivalents serais-je plus disposée à retenir où se rangent la planche à découper et la paire de chaussettes avec des papillons jaunes ?
Pourquoi aurais-je MOI SEULE reçu en héritage – maternel ? – le gène de la chaussette ?
Le piège – Publié le 19 juin 2018

Une matinée de liberté s’ouvre à moi. Je ne travaille pas ce matin.
Les Grands sont à l’école. L’assiduité scolaire est obligatoire. Je suis une bonne mère.
Le Petit est chez la nounou. C’est beaucoup plus contestable. L’y ai-je jeté pour m’en débarrasser ?
Un peu, oui.
Une matinée de liberté. De solitude. De silence. Trois heures, immenses.
Il faudra que je range un peu, bien sûr. La table du petit-déjeuner, laissée encombrée dans la panique matinale. Les lits défaits. Je jouerai de la musique : piano et cornemuse. Et je prendrai du temps pour moi, pour épiler ces jambes honteuses de gorille hivernal. Il fait chaud en jean, et trop négligée, je ne peux me dénuder.
8h45. Le marché ouvre ses portes.
Demain j’aurai des invités. Il me faut des abricots pour une tarte. Je vais au marché, je ferai ma pâte, une compote, la tarte. Il me restera deux heures, immenses. De solitude. De silence.
Je jouerai de la musique : piano ou cornemuse ? Et j’épilerai mes jambes.
Au marché les abricots sont à 4€95 le kilo. Je tourne autour de plusieurs étals. Les prix sont identiques, imposés sans doute par les mêmes fournisseurs de Rungis. Il me faut deux kilos. C’est cher. Tant pis, je me lance.
_ Deux kilos d’abricots s’il-vous-plaît.
_ Vous les voulez bien mûrs ou pas trop ?
_ Bof, c’est pour une tarte…
_ Pour une tarte ? Ah mais attendez, j’en ai là pour un euro le kilo, regardez la belle caisse, et pas tâchés, hein, juste bien mûrs, six kilos, et celui-ci en bouillie c’est cadeau ! La promo du jour Madame !
Je rajoute quelques pommes pour la compote et une tranche de citrouille. Elle s’accommodera bien des carottes qui mollissent et noircissent dans mon bac à légumes. Une bonne soupe pour le Petit. En passant, j’achète un pantalon d’été à cinq euros, à l’étal des tailles uniques pour grosses fesses de mères qui achètent les fruits par caisses. J’y cacherai mes poils. Plus question de cornemuse, de piano ni de jambes estivales. Sous l’abricot cadeau en bouillie qui trône au sommet de la caisse, les autres fruits se révèlent candidats à un pourrissement imminent.
Je traverse le quartier avec ma caisse en promotion. C’est lourd, encombrant surtout, et j’ai l’impression que tout le monde me regarde. Gluant et collé, l’abricot cadeau en purée ne risque pas de tomber. Il y en aura pour la tarte demain, pour congeler en barquettes de compotes pomme-abricot, pour conserver en confiture. Il faudra sortir la grande casserole pour la compote, la moyenne pour la soupe, la cocotte pour la confiture, et stériliser les bocaux de l’an dernier. Quelques fruits parmi les moins meulés garniront ce soir la table du dîner.
Mère de famille nombreuse. La caisse qui pèse sur mes bras me fait comprendre, soudain, pourquoi depuis trois mois l’argent des courses file plus vite qu’avant. Les paquets de viande prévus pour deux jours ne font plus qu’un seul déjeuner et un frugal complément au dîner. Un gâteau à peine sorti du four disparaît en une heure quand avant il garnissait un dessert, un goûter et le petit-déjeuner. Je n’achète plus de paquets de gésiers de canard confits, mais des paquets – meilleur marché – de gésiers de volaille par lots de deux. Et voilà que je saute sur l’aubaine de fruits trop mûrs en cagettes. La tarte des invités, les vitamines du dîner et la confiotte de fruits promotionnels pour l’année. Il faudra trier, laver, dénoyauter, couper, touiller.
Autrefois j’aimais jouer les cantinières aux AG du lycée. Mal informée et peu armée pour les discours syndicaux, j’apportais mon soutien enthousiaste et sincère aux débats, sous forme de quiches au thon et d’œufs durs. Je suis maintenant cantinière au quotidien, remuant d’immenses gamelles indépendamment du calendrier des conflits sociaux.
Sur la table, la pâte repose au milieu des bocaux stérilisés et des barquettes de compote qui refroidissent. La casserole moyenne sèche sur l’égouttoir. La soupe bloblotte. La confiture écume.
La matinée de liberté, immense, est passée. Sans note de musique. Pour quinze euros, la table abonde de victuailles orangées, et mes jambes velues, oubliées une fois encore, ont trouvé de quoi se cacher. Le piège.
L’apprentissage – Publié le 24 juin 2018

CP : Présent du verbe être et du verbe avoir.
CE1 : Présent du verbe être et du verbe avoir.
CE2 : Présent du verbe être et du verbe avoir. AU SECOURS !!!
CE2 : copier cinq fois et apprendre par cœur : « il veut ».
J’imagine qu’il y aura « je veux » en CM1 et « tu veux » en CM2. Le pluriel sera pour le collège.
CM1 : les conjugaisons décollent enfin. On revoit le présent du verbe être et du verbe avoir (des fois que…) et on ajoute le présent, l’imparfait, le futur de l’indicatif des trois groupes. Quatre ans pour en arriver là. Un espoir se lève.
Dictée de CM1 : « Mélangez les ingrédients pour qu’il n’y est pas de grumeaux ».
Ah mais non, NON !
Je m’arrache les cheveux. Ma Fille me regarde sans comprendre. C’est dimanche. Prenant mon rôle de mère et d’éducatrice au sérieux, je lui ai demandé de me rejoindre à mon bureau avec son cahier de français. Je dois le lire et le signer comme chaque fin de semaine. Je le fais toujours devant elle, commentant, reprenant, expliquant, complimentant. C’est un rituel.
Je regarde la faute bien corrigée en rouge par la Maîtresse. Ma Fille a copié en vert à côté : ait.
Quatre ans pour apprendre « il est » et « il a », et on lui colle « il ait » dans une dictée. Pas notée, OK.
C’est le verbe avoir, ma chérie, le subjonctif présent. Elle ouvre de grands yeux.
Alors déjà, on ne lui a tellement jamais parlé du subjonctif qu’on ne lui a jamais dit que ce qu’elle connaissait s’appelait de l’indicatif.
Elle peut lire des pavés toute la journée, mais elle n’avait jamais remarqué la forme « ait » dans un texte. Évidemment, l’important c’est que Harry Potter tue le Basilic et peu importe qu’il le pourfende à l’indicatif ou au subjonctif. L’enfant qui viendrait me voir en me faisant remarquer au milieu d’une bataille de sorciers que le « è » est écrit « ait » et pas « est » ni « ai » aurait (conditionnel) un inquiétant pet au casque.
Le présent du verbe avoir c’est « il a ».
Le présent du verbe être c’est « il est ».
Si je dis maintenant que le présent du verbe avoir c’est « il ait », c’est le bordel !
J’imagine assez facilement que la faute se trouve dans beaucoup de cahiers qui seront ce dimanche signés par les familles. L’intention de la maîtresse est-elle que les parents signent sans commentaires ? Que les parents expliquent le subjonctif à la place de l’école ? Que les parents n’expliquent rien mais qu’une graine de subjonctif germe dans la tête des enfants ?
Lire du subjonctif, bien sûr. Parler au subjonctif et en écouter, certainement. Mais écrire avec la bonne orthographe du subjonctif dans une dictée quand on n’a jamais intellectualisé l’existence du subjonctif ?
Je prends le parti de semer momentanément une graine de subjonctif dans la tête de ma Fille ce dimanche, et d’y revenir plus sérieusement pendant les prochaines vacances. On y arrivera. Je me suis promis qu’elle irait au collège en sachant écrire français. On progresse vers ce but.
Que feront les parents non francophones ou bilingues hésitants ou réfractaires au subjonctif faute de culture scolaire et de parler châtier ou littéraire ?
Ils ne verront pas la faute, ou ne la commenteront pas, ou n’y penseront pas, et au lycée, et toute sa vie, l’enfant devenu grand écrira « Mélangez pour qu’il n’y est pas de grumeaux ». Faut-il juste espérer qu’il n’écrive pas de livres de cuisine ?
L’esquive – Publié le 26 juin 2018

Pourquoi suis-je en train de remuer un bœuf bourguignon ?
Il fait 28 degrés dehors. En cette fin d’après-midi, dans ma cuisine orientée plein Ouest, la température au-dessus du Bourguignon doit avoisiner les cinquante degrés. Rougeaude, épuisée, embuée de vapeurs d’alcool, je touille à en étouffer, la viande qui mijote dans le vin. Le bœuf cuira trois heures.
Pourquoi ce plat d’hiver ? Parce que cette fois j’ai su éviter le piège. Aujourd’hui j’ai su éviter tous les pièges.
L’emploi du temps du prof est un piège. On ne « travaille » pas tous les demi-jours, ce qui signifie que nous ne sommes pas 40 heures par semaine devant les élèves. Nous-même nous oublions souvent de compter comme travail, les heures de correction et de préparation. Et comment les compter, ces heures morcelées, ces copies corrigées parfois deux par deux entre des légumes à éplucher et une lessive à lancer ? La raison voudrait que le prof travaille sur des plages confortables, les jours ouvrables, quand il n’a pas ses classes. Les matinées du mardi et du jeudi par exemple, je « ne travaille pas ». Je devrais donc ces matins-là – une fois livrés les enfants à l’école et chez la nourrisse – m’installer à mon bureau, et corriger d’un trait mes copies.
Mais comment consacrer aux copies trois heures inestimables de vie dans un appartement vide et silencieux ?
Je corrige donc mes copies la nuit, le dimanche, au lycée aux heures des repas.
N’importe quand, mais pas le mardi ni le jeudi matins.
Hélas d’autres ennemis veillent : les courses et LES SORTIES SCOLAIRES !
_ Maman, mardi matin on va à la piscine/à la gym/au cinéma/au musée/voir des vieux/en pique nique.
La maîtresse veut deux parents accompagnateurs, tu viendras, dis ?
Ce mardi matin j’ai commencé par faire la queue à la Mairie dès 9h pour les inscriptions scolaires et extrascolaires de l’année à venir. La file d’attente des mères trépignait, se bousculait, bouchait la sortie et les autres guichets. Toutes, nous serrions des enveloppes kraft et des chemises cartonnées bourrées de papiers administratifs et de justificatifs, priant avec la même ferveur mise à repousser la malpropre qui aurait voulu nous passer devant, qu’il ne manque aucun document. Certaines mères avaient quitté leur travail prétextant une pause pipi qui s’éternisait dans cette queue bigarrée des mères venues de tous les quartiers de la ville.
J’avais les bons papiers. Sortie en vainqueur de la Mairie avant la fin de mes trois heures, j’ai renoncé effrontément à être Super Ménagère. Pas de courses aujourd’hui, de caddies, de rayonnages, de foule mercantile ni de temps perdu. Ce serait le retour à la maison et, tant pis, le Bourguignon bon marché acheté et congelé quelques semaines plus tôt. Une bouteille de rouge à 2€ devait traîner justement quelque part dans un placard.
J’avais évité le premier piège. Au prix d’un grand coup de chaud au-dessus de mes casseroles, le soir.
C’est alors que dans la rue j’ai croisé le rang anarchique et fluctuant d’une classe en sortie.
Merde ! Mon Moyen devait aller à la gym ce matin ! Et j’avais oublié de l’habiller d’un jogging. Je voyais la scène du soir. La tête déconfite de l’enfant trahi par sa mère, qui aurait passé, puni en jean et sur le banc, la séance de gym. Alors j’ai couru, couru dans la rue. J’ai couru chez moi prendre un jogging, couru à l’école. Couru pour mon enfant, et couru aussi pour arriver AVANT que ne sorte de l’école son rang. Je m’imaginais croisant sa classe sur le chemin du gymnase et je savais que j’y aurais croisé aussi une sollicitation polie mais ferme de la maîtresse, et croisé le regard suppliant et chargé d’espoir de mon Fils : Maman, tu viens à la gym ?
Non, NON ! Pas la gym, les vestiaires qui puent, les tapis pleins de sueur qui me rappellent mon école et mes calvaires sportifs de godiche. Pas la prof de gym, la vieille petite blonde à la queue de cheval peroxydée, au corps faussement jeune d’ancienne championne russe qui crie sur tout le monde dans un charabia suraigu.
Alors j’ai couru, comme aurait couru une championne russe qui n’aurait pas 40 ans, et je suis arrivée avant.
Le gardien de l’école a pris le jogging, à temps. Mon Fils, heureux, a sauté sur les tapis puants de la Blonde qui hurle sans fin avec son accent des mots sans suite.
J’avais évité le deuxième piège. Seule, les copies oubliées, j’ai mis un disque et j’ai DESSINÉ.
L’ignorance à deux vitesses – Publié le 03 juillet 2018

L’école du quartier doit être simplifiée.
La grammaire est effleurée. La conjugaison esquissée.
Les expressions compliquées, les compléments d’objets directs, indirects et seconds, les compléments circonstanciels de tous temps et de toutes les manières ont été priés d’aller voir ailleurs si les enfants y étaient.
Ce qui n’est pas sujet est prédicat, et c’est bien suffisant comme ça.
Ainsi en ont décidé ministres et inspecteurs. Ils savent. Aux maîtresses de marcher au pas.
Le conservatoire est resté figé depuis mes jeunes années.
La sous-dominante et la sensible font toujours une quarte.
Installées dans une rue parallèle à l’école du quartier, la demi-cadence, suspensive, et la cadence, conclusive, prennent le thé et rivalisent de politesses :
_ Installez-vous, je vous en prie, c’est la fin du morceau.
_ Je n’en ferai rien très chère, prenez place, et jouons un peu, j’attendrai la portée suivante.
La tonalité de la gamme majeure dont l’armure est en dièses – et non en bémols ventrus qui obéissent à d’autres lois – se trouve en augmentant d’une seconde la dernière altération à la clé, à moins qu’on ne soit en mineur comme nous le signalerait un demi-ton sur la sensible, et que la gamme ne soit la relative dont la coquette tonique se révèle lors d’une descente de tierce.
A l’école du quartier, on ne peut pas faire mieux que ça avec des enfants issus de ces milieux-là, vous comprenez bien.
Au conservatoire, inutile d’amoindrir la complexité du vocabulaire et des règles pour ces petits bourgeois. Mais vous ne comprenez rien.
Dans les deux cas, simplification condescendante ou élitisme obscur : même résultat. Dans les deux cas, à la maison, je me retrouve à faire le boulot. Mère et prof : le monstre à deux têtes qui ne dort jamais.
Pour l’école je replonge dans mes lointaines règles d’écolière, enseignant à ma Fille l’existence du précieux complément d’objet qui lui dira comment accorder les participes passés qu’elle a employés É-S.
Pour le conservatoire, je réapprends en vue de la retransmettre immédiatement une théorie oubliée depuis vingt ans. Je re-explique, je reprends, je remets une couche, parfois avec énervement.
Soir après soir, semaine après semaine. Les saisons et les semestres ont passé É.
Et puis les bulletins de fin d’année sont tombés.
Tous les élèves ont la moyenne. Tous les élèves passent dans la classe supérieure.
Les parents sont contents. Ils rivalisent de politesse, paradant aux auditions, aux spectacles et aux animations. Ils se rendent des invitations. Ils se congratulent, échangent des compliments sur les progrès de leurs progénitures. A l’école du quartier de la rue derrière, comme au conservatoire de la rue devant, l’Ignorance a obtenu son passage et poursuivra en septembre sa scolarité lacunaire.
Et ce qui m’exaspère en tant que mère, je le poursuivrai au lycée, donnant le bac à ces enfants devenus grands sans être beaucoup plus savants. Non par cynisme, mais par cette foi de début d’été qui nous porte à croire qu’il est juste qu’ils sortent bacheliers.
Pour les pauvres c’est bien suffisant qu’ils distinguent le SUJET du magma RESTANT.
Pour les riches, dire qu’on sait, sublime château de cartes, fait assez briller la culture du dominant.
Combien de pianos gardés vingt ans dans un salon et jamais joués ?
Revendus vieux mais neufs par les héritiers ?
Combien de nouveaux convertis, de ces récents enrichis – grands ou tous petits – imitateurs forcenés des anciens, qui font le siège des inscriptions de plusieurs instruments pour un seul enfant ?
Devront-ils jouer ou dire qu’ils jouent ? Plus est-il mieux ?
Que se passe-t-il sur la perpendiculaire joignant la rue de l’école à celle du conservatoire ?
Elle longe le parc. L’odeur en pleine chaleur des déchets canins laissés sur les trottoirs cède, mètre après mètre, le terrain à l’odeur du crottin épandu sur les massifs floraux récemment promus par le Maire au label écologique. Dans quel massif de fleurs, dans quel caca, canin ou équin, l’Ignorance a-t-elle changé de vêtements, de crasse et populaire à l’école, pour devenir chic et parée au conservatoire ?
Le crasseux de la plage – Publié le 09 juillet 2018

Un gamin tout nu court sur la plage.
Tout nu, tout blanc, quatre ou cinq ans. Heureux.
Il n’a pas de slip mais il tient une pelle.
Sa mère et sa grand-mère le suivent d’un pas tranquille.
Où va-t-il ? Vers la construction d’un château éphémère ou d’une barrière contre la mer.
Il est décidé. Un bâtisseur, un seigneur, un guerrier, tout nu.
Une telle rencontre est devenue rare.
Petite, j’étais nue sur la plage. Pas besoin de maillot de bain ni de couches spéciales baignade avec des poissons clowns dessinés dessus. Un film super 8 me montre, nue blanche et potelée, faisant mes premiers pas sur une plage identique à celle là.
Je n’ose pas mettre mon fils tout nu sur la plage.
Malgré sa peau dorée de cacahuète grillée, son corps nu au soleil s’imprime dans mon esprit barré en gras et en capitales de la mention : CANCER DE LA PEAU.
Je lui laisse, sous son body de tous les jours, une couche qui sera bientôt pleine de sable et pleine de flotte. Je tartine ensuite tout ce qui dépasse de crème qui colle protection 50+ résistante à l’eau. Pour lui point de petites fesses au soleil ni de petit zizi qui s’agite au vent.
Pour les enfants environnants non plus.
Tout autour de nous sur le sable se dressent, petits champignons de couleurs vives, des tentes de plage. Dans chaque tente s’abrite un enfant. Ils me font penser à ses plantes du jardin de mes parents qui me fascinaient dans mon enfance, petites boules orangées enfermées chacune dans une coque de verdure qui rougissait puis devenait dentelle en fanant et en séchant : des amours en cage.
Les enfants qui se risquent dehors semblent porter la tente à même la peau : des combinaisons bleues jaunes ou vertes avec des jambes, des manches et de longues fermetures éclair. Un chapeau sur la tête, des lunettes noires. Ces lutins colorés, reconnaissables aux seuls bariolages de leurs combinaisons s’agitent, actionnant pelles et seaux. Une multitude de nains au boulot.
Trop inquiétée par les UV, je suis incapable d’accorder à mon fils de deux ans la liberté de montrer ses fesses. Rebutée par l’idée d’un consumérisme et d’une mode excessive, je n’ai pas non plus accepté de lui acheter un scaphandre coloré.
Dans cet entre-deux sans courage, mon gosse en couche pendante et body crasseux, est le clodo de la plage.
Sans chapeau, hilare, les boucles emmêlées, le visage couvert de sable collé et de restes de chocolat du goûter, il passe, curieux, d’un groupe d’enfants à un autre, cherchant des regards derrière les lunettes et dans l’ombre des casquettes. Il observe les parents qui observent à leur tour cet incongru Charlot des mers.
Un bébé dans la tête – Partie 1 – Publié le 30 août 2018

J’aime la fraîcheur qui tombe sur la côte vendéenne en fin d’après-midi. Les plagistes de ce mois d’août, un à un plient leurs tentes, leurs serviettes et leurs parasols. A partir de 18 heures les mouettes et les goélands, venus avec le vent frais qui se lève, remplacent les humains sur le sable.
Les enfants, après la baignade avaient les lèvres bleues et claquaient des dents. J’aime au sortir de l’eau courir avec eux, grelottants, vers le camp, la serviette et le goûter. J’aime les sécher, les aider à passer des vêtements secs, leur donner des gâteaux qui ont toujours eu pour moi une saveur particulière après un bain de mer. Au chaud dans une veste de jogging ou une polaire, nourris, mes enfants, quand d’autres désertent, tiennent tête aux goélands.
Ils construisent une maison dans le sable. Là sera le salon. Là seront les chambres. Ils font semblant de regarder un DVD, aussi hypnotisés que si l’image était vraie. Ils jouent ensemble, sans hurler, se battre ni se déchirer. Un inespéré moment de grâce.
J’ose alors sortir du sac de plage, un livre. La lecture est malaisée. Chargée du bazar des mouflets, j’ai oublié mes lunettes de soleil. Les pages blanches réverbèrent la lumière crue et mes yeux larmoient. Pas tranquille et pas concentrée je lève la tête entre chaque phrase. Aucun gosse n’a-t-il disparu dans la mer ou dans les dunes ?
Je ne comprends presque rien à ce que je lis. Mais le « presque » est déjà précieux. Je lis trois fois la même phrase ou saute un paragraphe entier, mais j’arrive au bout de la page, puis d’un chapitre. Dans un élan d’espoir gourmand j’ai acheté, début août, un livre écrit par celui qui fut notre guide lors notre visite à la grotte de Lascaux II.
Le Petit menace de s’éloigner du campement. Je m’apprête à bondir mais son attention reste retenue dans le bon périmètre. Le vent a tourné ma page et des grains de sable se logent dans la reliure. Je reviens au début pour relire encore l’ordre, les dates et la présentation du Gravettien, du Solutréen et du Magdalénien. Minus veut aller chercher de l’eau dans son seau. En hâte je me lève pour l’accompagner : la mer, basse, est trop loin. Au retour j’ai perdu ma page.
Je relis alors le Gravettien, le Solutréen et le Magdalénien. Les illustrations de gravures préhistoriques se superposent dans mon esprit aux chemins tracés dans le sable par les enfants. Est-ce un mammouth ou une route ? Suivant le va et vient trop rapide de mes yeux entre les pages et la plage, des images mentales se forment et se brouillent. Tout se confond. La calcite des grottes avec les galets de quartz et de calcaire disséminés sur la plage. Le foyer d’un Préhistorique avec le nid de sable dans lequel se love ma Grande. Sapiens passe au filtre de ma maternité qui veille.
Les préhistoriens ont retrouvé des traces de foyers, d’os et d’arêtes, et de la graisse de poissons sur des pierres qui avaient servi à les faire sécher. Les Cro-Magnons ne faisaient-ils jamais le ménage en quittant les lieux ? Je me demande ce qu’il resterait de notre passage si un événement climatique ou géologique figeait pour des milliers d’années le sol de la plage après notre départ. Une minuscule route bordée de petits cailloux. Un moule crabe en plastique oublié. La trace d’une serviette qu’on avait étendue. Un jeu de morpions dessiné avec un doigt sur le sable mouillé. Des molécules de crème solaire. Et sur toute la longueur de la plage, les restes de tous les châteaux de sable construits par nos semblables.
Figurante – Publié le 31 août 2018

Quels films suis-je allée voir récemment ? Coco et Cars 3.
Merde : il faudra trouver un autre sujet de conversation.
Il est des femmes entre 35 et 45 ans qui n’ont pas d’enfants. Je ne parle pas de celles qui en voudraient. Je parle de celles qui n’en ont pas par choix.
Combien de films sont-elles allées voir récemment ? Combien de livres ont-elles lus ? Combien de combats politiques ou artistiques ont-elles menés ?
Je me demande souvent quelle serait mon activité intellectuelle si je ne devais pas utiliser la quasi-totalité de mon cerveau et de mon temps à penser aux horaires de l’école et de la nounou, au pédiatre et au dentiste, aux vaccins, aux fournitures scolaires et aux compotes qui manquent, aux goûters dans le cartable et aux sacs de piscine, aux cahiers à signer et à l’argent des sorties à donner.
Depuis dix ans que je fais des enfants, j’aurais bien pu faire deux masters. En Géologie et en Histoire ? En Economie et en Sociologie ? En Psychologie ? En Musicologie ? Sur mes étagères sont classés religieusement mes livres d’avant. Ceux datant de mes études initiales de Mathématiques. Ceux datant de mon cursus plus tardif d’étudiante adulte en Lettres modernes. Inutile de faire semblant : j’en ai oublié tous les contenus. Est-ce bien moi qui un jour ai lu et aimé Diderot ? Qui ai rêvé de faire une thèse sur Rousseau ? Et qui sont Bienaymé et Tchébychev associés pour l’éternité dans un théorème depuis longtemps effacé de mon ardoise mentale ?
Combien de connaissances ont accumulées les femmes qui n’ont pas d’enfants ?
Les femmes entre 35 et 45 ans qui n’ont pas d’enfants me terrifient par le savoir qu’elles ont sûrement, par leur esprit jamais engourdi qu’elles ont le temps de cultiver et de faire briller. Savent-elles donc tout de l’actualité comme du passé ? Ont-elles vu tous les spectacles et lu tous les journaux ? Ont-elles des opinions à défendre ? Savent-elles tout de la littérature de tous les pays ? Sont-elles scientifiques ? Créatrices ? Engagées ? Tout ?
Je pense à ce que doit être ma conversation en comparaison : BOBONNE.
Je me demande souvent ce que je ferais de mon argent si je ne devais pas utiliser la quasi-totalité de mes revenus en emprunts immobiliers pour avoir la surface de caser les lits et les jouets de tous mes mômes, en fringues taille 3, 8 et 14 ans, en inscriptions au conservatoire, en nounou, en couches et en bouffe pour cinq.
Depuis dix ans que je paie pour mes enfants, j’aurais pu visiter tous les continents. Je n’achèterais pas mes fringues au marché ni mes teintures capillaires chez Leclerc. Je saurais me maquiller, je serais bien colorée et bien coiffée. Même d’allure jeune et simplement négligée, je le serais avec art. J’achèterais très chers ces vêtements pour vieilles qui imitent les jeunes. Je ne m’habillerais pas juste pour ne pas sortir nue et ne pas avoir froid.
A quel point sont belles les femmes qui n’ont pas d’enfants ?
Les femmes entre 35 et 45 ans qui n’ont pas d’enfants m’anéantissent de leurs seins fermes et de leurs ventres plats. Et peu importe que je n’aie pas pris un gramme en dix ans et trois grossesses car – outre que le point de départ n’était pas terrible – l’avachissement et l’élargissement sont là. Sur moi. Mais pas là-bas. Pas sur elles.
Je pense à ce que doit être mon allure en comparaison : BOBONNE.
J’ai des bras épais à porter des gosses, des cartables et des cabas pleins de courses. Des mains à ouvrir des bocaux de cornichons. Des jambes en poteaux télégraphiques à courir après le bus ou à marcher sur plusieurs arrêts pour être à l’heure à l’école. Une grosse santé pour dormir peu, manger vite, discipliner ma vessie et tenir le cap. Une version contemporaine de Madame Cro-Magnon. Efficace, solide, active au foyer. Je pourrais cuire un mammouth en torchant un gosse d’une main et en taillant trois silex de l’autre. BOBONNE.
Souhaiterais-je être une femme sans enfants entre 35 et 45 ans ? Non.
Honteuse, complexée, taiseuse, en retrait, car consciente d’être BOBONNE. Mais sans envie ni regret.
Madame Cro-Magnon a-t-elle peint la grotte de Lascaux ?
Je le voudrais. Quel beau destin de BOBONNE ce serait !
Au lit – Texte publié le 08 septembre 2018

Les enfants sont couchés.
Pas encore endormis. On guette. Le temps s’arrête.
Ils se sont brossés les dents.
La Grande et le Moyen ont partagé le lavabo, c’est-à-dire qu’ils ont fini chacun par taper l’autre avec le bras qui ne tenait pas la brosse à dents et par se cracher de la mousse blanche à la figure pour gagner la place au MILIEU du lavabo.
Là-dessus, le petit est arrivé portant sa petite chaise de petit bureau avec laquelle il a latté les jambes de ses deux aînés, mettant les belligérants d’accord en prenant pour lui-même qui n’atteint pas le robinet et pour sa chaise qui est là pour ça, le MILIEU du lavabo.
Après avoir avalé le dentifrice, le Petit est venu montrer fièrement ses toutes récentes dents de lait bien nettes, et s’est retourné pour tendre fièrement son petit cul, annonçant : « caca ! ».
Quelques mains, dents et fesses propres plus tard, est venu le temps de l’histoire.
Un jour j’ai bêlé en cours de maths et demandé à mes élèves qui faisaient des bruits d’animaux depuis 15 minutes en se croyant rebelles et spirituels, s’ils avaient la nostalgie des livres que leur lisaient leurs parents avant de dormir et s’ils voulaient que je vienne avec les bouquins de mes gosses en lieu et place de mes polycopiés sur le calcul des taux d’intérêts. Le mouton : bêêêêêê. Le chien : Wouaff. Le chat : Miaonnnn. Je suis particulièrement fière de mon miaulement mais j’ai toujours été gênée par la grenouille. Sans parler du papillon ! Les élèves ont ri et l’un d’eux m’a dit : « quelles histoires ? Moi c’était au lit et ferme ta gueule, tous les soirs ! ». Ah bon, c’est possible ? Je suis tentée.
Nous on lit des histoires. On se fait avoir. Une histoire, puis deux, parfois plusieurs en même temps à deux. Les mots se croisent, Tchoupi se retrouve chez le Magicien d’Oz et les Trois petits cochons vont construire leurs Petites maisons dans la prairie. L’individualisme règne. Une histoire pour trois c’est impossible, non qu’aucune ne pourrait plaire à tous, mais parce que c’est un enjeu affectif – « tu as lu deux minutes de plus à lui qu’à moi ! » – et de pouvoir – « Papa, pas maman, pars ! ».
Et enfin on éteint la lumière, on dépose quelques bisous – « tu as fait deux bisous de plus à elle qu’à moi ! » – en même temps que quelques menaces et on file dans le salon, avec espoir.
Silence. Pas pour longtemps. Du fond de l’appartement parvient une plainte :
_ T’as oublié mon câlin ! Un bisou c’est pas un câlin !
_ T’as pas mis le pchitt moustiques.
_ L’eau, l’eau.
_ Moi aussi j’ai soif.
_ J’ai mal au pied.
_ Ça me gratte.
_ J’ai chaud.
_ Maman, ça existe les loups ? Et le Père Noël ? Et Dieu ?
_ Et les pistons dans un moteur, ça sert à quoi ?
_ J’ai perdu mon quatrième LAPINNNNNN !!!!
Papa est parti faire la vaisselle, et c’est là que Maman-câlins-bisous-histoires qui voulait enfin s’asseoir devant son ordinateur tranquille ou se lire à elle-même une histoire sans cochons ni doudous qui parlent, se transforme en un monstre féroce : croisement terrible entre un loup et un moustique tigre.
AU LIT ET FERMEZ VOS GUEULES !!!
Cher élève de Terminale qui meuglait en classe, merci pour tes conseils.
Et pourtant, qu’ils seront beaux dans quelques instants ces enfants endormis, silencieux, aux joues rondes et veloutées. Un dernier bisou pour chacun et l’oubli pour leurs bêtises jusqu’à demain.
Les courses – Publié le 01 octobre 2018
Toutes les lignes de ma liste de courses sont rayées.
J’ai commencé par les articles encombrants, et poursuivi par les denrées indispensables. Du nécessaire au superflu, additionnant mentalement au fur et à mesure de ma progression dans les rayons, une valeur arrondie de tous les prix. Quand j’en arrive à barrer de ma liste les plaques de chocolat à cuire pour les cookies-plaisir du mois, je suis arrivée face à la caisse.
Le caddie déborde. Il ne se dirige plus sans mal. Je patine et m’arc-boute en le poussant sur le sol glissant. Dans la queue on me regarde de travers, surtout ceux qui sont derrière.
C’est le caddie du début de mois. Le caddie infernal que, dans ma haine des courses, je ne pousse – heureusement – qu’une fois par mois. J’ai toujours l’espoir de ne plus y revenir. Comment expliquer aux ménagères contrariées qui me suivent, que le temps et l’argent que représente mon caddie ne sont pas si exorbitants quand on les divise par trente ?
Observée, pressée, en sueur et en panique, je vide le caddie sur le tapis roulant puis le tapis roulant dans le caddie. Je m’excuse et j’abandonne l’article dont j’avais pourtant besoin quand un prix ne passe pas. Je ne veux pas retarder. Essoufflée, je finis par payer. Trois cent dix neuf euros et quarante deux centimes. Bravo, vous avez gagné un euro et vingt-cinq centimes en bons d’achat sur votre carte fidélité du magasin. Zéro virgule trente-neuf pourcents.
Et n’oubliez pas vos dix pochettes de cartes à collectionner !!! Mes cartes à collectionner ?
Découvrant leur existence il y a quelques mois, je les refusais, incrédule. Pourquoi ces morceaux de carton à l’effigie de robots et d’acteurs américains en pyjamas stellaires des sables ? Les photos d’acteurs – même en pyjamas extragalactiques – ça ne sert à rien, ça ne se cuisine pas.
C’était sans compter sur l’école des enfants.
Une pochette à collectionner est offerte dans le supermarché du quartier par tranche d’achats de trente euros. Tout le quartier va au supermarché du quartier, sauf les très pauvres qui doivent se contenter d’autres enseignes encore meilleur marché que le supermarché bon marché du quartier.
Qui possède de nombreuses cartes est riche : il va au supermarché du quartier et il peut beaucoup dépenser. Les enfants recherchent les cartes. Les parents regardent les possesseurs de cartes. C’est un signe extérieur de richesse qui crée l’envie mais aussi le respect. Ici tout le monde se regarde.
Dans un lâche souci d’offrir un peu de prestige à mes enfants qui portent le fardeaux de n’avoir qu’une seule paire de lunettes chacun et pas de tablette ni de téléphone portable, j’ai fini moi aussi par prendre les cartes à collectionner. Honteuse de cette démarche puérile, j’ai accepté, pour des bouts de papier sans valeur, de faire une nouvelle queue après l’épreuve de la caisse, cette fois à l’accueil du magasin, auprès de l’hôtesse chargée de distribuer les pochettes sur la foi du ticket.
Mes enfants les ont offertes dans la cour de récré aux copains préférés empressés.
Aujourd’hui c’est une copine de ma fille, croisée avec toute sa famille dans les rayons, qui m’a demandé si je pouvais lui donner mes pochettes. Oui bien sûr. A l’accueil l’hôtesse, écrasée par la cadence du travail et le défilé des clients, s’embrouille à compter mes dix pochettes. Trois cents balles ce n’est pas rien ! Elle m’en file un paquet sans regarder de près : seize !
La copine et ses parents vont croire que j’ai claqué sans ciller plus de quatre cent quatre vingt euros en un seul passage au supermarché. C’est la gloire assurée. La jalousie aussi, la méfiance, l’envie, les commérages, mais il vaut mieux faire envie que pitié. Le renversement de l’ordre social n’est pas en marche dans ce quartier où l’habitat populaire fait encore un peu de résistance et dans lequel des malins ont su atrophier et subordonner à la consommation, les rêves des pauvres.
Le gâteau de la maîtresse – Partie 1 – Publié le 16 octobre 2018

Mardi avant les vacances, 19h.
C’est le bout de tout. Le bout de la résistance au manque de sommeil. Le bout du Petit Bout qui en a marre d’aller chez sa nounou. Le bout de ma patience de prof devant les élèves. Le bout de la patience de mes élèves devant leur prof.
Le bout du garde-manger aussi.
On part samedi, aux aurores. Ne reste plus à assurer que trois petits déjeuners et trois dîners en comptant celui de ce soir. Pas question de retourner faire des courses. Pas de temps, plus d’argent. Le pain quotidien, un fond de café et quelques paquets de gâteaux dans un placard feront les petits-déjeuners. Les yaourts seront moins variés. Des compotes longue conservation et une boîte d’ananas au sirop remplaceront les fruits frais. Le frigo s’est vidé, ne contenant plus qu’un paquet de blancs de poulet reconstitués sous vide et un paquet de saumon fumé en tranches. Juste de quoi présenter quelques protéines accompagnées de pâtes ou de pain de mie. Que plus rien ne s’achète, que rien ne reste. Nous partons !
C’était sans compter sur les mines réjouies des deux Grands, exhibant en cette fin d’après-midi – au moment où vous croyiez être sur le point de gagner contre les cours de dessin, les cours de musique, les devoirs et le parc – leur carnet de correspondance.
Maman, Maman, il faut faire un gâteau pour vendredi pour l’école ! C’est pour vendre pour le voyage à la neige des autres CM2 !
Un gâteau. Deux enfants. DEUX gâteaux.
Une copine m’a dit un jour en résumé de sa vie familiale : on fait des gâteaux aux anniversaires et des crêpes à la chandeleur.
On assure. Il y a le quotidien et toutes les petites dates importantes qui rythment la vie des enfants. Les fruits déguisés, les truffes et la bûche de Noël, la galette des rois, les crêpes de la chandeleur, les beignets et les merveilles du mardi gras, la cueillette des fraises et les confitures en juin, la cueillette des pommes et les compotes en automne, et les anniversaires.
Ces traditions qui donnent une réalité tangible aux saisons et qui font penser aux enfants qu’on sait leur consacrer du temps. Mais, là, la maîtresse exagère. Ce n’est pas au cahier annuel des charges !
Faire un gâteau pour vendredi, veille de vacances et jour de disette, n’est pas une obligation. Faire DEUX gâteaux encore moins. Mais quel sourire plein d’enthousiasme, quel geste plein d’espoir dans leurs carnets de correspondance tendus vers moi : « VENTE DE GATEAUX ».
Comment les laisser se présenter vendredi les mains vides devant leurs camarades dont les mères au foyer auront rivalisé de savoir-faire pâtissier ?
Impossible de leur faire comprendre l’absurdité pour moi de passer un temps fou à faire deux gâteaux en y consacrant huit euros de matière première au moins, pour donner ces gâteaux gratis et ensuite acheter pour un euro la part, les gâteaux des autres mères à la sortie de l’école. Autant filer un billet de dix et être tranquille, non ?
Ce ne sera pas une tarte aux poires et aux amandes : il ne reste ni poires ni amandes. J’ai treize œufs. Cinq pour les œufs brouillés ce soir et heureusement huit pour deux quatre-quarts marbrés.
Faudra-t-il jusqu’au bout toujours nous éprouver ?
Le gâteau de la maîtresse – Partie 2 – Publié le 19 octobre 2018

8h32. Deux minutes de retard, certes, mais quelle fierté d’arriver à l’école avec deux enfants portant chacun leur gâteau pour la vente. Deux minutes de retard en plus par rapport à l’horaire habituel, mais deux gâteaux en plus par rapport à la charge habituelle.
Je les ai sortis du four à minuit ces beaux gâteaux, odorants et gonflés, tous craqués sur le dessus de leur appétissant embonpoint. Je suis enfin allée dormir en les laissant refroidir sur la table de la cuisine.
Dure journée avec les cours jusqu’à 16h30, puis un rassemblement sur le parvis avec les parents d’élèves et quelques collègues venus des lycées du coin, partageant à des degrés divers la même violence quotidienne. Depuis maintenant une année que les conflits des Cités ne respectent plus l’enceinte sacrée de l’école, depuis qu’ils s’imposent dans la cour et les salles de classe, nous cherchons les moyens d’afficher notre désaccord et notre désarroi, sans illusion.
J’avais quitté le rassemblement à 19h, mi-encouragée par notre solidarité, mi-démoralisée par notre petite bande de traînent-savates qui n’avait pas fait ralentir – ne serait-ce que par curiosité – une seule voiture sur le boulevard. Ici les manifestations sont monnaie courante.
Il y a quelques semaines à peine, nous avions attiré la télévision, la sous-préfète et la Présidente du Conseil Régional, mais l’empathie – ou la gêne – que nous avions provoquée s’est révélée moins durable que nos problèmes.
A 20h j’étais chez moi pour embrasser les enfants, manger, ranger, me doucher, et faire les gâteaux marbrés : de la levure ET des oeufs montés en neige pour deux pâtes moelleuses, l’une brune et l’autre crème, patiemment entrelacées dans deux moules.
Dure journée mais journée bien employée.
Au réveil mon premier geste avait été d’emballer pour leur transport les gâteaux marbrés, perdant ainsi quelques minutes pendant lesquelles j’aurais dû, un jour ordinaire, changer avant toute autre chose la couche du Petit. Erreur ! Explosion de caca. La couche de la nuit, déjà surchargée de pipi, déborde ! Le gosse souriant et malodorant en a jusque dans le dos et j’en étale partout en le déshabillant. Les lingettes et les cotons sont impuissants. Douche, shampoing, prélavage du pyjama et des serviettes. RETARD !
Deux minutes de retard. C’est peu. Malgré moi j’attends une récompense, des compliments, des remerciements. Une maîtresse est à la porte pour la réception des gâteaux. Elle râle : « mais qu’est-ce qu’on va faire de tous ces gâteaux ! On ne va jamais vendre tout ça et moi je ne me charge pas de tous les restes ce soir ! ». Mon sang ne fait qu’un tour. Je vois mes gâteaux s’enfoncer dans l’école avec mes enfants. Je veux les récupérer, mes beaux gâteaux gonflés envolés avec mes heures de sommeil. J’explose. La maîtresse me répond qu’il n’y avait aucune obligation Madame à faire des gâteaux et qu’elle, elle travaille et que c’est du 24h sur 24, Madame, d’organiser une vente de gâteaux et une classe de neige, et qu’elle est bien gentille d’être arrivée à l’école une demi-heure plus tôt ce matin pour ces gâteaux, Madame. Mais Madame sent une bouffée de violence venue des Cités l’envahir, et l’envie de claquer la grande gueule de cette chienne d’instite de sa mère la pute qui devrait aller apprendre la vie sur le parvis de mon lycée. Mais Madame est bien élevée et ni ne récupère ses gâteaux, ni n’accompagne leur don d’une grosse tarte dans la tronche.
Le soir, à 16h30 il n’y avait finalement pas assez de gâteaux pour tous les acheteurs enthousiastes. Les maîtresses avaient même dû détourner les pâtisseries confectionnées non pour la vente mais pour les goûters d’anniversaire fêtés ce jour comme à chaque veille de vacances. Mes deux marbrés avaient disparu et donc échappé sans doute au sort, annoncé le matin même, de la poubelle. J’ai acheté des parts pour mes enfants et pour les copains de mes enfants errant sans argent ni parents à la sortie de la classe. Et j’ai rajouté un euro pour étouffer ma faim et mon ressentiment dans une grosse part de gâteau au chocolat. Un gâteau Alsa.
Un bébé dans la tête – Partie 2 – Publié le 26 octobre 2018
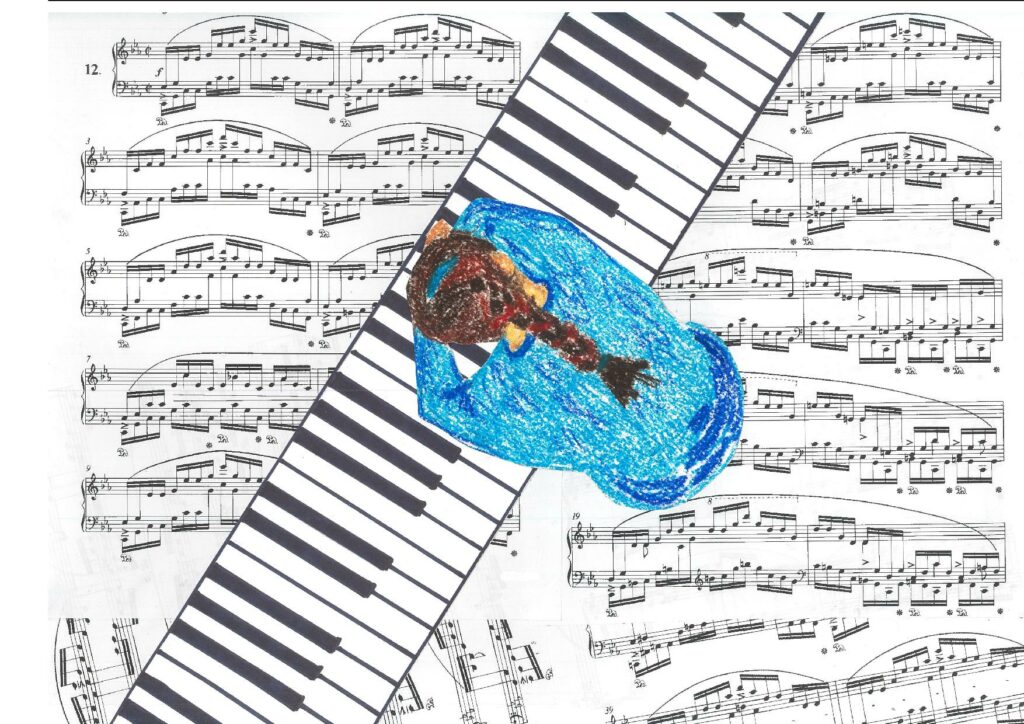
En quelle tonalité est l’étude opus 25 en ut mineur de Chopin ? En ut mineur.
Il fallait y penser.
Je me suis faite avoir sur la couleur du cheval blanc d’Henri IV.
_ Comment, vous n’arrivez pas à l’apprendre par cœur ? Etes-vous capable de la chanter dans votre tête ?
A soixante blanches par minute et huit doubles croches par blanche, non, je n’arrive pas à chanter quatre cent quatre vingt notes par minute, même dans ma tête.
_ Mais ce ne sont que des arpèges ! Il suffit d’en chanter la première et la dernière notes ! En quelles tonalités sont les arpèges de l’étude opus 25 en ut mineur de Chopin ?
Réfléchir, chanter, analyser, ou même simplement écouter.
_ Vous n’écoutez pas de musique chez vous ?
Non, parce que chez moi il y a du bruit. Toujours. Non aussi parce qu’il faudrait s’asseoir pour écouter, se poser, s’arrêter. Ecouter quoi. Pas écouter Chopin en étendant ou en repassant le linge, pas dans le bruit de la friture et de l’eau frémissante des pâtes, pas en préparant un cours ou en faisant réciter une leçon, pas quand on doit séparer deux ou trois enfants qui crient et se battent pour la possession d’un doudou qu’ils ont pourtant tous déjà en quatre exemplaires, et encore moins quand on fait tout ça à la fois.
La première fois que mes deux premiers enfants se sont mis à pleurer en même temps, je n’ai rien su faire pour arrêter le flot des cris. Désemparée, les bras ballants, j’ai compris que je venais de créer l’Enfer.
Quand je me suis présentée au professeur particulier de piano j’ai été honnête : j’étais vieille, dépassée, débordée, trop fatiguée pour réellement avancer.
Dans de telles conditions, l’étude opus 25 en ut mineur ne pouvait que s’embrouiller lentement sous mes doigts. Un résultat sans surprise, et pourtant la honte m’accable.
J’ai honte de ma tête vide quand je joue. Ai-je une opinion sur l’œuvre ? Une idée à défendre ? Une interprétation à soumettre ? Une réflexion culturelle à placer ?
Je n’ai pas trouvé la tonalité en ut mineur de l’étude en ut mineur.
Le soir, aux alentours de minuit, après avoir travaillé au lycée, rangé la maison, préparé les cartables et les vêtements du lendemain, après avoir vaincu le boulot, le métro et le dodo des enfants, j’arrache à la journée mes trente minutes de piano sur mon instrument équipé d’un casque.
Il faudrait réfléchir pour progresser.
Mais ma tête, pourtant vide et creuse à minuit, est lourde de fatigue et tombe sur le clavier. Seuls mes doigts, parfois, continuent à s’agiter un peu, sans intelligence ni conscience, dans une lutte désespérée pour garder une vie qui échapperait à la maternité.
Que sort-il de ce chapelet de notes martelées sans réflexion ?
Le navrant portrait de ma fatigue et de ma vacuité.
Etais-je aussi stupide et sans idée AVANT ?
Un bébé dans la tête – Partie 3 – Publié le 08 novembre 2018
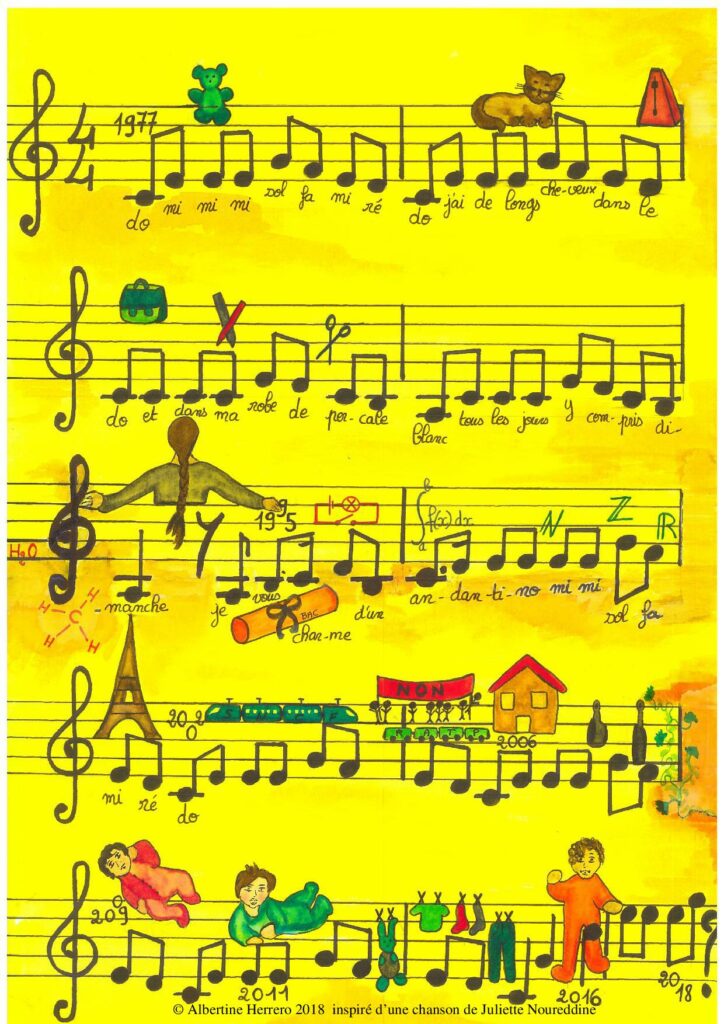
« C’est quoi un accord ? ».
Oh merde, le voilà qui remet ça.
Je viens de massacrer – comme aux deux cours précédents – l’Elégie de Rachmaninoff, mais cette fois j’ai laborieusement avancé jusqu’à la troisième page au lieu de déclarer forfait à la troisième ligne. Mon prof de piano a de la patience, des oreilles en béton, et de l’humour, malgré une pointe de découragement à me voir stagner.
Un accord c’est TROIS notes, et pas DEUX. Je m’étais faite avoir la dernière fois, mais pas aujourd’hui, faut pas exagérer. Evidemment la réponse ne s’arrête pas là, et je n’arrive pas à formuler la suite, même si je crois l’avoir comprise. J’essaie pourtant de rassembler mes neurones. Marre de perdre la face.
J’expliquais hier à mon Fils cadet la différence entre l’état gazeux et l’état liquide. A l’état liquide, les molécules du composé sont proches, elles se touchent, tandis qu’elles sont très éloignées les unes des autres, très dispersées, à l’état gazeux. Je crois que l’intérieur de mon crâne est à l’état gazeux depuis un certain nombre d’années. Je me concentre et tente : « C’est trois notes, de trois en trois, qu’on peut renverser ».
Mon cerveau ne danse pas encore la capoeira mais il vient de commencer une séance d’aquagym pour mémères molles du genou. Le prof fronce les sourcils, visiblement surpris par cette formulation non académique pour parler de trois notes réparties en « fondamentale », « tierce » et « quinte ».
Je me demande ce que je fous là. Le cours de piano mensuel qui devrait être ma détente, mon plaisir, mon jardin secret, tourne à la séance de torture. Si je n’avais pas repris le piano il y a trois ans, je ne saurais pas que je n’arrive plus à penser. Je pourrais me satisfaire du regard mi-effrayé mi-admiratif qu’on me lance quand je dis que je suis prof de maths, et de l’invariable commentaire : « OUH LA, moi j’étais nul en maths ». Parfois j’ai envie de répondre : « moi aussi ». Je me contente de sourire et de passer pour une sorte de monstre intello un peu impressionnant mais indulgent. Seul le prof de piano – confronté à mon regard bovin – doit s’interroger sur ma probable imposture.
Quand j’étais élève au conservatoire, je jouais les notes et enrobais tout ça dans un paquet de sensiblerie vague et de mouvements souples du poignet qu’on appelait « musicalité ». J’étais « très musicienne » et c’était bien.
Ce n’est plus bien. Le moulinet souple du poignet était sans doute plus séduisant à dix-huit ans qu’à quarante. Mon objectif était de retrouver mon niveau « d’avant », d’avant que j’arrête de toucher un clavier pendant vingt ans. Mais il semble que même là on ne puisse pas revenir vingt ans en arrière. Ce qu’on me demande est différent.
Plus question d’être jolie et charmante, martelant un andantino, coiffée d’une longue tresse tombant dans le dos. Je comprends que je n’ai jamais bien joué, et que la jeunesse aimable n’excuse plus l’absence d’idées.
Avant vingt ans, j’ai appris, des rythmes, des notes, des techniques et des morceaux par cœur. Entre vingt ans et trente ans j’ai passé des concours, appris des citations, des théorèmes et leurs démonstrations par cœur. J’ai appris mon métier, géré mon budget, loué puis acheté et meublé plusieurs appartements successivement. Entre trente ans et quarante ans j’ai fait des fausses couches, des fibromes et des enfants. A quarante ans maintenant, on me demande de réfléchir. OUH LA.
Formation, procréation, et si c’est encore possible, réflexion.
Certains hommes choisissent plutôt de faire : formation, réflexion, procréation.
Pourquoi pas moi ? Parce que le corps de la femme – et parfois le corps médical qui sait ce qui est bon – ne sont pas d’accord. Les dates de péremption féminines sont courtes. Réduire la formation est déconseillé et assez peu propice à la réflexion. Inverser l’ordre de la procréation et de la réflexion rend la procréation tardive difficile.
Me voici donc à quarante ans, propriétaire d’un cerveau formé à la compétition pendant vingt ans et resté inactif les vingt années suivantes dans les coulisses de la vie pratique et de la maternité.
L’ignorer et vivre dans une complaisance béate ou le remettre en marche ? Et où se cache donc l’interrupteur ?
Repassage – Publié le 13 novembre 2018

Le panier de linge à repasser déborde. Je suis heureuse quand le panier de linge à repasser déborde.
Il est tard. Les enfants dorment. Un bout de soirée s’ouvre qui me laisse libre du choix d’une activité. C’est une grande responsabilité et je ne suis pas désoeuvrée.
J’ai si bien intégré le sens du devoir maternel qu’il m’est difficile de poser mes fesses devant la télé sans culpabiliser. Il y a forcément plus utile à faire : ranger une étagère ou faire une pâte à crêpes qui – peut-être mieux que moi qui n’échappe pas souvent aux terreurs nocturnes et aux nez bouchés des gosses – reposera cette nuit. Je connais des mères qui font sauter des crêpes MAISON pour leurs enfants au petit-déjeuner. Ai-je le droit d’être moins bonne maman qu’elles ?
J’ai si bien intégré l’échelle des valeurs intellectuelles qu’il m’est difficile de rester en jachère devant une série en replay sans culpabiliser. Il y a forcément plus intelligent à faire : lire un livre, concevoir un cours merveilleux sur les fonctions, réfléchir à la structure de l’Élégie de Rachmaninov* pour contenter mon prof, ou même regarder un DVD, mais celui d’un classique en VO.
Le panier de linge à repasser qui déborde m’autorise à écarter le livre sur les croisades qui prend la poussière sur la table de chevet, le Septième sceau et mes partitions de piano.
Le visage contrit et l’âme ravie j’annonce à la ronde que ma soirée se passera à repasser.
Non vraiment, je n’ai pas besoin d’aide : le bien-être de la famille m’impose cette tâche et j’accepterai mon sort puisque mon rôle est tel et tel l’ouvrage qui m’échoit.
Je déploie la planche à repasser… devant l’ordinateur ou la télévision. Je ne pose pas mes fesses, et la douleur venant de mes jambes lourdes, plantées pourtant droites face au devoir ménager, m’absout de l’inavouable série télé que je m’apprête à dévorer.
Le grand classique du cinéma ? Non, non, un classique ça se savoure. On ne repasse pas devant un classique, on s’implique, on se concentre. Impossible de louper la moitié des images et des sous-titres d’un classique, l’œil rivé sur les plis d’une chemise à repasser. Et puis je n’entends pas le suédois.
Alors quoi ? Une série policière nord américaine ou anglaise. Anglo saxone en tout cas. Des militaires qui sauvent le monde de tous les dangers du moment, des cascades en voiture, des explosions, de l’humour et des histoires d’amour pudiques au long cours, qui – esquissées au premier épisode – mettent douze saisons à se dénouer. Des inspecteurs alcooliques mais géniaux, secondés pas des sergents plus ou moins potiches mais admiratifs, quand ce n’est pas l’inverse. Et puis des meurtres, des meurtres, des meurtres, trois ou quatre toutes les quarante-cinq minute au moins.
J’écoute la télé plus que je ne la regarde. Les yeux rivés sur les coutures de mes pantalons, je me prends parfois les pieds dans l’intrigue, d’autant plus gravement que l’acteur qui double le chef des militaires trop forts dans la série, vend souvent des voitures ou des aspirateurs dans la coupure publicitaire.
Et que dire de celle qui prête sa voix à la naine américaine capable de trucider trois terroristes d’une main tandis qu’elle tient, de l’autre, une délicate tasse de thé ? Je la retrouve, boulotte et mal fagotée, inspectrice dépressive en chef, dans des paysages grandioses et sombres du Nord de l’Angleterre.
Après une heure trente en général, les meurtres sont tous résolus, la Terre tourne un peu plus rond car les méchants ont tous perdus, les amoureux sont toujours transis et le panier de linge est vide.
Vivement les prochaines lessives.
* Voir : Un bébé dans la tête – Partie 3
Découverte buissonnière – Publié le 30 novembre 2018

Vendredi matin. L’école ouvre dans vingt minutes et les enfants ont encore la bouche pleine de leurs petits déjeuners péniblement mâchonnés. Mon téléphone sonne : c’est un message. La nounou est malade.
Je ressens comme un blanc.
La nounou n’est jamais malade, immunisée qu’elle doit être contre toutes les saloperies crachées sous son nez par tous les enfants qu’elle garde depuis quinze ans.
Mais ce matin la nounou est malade.
Un instant déstabilisée dans mon rôle d’adjudant chef matinal, j’ai oublié de crier sur les enfants pour qu’ils aillent se laver les dents. Je regarde le Petit pour lequel le brossage n’est plus si urgent. Je regarde son minuscule sac à dos qu’il est inutile de se presser de remplir des peluches préférées du jour. Mon sac est là à moi aussi, avec l’interro de dix heures et le nouveau cours sur les Suites numériques à photocopier vite en arrivant au lycée, avec le paquet de copies corrigé à l’arrache vers minuit, avec ma bouteille d’eau et ma gamelle que je préfère à la cantine, trop éloignée de mes salles de classe et trop bruyante, avec le bouquin de poche pour lire dans le métro, antidote au tripotage du téléphone, trop répandu parmi les voyageurs et trop contagieux.
Malgré ma désorganisation brouillonne, malgré ma course panique quotidienne, tout est là, prêt : tous les objets en ordre de bataille pour abattre la journée.
Inutiles.
A huit heures vingt, ma Grande et mon Moyen sont les seuls à endosser leur baluchon. Ils seront à l’école jusqu’à dix-huit heures, inscrits à l’étude dirigée d’un soir où j’aurais dû finir tard.
Je les dépose à l’école quand déboulent les derniers élèves. La porte se referme. Sur le parvis, les parents qui sont attendus quelque part se dispersent, le pas vif et le portable sur l’oreille. Devenues maîtresses du pavé, les bavardes sans profession s’agrègent en grappes de commérages. Je me sens vide. Je regarde mon Petit qui me tend les bras : « …Âlain ! ». Aujourd’hui j’ai le temps, le temps de porter, le temps de câliner, le temps des chemins buissonniers.
Nous n’irons pas au parc des nounous. Le ciel est assez clair mais l’air sent les feuilles mortes et l’humidité de novembre. J’ai envie de quitter le quartier. Quand je me gare avec mon petit passager sur le parking désert du parc départemental, mes élèves ont appris mon absence et hurlent sans doute de joie. La secrétaire du lycée m’a dit que j’avais le droit : un congé autorisé pour garde d’enfant. C’est plié. J’oublie mon sac, l’interro et les copies. Je savoure les chemins solitaires du parc, les tapis de feuilles mortes, l’air mouillé, et le silence.
L’enfant qui me donne la main sans se débattre est silencieux. L’enfant qui marche à mes côtés est calme. Sans cris, sans crachats ni morve, l’enfant respire près de moi l’automne.
Main dans la main nous rendons visite aux moutons, aux chèvres, aux lapins, aux dindons. La ferme pédagogique du parc, avec ses bâtiments de cartes postales, n’est là que pour nous. Un soigneur isolé distribue la paille et le grain.
Mon Fils boule de nerf, celui qui hurle, qui tape et qui casse, trottine là sans s’échapper, sans me défier. Je découvre qu’il sait rire, babiller, mais aussi se taire. Je découvre qu’il peut m’abandonner sa main sans lutter, jouer sans explorer les limites de ma colère.
Et de retour à la maison, nourri, fatigué, il ira dormir, boule de coton parmi les doudous sous la couette. Dans l’appartement privé des jeux et de la concurrence des autres enfants, mon Fils m’apprendra qu’il sait, au réveil, sortir de son lit en douceur, sans avoir besoin de réaffirmer à ceux qui ont veillé, sa tyrannie un instant ensommeillée. Et cet enfant unique d’un seul jour, habituellement chahuteur, dessinera, sans s’agiter ni se lasser, des ronds, des yeux, des bouches et des carrés.
Isolé, ce chef monstrueux de l’Hydre à trois têtes que j’ai fabriqué, est un enfant charmant que je ne connaissais pas.
Maman – Publié le 24 décembre 2018

Ma grande Fille me montre du doigt et demande à son plus petit frère qui joue de ses premiers mots :
_ Comment elle s’appelle ?
_ MAMAN !
Évidemment. Il y a toutes les mères qui s’appellent toutes MAMAN, toutes pareilles, et les Autres qui ont gardé leurs prénoms.
Tous mes collègues et tous mes amis savent que je m’appelle MAMAN.
Quand j’ai pris ce nom, j’ai constaté avec surprise qu’au lycée tout le monde me saluait en demandant des nouvelles de mes enfants. Comment pouvaient-ils se souvenir de leur existence ? Presque tout le monde en a, et voilà. J’ai pensé que cette étrange coutume d’en parler nécessitait sans doute une certaine réciprocité. Mais je ne me suis pas révélée très douée. De même que j’oublie tous les anniversaires de tout le monde, j’oublie les prénoms et le sexe de tous les enfants nés ou à naître. Comment certains continuent-ils à se souvenir des anniversaires de mes enfants quand je n’ai jamais pu les payer en retour, pas même en utilisant les rappels de mon téléphone ni en cochant des dates sur un calendrier punaisé dans les WC ?
Complètement nulle.
J’ai pensé que mes nouvelles relations n’avaient pas besoin de savoir que je m’appelais MAMAN.
Pourquoi faut-il alors que je dise presque toujours au bout de cinq minutes après les présentations que j’ai TROIS enfants ?
Parce que je suis à temps partiel.
Parce que j’arrive pour bosser à l’arrache à 9h30 et jamais avant.
Parce que je ne m’attarde jamais le soir, ni pour une réunion, ni pour une bière, rarement pour une manifestation.
Parce que j’ai une petite voiture et le peigne d’un poney arc en ciel en plastique dans la poche de mon manteau.
Parce que je ne peux jamais accompagner une classe au théâtre.
Parce que je veux que le gérant super beau de la cafétéria du lycée comprenne que mon sourire ne veut absolument pas dire que je suis sous son charme.
Parce que ma tresse se termine par un élastique rose pris à la va vite ce matin dans la boîte à coiffure de ma Fille.
Parce que je peux jouer du biniou en répétition le samedi matin, mais pas prolonger par des parties de fléchettes bien arrosées dans un bar ou par des fest-noz le samedi soir.
Parce que je me sens obligée de justifier par une nécessité supérieure mes traits tirés mal maquillés et mes fringues ultra confort lavables en machine et faciles à repasser.
Parce que mon orgueil m’impose d’auréoler la pauvreté de ma conversation et de mon apparence par ma richesse maternelle.
Une seule fois ces derniers mois j’ai réussi à discuter trente minutes avec l’ami d’un ami sans mettre en avant ma maternité triomphante, ni excuser par elle mon insignifiance. Je le sentais curieux cet ami, essayant de me faire parler. J’ai parlé, sans me dérober, mais pas D’EUX, et je me suis sentie déguisée. Cette omission sans conséquence m’a rappelé le jour où – visitant les jardins d’un château qui accueillait un colloque – j’avais laissé un universitaire espagnol croire que j’étais une étudiante anglaise. Quelle imposture, sans mensonge pourtant, tenant simplement à la piètre oreille du savant qui s’accommodait de mon mauvais accent.
Ai-je menti à l’ami de mon ami ? Me suis-je faite passer pour une autre femme n’existant pas plus que l’étudiante anglaise qui se promenait ? Ou ai-je, le temps d’un instant, laissé passer devant, le nom unique qui était le mien, avant MAMAN ?
Bonne année 2019 – Publié le 04 janvier 2019

La vie de parent est semée d’embûches. Il en est une qui est terrifiante : aborder le sujet de la fabrication des bébés.
Mon Fils de sept ans est curieux d’électricité. Je me préparais donc sans hâte ni conviction à affronter la question par le biais de la métaphore de la prise électrique.
Quelle ne fut pas ma joie, un soir, de voir mon Fils rentrer de l’école maternelle, illuminé d’avoir appris de sa maîtresse bénie qu’il était de ceux qui fabriquent des spermatozoïdes capables de se tortiller et de se faufiler – fuitt fuitt fuitt – pour frapper – toc toc toc – à la porte des ovules afin de construire, ensemble, des bébés. La question de savoir si cette rencontre se produisait dans la prise électrique ou ailleurs ne semblait pas chatouiller mon gamin, comblé par l’explication scientifique de l’institutrice.
Nous n’en avons plus reparlé. Nous avons oublié.
Cette année la maîtresse de CE2 a décidé à son tour d’affronter question, mais de façon expérimentale. Son idée fut d’observer en classe la fornication de quelques escargots, colocataires obligés dans une boîte en plastique douillettement tapissée de terre et de feuilles de salade. Que l’escargot soit hermaphrodite réglait sans doute le problème de la prise électrique.
Les ébats de nos gastéropodes furent féconds, mais l’histoire ne dit pas s’ils eurent lieu – ou non – sur le temps scolaire entre deux soustractions.
Hélas, l’escargot scolaire a saboté sa mission d’éducation en programmant la naissance de sa descendance pour le 29 décembre, date à laquelle les enfants – en vacances – ne seraient plus dans la classe pour coller leur nez sur les parois de la boîte en plastique et observer l’éclosion, mille fois plus passionnante que toutes les soustractions. C’est ainsi que j’ai vu mon Fils et tous ses camarades sortir de l’école le soir du vendredi 21 décembre tenant chacun un pot de yaourt en verre sans couvercle, rempli d’une poignée de terre et de grappes entières d’œufs blanchâtres agglutinés.
Nous avons préparé le pot pour partir en voyage avec nous le lendemain. Puis nous l’avons oublié.
Nous sommes rentrés une semaine après. Au dîner mon Fils de sept ans me demande :
_ On est quel jour Maman ?
_ Le 29 décembre pourquoi ?
_ Mais les escargots sont nés alors !
M… Les escargots sur l’étagère depuis huit jours. Oubliés. Sur la poignée de terre. Sans couvercle.
Tout m’a semblé tout à coup grouillant d’escargots éclos : l’étagère, le sol, mon assiette.
Par chance les grappes d’œufs légèrement jaunis, plus répugnants encore qu’avant, semblaient juste avoir migré sur le verre en direction du col du pot, mais quelques millimètres, et je pensais quelques heures, nous séparaient encore de l’invasion. Les enfants ont collé leur nez sur la paroi. Au milieu de mon dessert deux tentacules ont jailli et ce fut l’explosion : ils sont nés, ils sont nés ! Les deux Grands sautaient et criaient d’excitation tandis que le Petit – mon Fils le dernier né – hurlait et touchait son nez, terrifié que plein de nez puissent ainsi sortir de terre.
Je me croyais transportée trois ans plus tôt dans la maternité, à l’époque de mon dernier accouchement, quand la sage femme paniquée rameutée par mes cris – il est né, il est né – avait attrapé au vol l’enfant glissant et pressé qui avait décidé que vingt minutes et deux contractions étaient bien suffisantes pour se barrer.
Depuis les escargots nouveaux nés sont dans une barquette fermée. Ils cherchent à s’échapper. La maîtresse disait de ne pas s’en occuper, mais j’ai le devoir de chouchouter mes quarante-cinq bébés. Oui, je les ai comptés*. Je les aère, les arrose. Habituée des couches de mon Dernier – qui se touche encore le nez chaque fois qu’il les voit – je nettoie leurs déjections. Je remplace les feuilles de salades baveuses et trouées par des feuilles fraîches du marché.
Les jeunes escargots à la coquille encore transparente, gavés de feuilles, sont verts de trop manger.
Ils grossissent. Et si ces bébés étaient des gremlins ?
Lundi à la maîtresse je donnerai ces bestioles enveloppées de tous mes vœux de Bonne Année.
* Voir : Rentrée des classes septembre 2018
Chrysalide – Publié le 17 janvier 2019

Dans le parc sous mes fenêtres, des engins ont travaillé toute la nuit. On a entendu casser, entasser, jeter, claquer, bipper. Il est sept heures, et dans l’obscurité trouée par les arbres de lumière du village de Noël, un semi-remorque remonte en direction de la sortie principale, l’allée qui longe mon immeuble.
Ainsi disparaît la patinoire de Noël. Pendant plusieurs nuits les ouvriers ont démonté le chalet, tombé les barrières, décloué le parquet sous la glace qu’ils avaient brisée.
Pendant trois semaines tout le quartier a glissé en rond sur la patinoire de Noël. Engourdie par le froid, je restais là, au bord, à regarder ma Grande Fille patiner, d’abord dix minutes hésitantes, puis plus d’une heure chaque matin. Ma Grande Fille de dix ans en manteau rose, aussi Grande que moi avec ses patins. Ma Grande Fille coiffée d’un casque de vélo bleu parce qu’elle a grandi si vite que son équilibre n’a pas suivi et qu’elle tombe souvent sur la tête.
Quand ma Grande Fille était Petite Fille à l’école maternelle d’un quartier plus jaloux que celui dans lequel je vis maintenant, les mères, l’œil noir et le teint vert, glissaient d’un ton soupçonneux : « pourquoi est-elle si grande cette petite ? ». Je répondais qu’elle tenait de sa mère. Je suis minuscule. Que pouvaient-elles penser ? Que je l’avais adoptée ? Que je ne la méritais pas ? Que je l’arrosais d’engrais dans son lit ? N’est-ce pas là, la chose sur laquelle je n’avais aucune prise : la taille de ma Fille ?
Pendant trois semaines au Village de Noël, j’ai passé mon écharpe, mon bonnet, mes mitaines, et j’ai regardé ma Fille patiner. Pour une fois tout le quartier était là. Une mère hilare et obèse, chaussée de patins, jambes nues en robe de laine, s’accrochait aux barrières pour accompagner, et poursuivre de ses rires, ses deux fils qui, eux aussi découvraient la glace, mais s’y mouvaient déjà. Les enfants des cadres en congé de leurs écoles privées, tournaient avec les enfants des Centres de loisir du quartier, et se rappelaient qu’ils se connaissaient déjà, d’une année parfois de Maternelle, avant que leurs destins – public/privé – ne soient séparés. Une bande de collègues était descendue des bureaux environnants. Quatre ou cinq commerciaux restés sur le bord, en encourageaient trois autres sur la patinoire : deux experts de la glisse qui soutenaient le troisième en cravate, gants de cuir et manteau de cachemire, pour le maintenir, ou tomber lourdement avec lui. Cette équipe riait et chutait devant moi, aidée maladroitement parfois, et jusqu’à la bousculade, par un éducateur de la Ville, un père et un presque octogénaire portant beau qui me demandait entre deux figures de glisse et de style si partir avec lui sur une île déserte, là tout de suite au sortir de la piste, ne me tenterait pas.
Une mère et sa fille adolescente, deux silhouettes filiformes, vêtues du même jean et du même blouson bombers blanc à capuche, glissaient main dans la main, identiques de loin. Était-ce donc ça la fameuse relation fusionnelle mère-fille ?
Ma Fille au début maladroite évoluait près d’elles dans une posture un peu raide de gamine prudente : ma Godichette qui prenait seule de l’assurance et que j’étais heureuse de ne pas tenir par la main.
Et je souriais, glacée mais amusée, par la vision de ma Fille à chaque tour plus rapide et ravie, par la conversation du vieux Monsieur qui me parlait de sa jeunesse quand il avait plus que mon âge, par le cantonnier chenu, appuyé sur son râteau, qui nous observait, étonné qu’un homme de cet âge puisse patiner, et par le spectacle du troisième commercial agrippant pour ne pas tomber, les cornes de rêne au nez rouge d’un traîneau pour enfants.
Ce matin, la patinoire démontée quitte la Ville. Ses barrières, ses planches et ses palettes ficelées sur la remorque du camion empruntent, avant l’arrivée des joggeurs, l’allée du parc.
Fière de sa réussite à glisser, ma Grande Fille de dix ans qui chaussait des patins taille 38, a encore grandi. Assise au milieu de toutes ses peluches, à quelques mètres derrière moi qui regarde par la fenêtre le parc avant le lever du jour, elle peine à enfiler ses vêtements de pré-ado – jean serré, soutif et chemisier. Sans doute l’année prochaine, sur la patinoire de Noël, ne voudra-t-elle plus porter le casque à vélo bleu qui protégeait sa tête d’enfant des pertes d’équilibre d’un corps précoce et tout juste découvert, de jeune fille.
À la table des escargots – Publié le 01 février 2019

En allant dire Bonne nuit à ma Fille, je la trouve plongée dans la lecture d’un magazine tendance familles bobos qui mangent bio et recyclent leurs épluchures. L’article promeut le remplacement du porte-parapluie dans l’entrée de l’appartement par un composteur maison. Je tique sur le titre : « Comment élever des vers de terre ».
Ah non ! Ras le bol des bestioles !
Les œufs d’escargots pondus en classe dans l’élevage pédagogique de la maîtresse de CE1, et rapportés à la maison pour les vacances de Noël par mon Fils le Moyen, ont éclos le 29 décembre mais ils ne sont pas retournés à l’école en janvier*.
Ils le devaient pourtant. Hélas les promesses orales n’engagent que les mères crédules. Mes enfants s’inquiétaient d’abandonner ces remuantes petites crottes de nez, et la maîtresse n’en voulait plus. Sur les quelques huit cents œufs qu’avaient pondu les huit escargots adultes de la classe, certains nouveaux nés étaient morts de faim, certains avaient été relâchés par cinq degrés dans des jardins d’immeubles et des ronds points, d’autres perdus peut-être dans des plantes vertes ou noyés dans l’évier. Mais ceux qui comme les miens, vivaient, mangeaient et déféquaient, étaient déjà trop nombreux.
Parmi la multitude de sites Internet proposant de soigner les escargots à l’ail, au persil ou à la bordelaise, je suis tombée sur une page consacrée au bonheur de l’escargot de compagnie. Même si le bonheur de quarante-quatre escargots captifs d’une boîte en plastique spéciale micro-onde m’est difficilement concevable, je m’y réfère souvent.
Mes deux plus Grands Enfants ont vite oublié leurs bébés baveux qu’il faut nourrir, doucher, nettoyer et décrotter tous les deux jours. Mon Fils le Petit réclame souvent la boîte aux escargots. Pour ma plus grande frayeur, il sait transporter et escalader des tabourets afin d’aller la chercher. Nous la posons alors sur la table de la cuisine ou du salon, et nous la regardons. Tête contre tête au-dessus des bébêtes. Lequel de ces escargots s’appelle Kit Kat me demande le Petit, pressé de reconnaître SON escargot domestique : celui qu’il choisira quand nous relâcherons les autres au printemps ? Celui qui pourra vivre de cinq à dix ans s’il est heureux, douché, nettoyé et décrotté tous les deux jours. Où est la salade ? Est-ce du chou ? Mangent-ils le poireau, la carotte et la courge butternut ? Et la coquille d’œuf ? Pourquoi le caca est-il orange aujourd’hui quand il était vert hier ? Les interrogations sont réelles, les exclamations aigues et les conversations de plus en plus touffues.
Je me prends au jeu. Vont-ils bien ? Sont-ils propres ? Ont-ils de l’eau, de l’air, de la nourriture ?
Ils sont près de la fenêtre de la cuisine, dans une boîte fermée. Ont-ils été choqués quand j’ai fait frire de grosses crevettes sous leurs tentacules oculaires ? Si l’escargot de compagnie peut expérimenter le bonheur – d’après le site Internet qui ne les met pas à l’ail et au persil – peut-il ressentir de la peur au spectacle de ses consœurs comme lui pourvues de carapaces : ces gambas rougissant dans l’huile d’olive ?
Petit à petit, dans le silence de leur boîte fermée sous la fenêtre, les gastéropodes vivaces et voraces ont pris le contrôle de la cuisine. Ils dictent les menus. Quels sont leurs goûts ? Doit-on varier leur alimentation ?
Faut-il de la salade ? Nous mangerons une quiche garnie de laitue. Ont-ils faim de carottes et d’une tranche de butternut ? Je servirai de la soupe. La promesse de céleri rave les met-elle en transe gustative ? Une purée fera l’affaire. Du chou peut-il leur évoquer une promenade d’hiver au potager ? J’opte pour un chou farci.
Mon chou vert, bourré à éclater de farce, mijote depuis des heures. Tous nos vêtements sentent le chou. Les manteaux pendus dans l’entrée. Le linge propre oublié dans la machine à laver. Mon pull, mes cheveux. Pour quelques feuilles mises de côtés crues, les feuilles cuites exhalent jusque dans les armoires et les parures de lit, l’élégant parfum du dimethylsulfure.
Nous sentirons le chou pendant des jours. Mais les escargots au jardin ne sont-ils pas souvent représentés, dessinés ou photographiés, sur une feuille de chou ? L’odeur n’est-elle que le prix à payer pour leur bonheur ?
Et pourtant les feuilles de chou réservées pour mes protégés, crues, offertes dans la barquette, resteront entières. Car le saviez-vous ? Mes escargots n’aiment pas le chou.
* Voir Bonne année Janvier 2019
La loose – Publié le 15 février 2019

Le jeudi soir c’est conservatoire.
Cours de flûte. A la sortie de l’école il faut courir avec l’instrument, les partitions et le goûter de mon Fils le Moyen. Et courir avec la poussette, les doudous et les gommettes de mon Fils le Petit, qui suit.
J’ai oublié la cape de pluie de la poussette. Le temps était sec et ensoleillé toute la journée. Un temps presque printanier. Alors pourquoi le ciel – balançant entre Noël blanc et giboulées de mars – crève-t-il en averse de neige à 16h35, juste sur nous qui pressons le pas dans la rue perpendiculaire aux deux rues de l’école et du conservatoire dont on déduit qu’elles sont parallèles ? Immobile, en première ligne face au vent et plus exposé qu’en marchant, le Petit dans sa poussette mange tous les flocons. Bientôt le nounours qu’il sert contre son visage sera bonhomme de neige, et les passants regardent ce pauvre enfant mené par sa mère sans cœur ni cape, comme un bouclier contre la tempête.
Essoufflés, chargés, mouillés, nous poussons enfin la porte du conservatoire dans le hall duquel je déverse mes enfants et mes bagages. Le remue-ménage hebdomadaire s’engage. Il s’agit de planquer la poussette dans un espace réduit prévu à cet effet sous un escalier, d’en sortir le bébé engoncé dans ses sangles, son écharpe et son bonnet, et de le remplacer sur le siège par le cartable, lourd et inutile. Puis vient l’enjeu d’extirper du panier placé entre les quatre roues, le sac de flûte, forcément coincé, tout ça assez rapidement pour que le Petit, libéré et désormais sans contrôle, ne coure pas, riant et tapant des pieds vers l’ascenseur trop marrant qui pourrait bien lui coincer les doigts ou l’avaler.
Mon Fils le Moyen a rattrapé, criant et tapant des pieds, son frère le Petit avant que ne se referment les crocs de l’ascenseur. Ils se sont battus pour appuyer sur le bouton extérieur, puis sur les boutons intérieurs, et pour rendre plus drôle le jeu des boutons, nous nous arrêterons à tous les étages. Je me recroqueville de honte sous les regards contrariés des autres usagers du monte-charge, devenu omnibus par la faute de mes enfants pousseurs de boutons.
Enfin je confie le Moyen à son professeur. Il est entré en oubliant de frapper. Il a oublié de dire bonjour, mais la porte sur lui s’est refermée. Il est parqué. La mère dépassée que je suis regarde le Dernier : Zozo Minus, enfant unique pour une demi-heure, accroché à ma main. Comme chaque jeudi nous descendons les quatre étages par l’escalier de service, le plus sombre du bâtiment, peint en rouge et tout juste éclairé de veilleuses. Ouh Ouh Ouh fait Zozo Minus en descendant les marches : « il est où Loup ? ».
Mais la tanière du loup n’occupera pas les trente minutes du cours de flûte. Nous filons discrètement du conservatoire, abandonnant sous l’escalier poussette, cartable et doudou mouillé. Direction la boulangerie.
La boulangerie est fermée pour travaux.
Je contemple, un instant idiote sous un temps de nouveau clément, les panneaux de bois masquant la devanture de la boutique. Il faut trouver un but au Petit. Je décide brusquement que j’ai besoin de pommes. Celles de ce quartier sont si bon marché que j’en achète plusieurs kilos, mais Zozo Minus, lassé de marcher veut monter sur mon dos. En le hissant sur mes épaules, j’explose ma barrette à cheveux qui tombe dans le caniveau.
De retour au conservatoire – échevelée, courbée, cassée, courbaturée sous le poids du bébé – j’essaie de ranger les pommes qui refusent de rentrer dans le panier entre les quatre roues de la poussette. Certaines tombent et roulent. Le Petit court. Le sac de la flûte de retour du cours n’a plus de place. Le Moyen veut faire pipi. Je me débats, accroupie, épuisée, incapable de me relever. Sur le point de lamentablement tomber sur les fesses au milieu des pommes qui roulent sans rien amasser d’autre que de la saleté, je découvre qu’une copine, digne sur ses deux jambes et l’œil amusé, m’observe depuis quelques minutes. Tu feras de la compote, me dit-elle.
Mais pourquoi les autres mères, elles, s’en sortent ?
Les pommes tombées, pleines d’ecchymoses, ne se conserveront pas longtemps. Ridicule et vexée, je ne ferai pas de compote. Par esprit de contradiction je ferai des pommes au miel. Ce soir. Plus tard.
Il est grand temps de rentrer. Penser aux devoirs, au dîner, aux bains et au violon que ma Grande n’a pas encore travaillé. Sur le chemin, presque devant chez nous, le nounours tombera sur la chaussée, ramassé par un motard.
La loose du jeudi soir.
Gynécée d’anniversaire – Publié le 02 mars 2019

Ce matin de bonne heure, je croise une Voisine sur le chemin de la boulangerie : « Alors ! Vous ne le fêtez pas cette année, l’anniversaire de votre Grande ? ».
Cette Voisine est championne des anniversaires. Celui de ma Grande est passé d’un mois déjà, mais le jour dit, à quatre heures du matin, Voisine m’avait envoyé un SMS – sonore – de bon anniversaire. Pour être la Première ?
Quand on fait les choses bien, l’anniversaire d’un enfant se fête dans l’intimité du foyer resserré, dans la classe, à la maison avec les copains et en Province avec papi-mamie. Les anniversaires de trois enfants devraient donc se célébrer douze fois.
La Wonder Mother que j’étais l’a fait. Et puis j’y ai renoncé. J’ai renoncé à me croire obligée d’inviter les copains à la maison, de même que j’ai renoncé à me croire obligée d’adopter un chat, d’emmener mes enfants skier et d’aller avec eux à Disney. J’ai tué Wonder Mother. Elle était invivable.
« Alors ! Vous ne le fêtez pas cette année, l’anniversaire de votre Grande ? ». Et ben Non. Ni celui de la Grande, ni celui du Moyen, ni encore moins celui du Petit qui n’y comprend rien. Pas avec les copains du moins.
La fête d’anniversaire est bien loin d’être un événement ponctuel, dont l’organisation se limiterait à la confection d’un gros gâteau au chocolat, à l’achat de bonbons, gommettes et cotillons, et qui se terminerait dans l’éclatement des derniers ballons.
La fête d’anniversaire est un événement générateur d’ondes sociales dans le quartier, qui se cristallise en nœud du maillage complexe, sensible mais invisible, des relations de voisinage.
Dès l’école maternelle, arrivent le matin, des poignées d’enveloppes colorées : les INVITATIONS. Le samedi vers 14 heures, les rues s’emplissent d’enfants bien habillés, parfois de princesses aux cheveux pailletés. Ils sont beaux et portent des paquets cadeaux. Le soir vers 18 heures, les mêmes envahiront de nouveau les rues, plus fatigués, grimés, leurs beaux atours tâchés de coca et de chocolat, rapportant à la maison des trésors de ballons et de sacs à bonbons.
Ma Fille recevait souvent de ces très convoitées cartes décorées. Bonne camarade, les enfants l’aimaient. Bonne élève, les parents la cultivaient comme relation pour leurs rejetons. On a si peur – même à quatre ans – des mauvaises fréquentations ! Et voilà que seule de la classe elle était invitée dans toutes les castes. Comme il me fallait rendre la politesse à tous ces voisins disparates, la liste de mes invités est devenue le casse-tête d’une diplomatie locale complexe. Quels groupes sociaux pouvaient partager le même gâteau ?
Mon Fils, solitaire, vivant souvent de la compagnie de ses propres histoires imaginaires, ne recevait jamais de ces invitations. Je voyais sa déception devant les enveloppes qu’on ne lui tendait pas. De tristesse et par stratégie pour lui, j’ai fêté et invité, pour qu’en retour il soit convié. J’ai forcé le réseau. Mais les fêtes d’anniversaire ont changé.
Quelqu’un a eu l’idée un jour de louer une salle et d’inviter toute une classe à l’anniversaire. Pour ne pas être en reste quelqu’un d’autre a loué la même salle et invité toutes les filles de DEUX classes. La surenchère a commencé.
La salle a vu défiler tous les anniversaires du quartier. Elle est devenue gynécée. Domaine des mères qui prenaient les enfants mais refoulaient les pères à l’entrée. La salle accueillait les fratries des jeunes invités, s’emplissait de poussettes, de robes de princesses et de robes traditionnelles. La fête prévue jusqu’à 17 heures se poursuivait jusqu’à 20 heures au milieu des jus renversés, des collants déchirés et des odeurs de sueur.
Horrifiée par cette danse, obligée de rendre cinquante invitations là où dix avant me semblaient déjà insurmontables, j’ai tout arrêté, rejetant à égalité tous les beaux enfants déguisés et maquillés du samedi. J’ai argué de mon incapacité à m’organiser, je me suis humiliée comme mère vraiment dépassée. Ne suis-je pas la « Gauría »*, la française trop formée à l’université, mais restée une enfant ignorante et démunie face aux exigences de sa famille et de son foyer ?
Les invitations ont diminué. Les popularités de mes enfants se sont équilibrées. Leurs choix ont émergé. En même temps, d’une rue à l’autre ou sur un même pallier les camps se sont affirmés. Le réseau du quartier s’est fracturé en petites unités. Mais dans chaque maillage propre, qu’on y parle chansons à la mode ou progrès des enfants au conservatoire, la fête d’anniversaire reste un gynécée dans lequel on s’observe, estimant la valeur des cadeaux, comparant les beautés et les aptitudes des enfants, se souriant, se jaugeant tout en s’offrant des parts de gâteaux glacés au chocolat, couverts d’étoiles en sucre et de fraises tagadas.
*Gauría : la française, ou la gauloise (transcription de l’oral que je fais d’un mot d’un dialecte algérien).
Lâcher d’escargots – Publié le 07 mars 2019

Les yeux dans les tentacules oculaires, je m’adresse à l’escargot qui pointe sa tête hors de la barquette ouverte : « toi et tes copains vous voulez vous barrer, c’est ça ? ».
Quarante-cinq œufs d’escargots rapportés de l’école par mon Fils le Moyen, éclos le 29 décembre à la maison. Quarante-quatre ont survécu. Leurs coquilles mesurent à présent deux centimètres de diamètre. Quand je les douche dans leur passoire personnelle, leurs lignes brunes brillent de reflets dorés. Les barquettes – une petite, puis une grande, puis trois grandes – se salissent vite d’excréments, de mucus et de végétaux rongés. Répartis en deux boîtes de vingt bestiaux et une boîte « hôpital » pour quatre gastéropodes fragiles aux coquilles fêlées, ils semblent me dire que les prémisses du printemps rendent intolérable cette surpopulation en récipients micro-ondables. Le monde extérieur est-il encore trop froid et trop dangereux ? Mais est-ce que je sais d’abord – plaide mon interlocuteur baveux – ce que recèlent de poisons leurs maisons de polypropylène, depuis les pesticides dans les feuilles de salades jusqu’aux perturbateurs endocriniens dans les parois ? D’accord, mais pas question de mettre dehors une bombe écologique. Peut-on relâcher des escargots d’élevage sans précautions ?
Sur Internet, les sites pour maîtresses d’école, vantent le super kit d’escargots reproducteurs à 35€ offre spéciale réservée aux enseignants seulement (qui d’autre en voudrait ?). Ils invitent sans façons le prof à libérer les petits dans la nature, observation faite dans la classe du coït, de la ponte et de l’éclosion. M’aurait étonné qu’ils proposent de les servir à la cantine, promouvant ainsi une économie supplémentaire pour toute la communauté scolaire.
D’autres sites m’affolent. Photos terrifiantes à l’appui, des journalistes relatent les dégâts causés par des escargots géants à Miami – fléau tenace parachuté d’un autre continent – grands comme une main et dévorant tout : cultures, crépi des maisons et dollars par millions dépensés pour leur éradication. Je regarde mon copain gluant de travers. Toi mon pote, t’as pas intérêt à devenir aussi grand que la passoire, ou tu vas finir en rôti pour dix, cuisiné au beurre et au persil.
Coupant Internet, j’envoie un message à une copine soigneuse animalière. Elle a réintroduit des gibbons dans les forêts de Bornéo, elle doit pouvoir gérer mes escargots. Les gros gris sont français me dit-elle. Tu peux les lâcher. Elle se marre. Mais évite le bord de mer, c’est trop salé ! Moins salé que la marmite dans laquelle ils pourraient bouillir si je finis par en avoir assez de nettoyer leurs crottes. D’ailleurs les enfants ne veulent pas les abandonner dans un fossé près d’une route de peur qu’ils ne soient écrasés, et je n’ai pas très envie de m’aventurer dans un champ du marais. Mieux vaut un peu trop de sel que du plomb dans les fesses si le propriétaire se révèle peu ouvert à la réintroduction d’une espèce sauvage dans ses pâturages. Vas lui expliquer, toi, que tout ça c’est à cause de la maîtresse de CE1.
Ce sera donc le bord de mer, la dune grise, en retrait de la plage, là où poussent les premiers végétaux : Oyat, Pourpier, Panicaut. Je me rappelle avoir vu des escargots petits gris dans ces paysages. Les gros gris ne sont pas vraiment français, mais cousins des petits gris locaux. Ils sont déjà présents et adaptés dans nos régions. Comme mes enfants finalement : d’origine nord-africaine, mais nés en petite couronne parisienne et tous prêts à être heureux sur la côte vendéenne. D’ailleurs ma Fille s’est écriée : « Trop chanceux les escargots ! Ils seront toujours en vacances ! ».
La pluie menace. Nous préparons l’expédition. Les mômes ont décidé de garder quatre spécimens. Difficile de dire si c’est une chance ou une malchance pour eux. Quatre bestioles : un chacun, plus un machin chétif, l’individu génétiquement débile de la portée : un escargot qui refuse de grandir et perd régulièrement des morceaux de sa coquille malgré tous les os de seiche qu’on lui donne en cure de calcium à grignoter. Mon Fils le Moyen ne veut pas abandonner aux hérissons l’avorton. Une empathie venue peut-être de ses premières semaines de vie en couveuse.
Sac d’escargots sur le dos, nous empruntons le chemin côtier, désert. Le ciel est chargé, la lumière rasante. Le vent se lève. Au bord du sentier, loin, je trouve la preuve que les cousins vivent là : outre les nombreux restes d’escargots blancs des dunes, je vois dans le sable des coquilles vides mais adultes de petit gris. Je les montre, victorieuse, à mes enfants. A quelques instants de se séparer de leurs bébés, ils se montrent un peu réticents. Ces escargots sont morts me disent-ils ! Certes, mais ceux-là ne viennent ni d’un reste de pique-nique ni d’un kit pédagogique vendu sur Internet à une classe de CE1 qui passerait par là. Je me sens biologiste en pleine démonstration scientifique : ces escargots ont vécu et grandi ici sans main secourable pourvoyeuse de salade ! Ce milieu leur est donc favorable.
Rassurés nous déposons vingt escargots dans une dépression du terrain pleine d’herbe grasse à droite du chemin, côté campagne, et nous envoyons les vingt autres vers la partie gauche du chemin, côté océan, une partie protégée de la dune, interdite d’accès aux promeneurs chaussés de lourdes godasses assassines, briseuses de coquilles.
Il pleut. Un vrai temps d’escargots. Nous rebroussons chemin, sûrs d’avoir fait les bons choix. Et pourtant, quand mon Petit se retourne et lance vers la lande immense : « Oua-oir cagots », les grands sentent presque frémir une petite larme qui pourrait se mêler à la pluie.

Les épices – Publié le 30 avril 2019
A l’école il y a : les mères qui travaillent, les mères qui ne travaillent pas et les nounous dont la place est celle du chaînon manquant.
Les mères qui travaillent disent qu’elles aimeraient bien moins travailler mais qu’elles ne peuvent rien y changer à cause des prix de l’immobilier et pour leur indispensable sociabilité. Les mères qui ne travaillent pas disent qu’elles aimeraient bien travailler mais elles se drapent dans leur maternité et leurs obligations de femmes mariées pour expliquer qu’elles ne peuvent rien y changer.
Entre les deux, les nounous de mon quartier restent au foyer comme les mères qui ne travaillent pas, tout en prenant en charge de 8h à 17h pour 4,11€ net par enfant de l’heure plus les indemnités et les congés payés, la maternité des mères qui travaillent.
Les mères qui travaillent gagnent plus que 4,11€ de l’heure plus les indemnités, les congés payés et les temps de trajet, car sinon elles cesseraient de travailler. Elles sont donc diplômées.
Les nounous et les mères qui travaillent ont en commun d’avoir un salaire et des ambitions immobilières.
Les nounous et les mères qui ne travaillent pas ont en commun de ne pas quitter leurs pénates et d’être fières de leurs compétences domestiques et culinaires.
Les mères diplômées qui travaillent ne peuvent pas être sans faille. Il faut équilibrer. L’hypertrophie de la partie diplômée de leur cerveau doit forcément avoir bouffé la place d’autres compétences dans leur boîte crânienne puisque celle-ci est visiblement de taille normale.
En tant que mère diplômée, il est donc admis que je fais mal la cuisine. Aucune preuve, démonstration, contre exemple n’est demandé et ne pourrait là non plus rien y changer. C’est ce qu’on appelle en mathématiques un postulat : aussi vrai que deux droites parallèles non confondues ne se rencontrent jamais. C’est-à-dire que ce n’est pas universellement vrai et que ça peut même être faux puisque dans un dessin en perspective deux droites parallèles non confondues se rencontrent au point de fuite, mais c’est une assertion fondamentale sur laquelle se construit un système acceptable par tous sur un plan dénué de toute perspective. Au collège deux droites parallèles non confondues ne se rencontrent pas. Dans mon quartier une mère « française » diplômée ne sait pas cuisiner.
Il en va de l’obligation physiologique susdite, mais aussi du fait que pour les nounous et les femmes au foyer de mon quartier, la cuisine française ce n’est pas la gastronomie étoilée mondialement renommée que vous imaginez, c’est LA BOUFFE DE LA CANTINE.
Vous pensez Vatel, Michelin et Top chef ? Mes voisines pensent ravioli en boîte, légumes surgelés mollissant dans la béchamel et bourguignon gélatineux sous vide nageant dans une sauce aux épaississants chimiques. Les traditions culinaires séculaires que vous croyiez incontestées se résument, pour ces bonnes mères, aux bouillies fadasses de la restauration scolaire.
La gastronomie française est aussi étrangère et inimaginable à ces mères, que la cantine l’est à nos dirigeants qui annoncent dans tous les médias le déjeuner des écoliers à un euro comme un progrès social et une nouveauté. Ils paraissent ignorer que de nombreuses familles vivant à moins de 10 km du palais présidentiel paient le plateau quotidien de la tambouille des réfectoires moins cher que l’euro qui n’est symbolique que pour eux.
Il faut mettre des épices me disent les mères des copines de ma fille.
Et pourquoi mon Fils le Petit mange-t-il si bien chez sa nounou ? Parce qu’il y a des épices me dit-elle.
Le chou fleur ? En tajine avec des épices.
Les carottes râpées ? Assaisonnées à l’orientale avec des épices.
Les lentilles ? Les pois cassés ? En ragoût, en purées, avec des épices.
Chaque soir je ramène à la maison un bébé repu, benaise*, et épicé. Le week-end à la maison, quand avec appétit il finit son assiette, mon mari me demande : « Tu avais mis des épices ? »
Croyez que si je n’avais pas envie de rire, les épices m’en pourraient monter au nez
* »Bien aise » dans le vocabulaire charentais de ma grand-mère maternelle.
Dimanche au parc – Publié le 12 mai 2019

Il est 17 heures et je vais chercher ma fille au parc. Elle fête un anniversaire.
Collée de mes deux garçons heureux d’une sortie supplémentaire, je suis contrariée. Je n’aime pas le parc surpeuplé de l’après-midi.
Le rendez-vous est au parc secondaire de la ville. Pas le grand parc des quelques rares cartes postales locales. Pas le parc principal, vitrine de la municipalité avec ses arbres centenaires et ses balançoires à nacelles.
Le parc secondaire n’est connu que des riverains. Il est un peu notre jardin. Attenant à la cour de l’école publique, entouré de logements sociaux depuis peu concurrencés par quelques constructions privées, il voit descendre tous les voisins de toutes les cages d’escaliers aux premiers soleils printaniers.
Je retrouve ma fille sur la pelouse. Les dix enfants invités à la fête de sont multipliés de tous les copains descendus jouer. On a sorti les tables de pique-nique. Les mères ont étendu des couvertures. On s’assoie, on fait des cercles, on discute, on salue les nouvelles arrivantes. Le goûter d’anniversaire n’en finit pas de régaler tout le quartier. Les enfants qui n’ont jamais été invités se pressent autour des parts de gâteaux au chocolat, des chips et des sucettes. Tout le monde repart gavés, les mains collées de sucre et de sel.
Mon fils le Petit a repéré un ballon et un trotteur. Il fonce, court, m’échappe.
Mon fils le Moyen est accueilli par les cris de joie et de bienvenue des enfants de sa classe. Lui qui se dit persécuté et rejeté à l’école rejoint pourtant la partie de balle au prisonnier des gamins qui semblent finalement tous l’aimer bien.
Inutile de vouloir prendre ma fille sous le bras pour rentrer à la maison. Nous ne quittons pas l’anniversaire : c’est lui qui nous happe. Mal à l’aise je lance quelques « bonjour » aux femmes assises dans l’herbe. Je ne suis pas de leur bande. Elles me sourient et me tolèrent sans pour autant m’inviter à les rejoindre.
Seule adulte debout au milieu de l’étendue verte, plantée comme une vigie, je ne quitte pas des yeux mon Petit qui galope et pique tous les ballons avec un bonheur inexprimable. Les copains de l’école accueillent l’empoisonnant petit frère avec l’habitude des grandes fratries.
Je suis inquiète, impatiente de filer, agacée. Stressée, j’imagine toujours qu’un de mes enfants va s’envoler, disparaître, avalé par un tronc d’arbre ou kidnappé par une corneille.
Près de moi les mères ont mutualisé tous leurs mômes et semblent compter sur l’attraction du groupe pour qu’aucun ne s’échappe. De temps en temps une tête se dresse et un cri maternel rappelle à l’ordre un mioche un peu trop téméraire. Toutes sont les mères de tous.
Je reste. Je suis ennuyée mais fascinée par cette vie de quartier que je n’ai connue que dans les livres et les films. Un goût de Guerre des boutons en couleur, de galopins italiens des années soixante s’égayant dans les rues. Je suis heureuse de voir mes enfants y participer, jouer, courir, bouffer et se rouler par terre, pleins de santé.
Soudain l’ambiance change. Des cris s’élèvent. Toutes les mères dressent la tête. La masse des gosses, petits et grands se déplace vers un autre parterre. Je retiens les miens. C’est la bagarre. D’autres gamins descendus là sans parents, libres de mouvements et de connerie s’insultent et se frappent. Je reconnais un élève de la classe de ma fille : un grand bébé à sa maman toujours acteur de bêtises de moins en moins enfantines. Des grands interviennent. Tout le monde s’offusque et s’en mêle. Les deux camps sont séparés mais l’un des gamins, une crevette agressive m’arrivant aux aisselles, se retourne et crie sur la mère qui organisait l’anniversaire : « Oh, t’es qui toi pour me parler ! Vas-y, tu me parles pas à moi toi ! ».
Les femmes hochent la tête, navrées : « mais que fait sa mère ? ». Pourquoi y a-t-il donc des mères démissionnaires qui laissent leurs enfants seuls au lieu de venir partager le généreux goûter d’anniversaire ?
Je pense aux élèves de ma pire des classes. Je regarde s’éloigner la crevette agressive qui leur ressemble avec cinq ou six ans de moins, et je me dis qu’il y a du boulot…
La colère – Publié le 20 juin 2019

On attend d’un enfant qu’il marche à un an. J’ai marché à dix mois. Je n’en cours pas plus vite pour autant. Mes enfants, sujet au vertige dès 80 cm, ou trop heureux de glisser sur leurs fesses, ont pris leur temps. Quinze ou seize mois : trop grands, déséquilibrés, prudents.
Que puis-je attendre d’un blog à un an ? On ne peut pas dire qu’il coure lui non plus. Peut-être que trop de visites me donneraient le vertige.
Que fait un blog d’un an ? Il se répète comme se répète le cycle de l’année. Juin est revenu, et avec lui le show final des clubs et des écoles*, dans une débauche de concerts et de festivités. J’ai l’impression d’un gigantesque complot pour nous épuiser. On se croirait dans une administration quand il faut dépenser tous les crédits de l’année au risque de les perdre et qu’ils ne soient pas reconduits : toute notre énergie doit être soldée avant le premier juillet.
En même temps que mon agenda électronique se remplit tous les jours de points verts ultra importants et de rappels, les batteries de ma fille se vident. Je la vois traîner sa fatigue et son rhume des foins du canapé du salon à son lit, choisissant parfois de s’arrêter sur le chemin de l’un à l’autre pour s’enfermer dans les toilettes et profiter en paix de sa BD. Dernier bastion contre les attaques à répétition de la maîtresse et du prof de violon, la porte des chiottes résiste aux sollicitations impérieuses d’un emploi du temps trop chargé, et aux petits frères qui trépignent et tambourinent en se tenant le zizi.
Pendant quatre ans et neuf mois d’école élémentaire, ma fille a découvert, étudié, révisé, re-révisé, le sujet et le verbe. Au mois de juin de CM2 la maîtresse a décidé qu’il serait judicieux d’apprendre et d’évaluer dans la foulée les propositions indépendantes, coordonnées, juxtaposées, principales et subordonnées, les compléments circonstanciels de temps, de manière, de lieu, de but, de moyen, les compléments d’objets directs et indirects, les verbes d’état et les attributs du sujet.
Ma fille sème partout des petits mots griffonnés avec colère : « école démission ». Ils glissent sous les meubles, dans son lit, parmi les lettres, colonisent les tiroirs de mon bureau, se scotchent aux murs, coincent les portes.
Pour faire bonne mesure avec le gavage grammatical tardif, le prof de violon s’est mis en tête de se raccrocher au wagon déjà surchargé de la fête de la musique. Agrippant par les crins de son archet ma fille qui violine depuis trois ans, il a décidé – faveur ultime – de l’entraîner dans le projet délirant de jouer avec des élèves pratiquant leur instrument depuis dix ans. Un mix celtique et médiéval que les parents écouteront assis en plein air sur des bottes de foin. La Mairie a fourni aux enfants musiciens des tuniques entre elfes et vilains.
Voilà donc ma fille récompensée d’avoir crincrinné ses gammes avec conscience et régularité toute l’année, par l’octroi d’un défi aussi valorisant qu’emmerdant. Le morceau irlandais enchaîne avec vivacité des triolets. Ma fille, tout à son application à jouer juste, traîne. Les répétitions avec les grands élèves de l’orchestre ont été terribles : elle cavale, échevelée et en panique, sans pouvoir rattraper les autres pupitres.
Il était content de son coup le prof de violon : il fallait la tirer vers le haut et presser le citron. Ma fille encore jeune est un fruit juteux et rebondi qui pourrait s’assécher à l’adolescence. « Il faut presser le citron tant qu’il y a du jus » m’a-t-il dit. Le problème est que pour l’instant mon enfant citron n’arrive surtout pas à presser le tempo.
Elle commence à taper du pied, violemment et même pas en mesure. L’archet vole en dangereux moulinets. Elle croise les bras, renfrognée. L’acide citrique commence à me piquer le nez. Ras le bol de la fête de la musique. Je propose de téléphoner au prof pour expliquer qu’on renonce au massacre. Cris et hurlements : la belle ne veut plus travailler, mais elle refuse tout autant d’abandonner. Fatiguée de tout ça, impuissante, je perds patience. Mon ton qui monte à l’extrême se heurte au silence buté de l’enfant presque ado qui oscille entre ancienne bouderie et nouvelle rébellion. Dans son regard noir et dur je reconnais l’angoisse trop familière d’être piégée entre la difficulté insurmontable et l’impossibilité de renoncer. Moi-même je bloque, incapable de décider s’il faut laisser l’agrume mûrir en paix ou presser violemment les dernières gouttes.
La nuit a heureusement fait une partie du travail, et le lendemain, le métronome par son clac clac monotone a ramené la paix. 72 battements par minutes, puis 80, puis 92 ont dompté les triolets. Enfin. Ma fille tiendra sa partie dans le festival des touchantes fausses notes enregistrées par les cent caméras des cent parents qui ont comme moi sur leur calendrier, les multiples points verts ultra importants et les nombreux rappels des auditions de leurs enfants.
*Voir Apprentissage – Partie 2 Juillet 2018
La pâte à sel – Publié le 10 juillet 2019

_ T’as gâché mon bleu !
_ C’est toi qui prends toute la place sur la palette !
Sur fond d’invectives que mon casque étouffe à peine, j’essaie de me concentrer sur mes pianos et mes fortes subito. Je devrais peut-être me contenter de travailler un peu de technique, en me disant méchamment que le tic tac obsédant du métronome agacera autant mes deux plus grands enfants que leurs disputes me hérissent.
Petit minus et son père font la sieste. Il est 15 heures : l’heure du « temps calme » familial. La vaisselle est faite, la machine à laver ronronne, à moins que ce ne soient quelques ronflements que j’entends. Même la ville est ralentie, écrasée par la chaleur. Une ligne de sueur me coule dans le dos pendant que j’essaie sur mon piano Kawaï équipé d’un système électronique de travail en silence, d’améliorer les passages les plus grossièrement nuls d’une sonate de Mozart. J’ai l’espoir d’enchaîner ses trois mouvements en entier avant les vacances, exploit que je n’ai jamais réalisé.
_ Copieur ! Tu lui fais les yeux verts, et moi je voulais justement lui faire les yeux verts !
J’écrase un accord de basse furieux qui me brise les tympans sans faire sursauter personne. Je sens que je vais intervenir pour barbouiller des yeux rouge colère et des nez jaune moutarde au chat et au lapin de pâte à sel qui commencent à me courir sur le crescendo.
J’avais trouvé intelligent la semaine précédente de proposer une activité pâte à sel aux enfants que j’invitais à l’anniversaire de mon Moyen. Pour trois euros cinquante de farine et de sel fin, j’avais réussi à stabiliser autour d’une table sans bonbons, les onze monstres – les plus gentils de l’école, avouons-le – qui commençaient à glisser sur les legos, à écraser les playmobils, et à se battre à coups de brumisateurs, le tout dans une atmosphère par 40°C qui sentait de plus en plus le foin et la ménagerie.
N’avais-je pas pensé que mon soulagement à donner aux parents le surlendemain les sculptures de leurs bambins que j’avais fini par cuire après de nombreuses fournées, n’aurait d’égal que leur embarras d’avoir sur les bras des chats, des voitures, des bonhommes et des escargots dont ils ne sauraient que faire et qu’en plus les gamins voudraient, comme les miens aujourd’hui, peindre ! M’attendais-je à des compliments ?
En région parisienne, les marchands de meubles rivalisent d’ingéniosité pour maquiller un studio en cinq pièces : les tables se plient, les portes coulissent, les lits se collent au plafond et les commodes s’escamotent. Impossible cependant, début juillet, de réduire ni d’escamoter les cahiers, les bidouilles et les bidules que les enfants rapportent de l’école et du cours d’art dans des cabas qui débordent de leur fierté et de leurs dessins froissés. Le jardin extraordinaire de la maîtresse en carton d’emballage avec son arbre parallélépipédique qui branlotte. Le marché d’Egyptiens en terre aux yeux de travers de la prof de dessin avec tous leurs petits paniers remplis de fruits d’argiles qui roulent sous le canapé et derrière les étagères. Le carnet de voyage et l’album photos de la classe verte. Les cahiers, les crayons machouillés, les ardoises tâchées qu’on n’ose pas jeter sans pourtant pouvoir les réutiliser, les feutres ni bons ni mauvais par dizaines, les pages d’évaluations par centaines, les soustractions et les essais d’écriture libre dans lesquels on découvre les pensées de nos enfants quand ils ne sont pas à la maison.
Dix mois de figurines, de peintures et de rédactions maladroites débarquent aux premiers jours de juillet, chargées des souvenirs de l’année, touchantes, affreuses et magnifiques d’application enfantine. Tous les murs, des chiottes aux couloirs, sont déjà couverts de chef-d’œuvres patouillés à la gouache et à la craie grasse. Début juillet se lance le défi de trier. Année après année les souvenirs d’adultes descendent aux ordures pour laisser la place aux souvenirs d’enfants. Les cours de fac sur les espaces de Banach dont l’utilité n’est pas prouvée, sont jetés pour conserver des leçons de CP dont on n’aura jamais besoin. Il n’est possible de jeter, ni une petite pomme d’argile ni la moindre ligne d’un cahier de brouillon : chaque crayonnage devient témoignage et partie du mouflet dont il serait sacrilège de se séparer.
Ne pouvais-je éviter de rajouter aux parents déjà submergés d’objets, mes gargouilles en pâte à sel ? Une mère – pleine d’abnégation – a laissé son gosse me rappeler à la sortie des classes que j’avais oublié de lui donner une de ses productions : une simple tête simiesque, à la bouche fendue et au front bas, dont je n’avais pu décider si elle était une œuvre ou une boule de pâte oubliée. Et bien savez-vous ? Dévisageant son monstre sans corps, le petit sculpteur, fit volte face et couru vers l’école pour l’offrir à sa maîtresse. J’ai senti là une grande justice : elle avec sa tête de pâte figée par le four dans une inquiétante hilarité, et moi avec mon jardin extraordinaire en carton qui pesait sur mon bras et menaçait de s’écrouler. Je me suis demandé si elle pourrait la jeter.
La balade des escargots – Publié le 28 juillet 2019

Minuit. En tongs, j’écrase des chardons dans la dune. J’avance à l’aveugle ou presque, n’osant allumer ma lampe torche par dégoût des insectes qui se précipitent dans son faisceau, bourdonnent et se cognent.
Je ne veux pas non plus qu’on me remarque. Je m’imagine contrebandière de la côte, attendant une livraison clandestine effectuée par un homme grenouille ou par une équipe d’espions dans une barque sombre fendant sans bruit les vagues. Peut-être suis-je dans une bande dessinée de Tintin, ou dans une aventure du Club des cinq.
Je n’attends pourtant ce soir aucune cargaison d’armes ni de fausse monnaie ni d’opium. Je cherche le lieu le plus favorable pour enterrer sous les mousses le contenu d’un petit sopalin que je tiens plié dans une main. Une clé ? Un diamant ? Un code secret ? Un doigt coupé ?
Une centaine d’êtres vivants.
Vers 22 heures ce soir, alors que j’avais enfin collé au lit les trois enfants bondissants, j’entreprenais comme dernière corvée le nettoyage des trois barquettes de nos trois escargots domestiques : Tagada, Éclair et Claude*. Je venais de doucher Tagada dans l’évier, et j’enlevai les restes d’une vieille feuille de batavia rongée pour la remplacer par une feuille fraîche quand soudain, horreur gluante et parasitaire, je découvris sous le végétal pourri que je lâchai dans un cri, une boule blanche formée d’une centaine d’œufs pondus du jour dans un trou creusé au milieu du terreau.
Tagada ! Comment avait-il osé faire ainsi trembler la main qui l’avait nourri ! Et surtout comment avait-il, biologiquement, pu ?
Après avoir vérifié que seul Tagada (pour l’instant) avait fait des enfants, et après avoir bien malencontreusement tiré du lit par mon étonnement indigné et bruyant ma propre progéniture prête à se relever au moindre signal, j’ai posé les œufs blanchâtres dans un papier et regardé Internet pour confirmer ce que je savais déjà, à savoir que ces œufs n’auraient pas dû être là.
Passe que la maturité sexuelle des escargots soit à un ou deux ans d’après les sites que j’avais consultés. Cela tendrait juste à prouver que la salade que j’achète au marché est bourrée de perturbateurs endocriniens qui rendent mes escargots de sept mois précoces et ma fille de dix ans trop vite adolescente. En dehors de ma personne – petite au sens propre – et des courgettes sur le balcon, tout semble grandir trop vite dans ma maison.
Le plus étonnant n’est pas tant cette croissance accélérée que le fait que l’escargot est un champion toutes catégories de la cabriole. Qu’il soit hermaphrodite ne signifie pas qu’il peut se reproduire seul, bien au contraire. Non seulement il a les deux sexes ce qui, si nous pouvions les imiter, règlerait bien des débats politiques en faisant de nous tous des LGBT, mais ses câlins durent douze heures ! Deux heures de préliminaires et dix heures d’accouplement. Qui peut en dire autant ?
Sachant ce phénomène, et renonçant à débattre s’il relèverait plutôt du fantasme ou du cauchemar, j’avais décidé de faire vivre mes trois escargots dans des maisons séparées, tout en leur offrant périodiquement de se rencontrer pour de courtes parties conviviales d’une demi-heure. Je ne voulais pas que leur triste naissance d’escargots scolaires les prive totalement de vie communautaire.
Comment Tagada, le Speedy Gonzales du sexe, a-t-il pu forniquer lors d’une rencontre de quelques minutes ? Avait-il compris que ses quarts d’heure étaient comptés ? Était-ce dans ce but qu’il a échappé quelques instants à ma surveillance sous un laurier ?
Les œufs sont bien présents, dans ma feuille d’essuie-tout bien pliée. Immaculée conception ou non, cent bébés gastéropodes me menacent d’une éclosion prochaine. Suis-je une super héroïne dont le super pouvoir n’est pas de s’envoler ni de lancer des flammes, mais de booster la fertilité des escargots ? Est-ce le signe divin que la reconversion professionnelle à laquelle j’aspire se concrétisera dans l’élevage et la cuisson des gros gris ? On produit de plus en plus de miel de parcs et de terrasses en petite couronne parisienne, pourquoi pas des escargots en élevage bio au-dessus du boulevard pollué car quotidiennement embouteillé que surplombe mon balcon ?
J’ai avancé loin dans le sentier des dunes. Je suis seule. Je repère un petit coin de terre sableuse, calvitie ronde au milieu des mousses. J’y verse un peu d’eau et creuse un petit trou dans lequel je dépose les œufs que je cache de mon mieux. Prédateurs, canicule ? Il faudra laisser faire la nature. Peut-elle abandonner des petits dont l’existence déjà miraculeuse n’est dû qu’à sa clémence ?
Me dirigeant à la seule clarté de la lune et des étoiles, je rejoins la plage, et j’abandonne au destin mes fruits mystérieux et baveux.
Le petit chat et l’enfant – Publié le 13 septembre 2019

Le petit chat est au fond du jardin, sous la terre.
Le petit enfant à genoux gratte la terre de ses petites mains. Il veut caresser le chat. Il faut le sortir de là. Il nous regarde sans comprendre : pourquoi ne l’aidons-nous pas à sortir ce pauvre petit chat ? Pourquoi ne bougeons-nous pas ? Il s’arc-boute, il veut rester, il veut creuser. Il pleure sans comprendre notre cruauté.
Le petit enfant a trois ans. Le petit chat avait vingt, mais il n’est pas mort au fond du jardin, ni sous le lilas, ni dans un panier, ni sur une pile de chiffons colorés au grenier. Une voiture l’a heurté. Est-ce une leçon à donner à l’enfant qui cherche toujours à lâcher la main dans la rue, à s’échapper ?
Le vieux chat chétif avait peur du petit enfant : de ses cris, de son excitation, de ses caresses vigoureuses.
Avec l’arrivée de l’enfant, je m’occupais moins du vieux chat endormi sous le lilas du jardin de mes parents. Un chat, même chétif, qui s’endort sur un ventre rond, c’est inconfortable pour tout le monde. Un chat curieux qui se couche dans le lit d’un nourrisson c’est dangereux. Un chat légitimement agacé par les câlins brutaux et bruyants d’un bébé peut griffer.
Aurais-je su si naturellement accueillir l’enfant nouveau né sans l’expérience des longues années partagées avec le petit chat de vingt ans, arrivé à quelques mois de la rue, errant ? Les câlins, les soins, les jeux d’éveil, les bobos, les médicaments, la chaleur et la compagnie. L’enfant de trois ans, par moments, se fait encore chat. Je l’ai cajolé, nourri, grondé, soigné, comme un chat.
Loin du fond du jardin, à la mer, le petit enfant ramasse des coquillages. Il veut les rapporter à la maison dans un seau d’eau. Oui pour les coquillages, mais non pour l’eau ! Mais sans eau ils vont mourir ? Hélas les coquillages vides, déployant deux ailes de papillon sur le sable, sont déjà morts. Déjà morts ? L’enfant pleure. Pourquoi les coquillages sont-ils déjà morts ? Et pourquoi le petit chat est-il sous la terre, et pourquoi la voiture trop pressée nous a-t-elle pour toujours privés de le caresser ? La fatigue fait surgir des questions qui bouillonnent. Les pleurs et les pourquoi sont révoltés. Ils réclament au Monde des comptes.
Il faut rentrer à la maison, se doucher, se réchauffer, dîner, oublier.
L’enfant de trois ans, préparé pour la nuit dans son lit, me fait promettre dix fois de l’éveiller moi-même au matin. Si le petit chat peut dormir pour toujours sous la terre, et les coquillages en ailes de papillons échoués ne jamais se réveiller, l’enfant lui, veut être sûr qu’il ouvrira les yeux demain. Sur la lumière du jour, sur la chambre, sur maman. L’enfant a peur, il veut des histoires à lire et des chansons. Il veut l’histoire du chaton ami d’une souris qui joue à cache-cache dans un chausson.
Plus tard, bien tard, le petit enfant s’endort enfin, pelotonné par terre, au pied du lit de son frère.
Les chieurs – Publié le 22 septembre 2019

Mais pourquoi sont-ils si chiants ?
Nous profitons d’un cadre idéal en cette superbe, mais peut-être écologiquement angoissante, fin d’été : une terrasse ensoleillée au bord d’un canal. La compagnie est parfaite de deux amis qu’on ne voit pas si souvent et qui nous invitent au restaurant. La serveuse sourit. Le menu est alléchant.
Mais là prend fin le cliché publicitaire : autour de la table vibrent déjà les trois enfants.
Les deux qui savent lire, affichant le calme d’avant la tempête, n’agitent pour l’instant que la langue, scotchés qu’ils sont par la découverte de la carte. Le Moyen cherche laborieusement la ligne du steak frites et la Grande, tout en espérant se faire offrir un cocktail de dame en plus d’un Ice Tea, s’occupe à débusquer le plat le plus original.
Je regarde le Petit de travers : l’apéro n’est même pas là qu’il joue à faire glisser son couteau entre les lames en bois de la table à claire-voie. Réprouvant l’activité, mais soulagée qu’il soit occupé, je surveille ça de loin, au risque de le voir y laisser un doigt. Le couteau tombe par terre. Le gamin s’exclame. Descend de sa chaise. Se traîne entre nos jambes. Abandonne le couteau. Et découvre qu’il peut courir autour de la table. Je râle.
On nous a placés un peu à l’écart des autres clients qui tous, eux, ont leur cul sur leur chaise. Un choix spatial que j’imagine stratégique. Le Petit qui court en rond hurle de joie. Je hurle de colère. Des têtes aux quatre coin de la terrasse de tournent vers nous. Je rentre les épaules et cache rage et honte dans mon verre de kir. Si je me tais, je suis laxiste. Si je m’écrie, une harpie. Dans les deux cas je n’arrive à rien : le gosse continue son agaçant mouvement de rotation.
Dans mon quartier quand je gronde aux turbulences enfantines des trois mouflets sur le chemin du parc ou de l’école, c’est la voix de ma nounou qui me répond. Elle chante avec son accent : « laissez madame Herrero, ce sont des enfants ! »
Au bord du canal, les têtes chenues, qui tout autour nous jugent, n’ont pas cette douce indulgence. Elles pensent qu’elles faisaient mieux en leur temps. Ai-je jamais, enfant, couru dans un restaurant ? Je ne le crois pas. Tous les enfants d’avant étaient-ils sages ? Sans doute l’étais-je, au moins en public, car j’aimais singer les adultes. Mais Sophie dans ses malheurs et le Petit Nicolas étaient-ils aussi modèles que moi ?
Autour de la table la situation ne fait qu’empirer. Le Moyen qui a commandé ses frites joue maintenant à chat avec son frère entre les jambes de la serveuse. La Grande ne comprend pas qu’il n’est pas poli pour nos amis de commander les plats les plus chers. Il me faudrait plus d’yeux pour fusiller tout le monde.
En attendant le plat, signal nous est donné d’accéder au buffet à volonté des entrées. La Grande veut goûter tous les pâtés. Son assiette est un dôme. Le Moyen, au mépris des règles, se plante directement devant les desserts. Le Petit m’échappe et s’élance. Sans un regard pour les saladiers ni les terrines, il slalome et déboule dans les cuisines. Essoufflée je le pourchasse, sans charlotte à cheveux ni sur chaussures, bafouant ainsi toutes les normes d’hygiènes isomachinchoses apprises avec mes étudiants de BTS qualité des industries agro-alimentaires et des bio-industries. Je rattrape le monstre à deux pas de la plonge, le saisis et m’éclipse avant que ne nous voient et ne nous pourchassent des inspecteurs sanitaires sortis des grands frigidaires et de dessous les fourneaux.
Le Petit s’est goinfré de pain et d’œufs durs mayonnaise et n’avait plus faim quand son steak est arrivé. Le Moyen s’est servi quatre parts de tarte aux fraises. La Grande en a profité pour goûter les babas au rhum et les pruneaux au vin. Je crois que nos amis, pétris de gentillesse, de générosité et sans regret pour l’addition salée, ont rigolé.
Un déjeuner tranquille pris au milieu des conversations feutrées en regardant glisser sur le canal ensoleillé les pédalos, plus qu’un rêve inaccessible, aurait sans doute été bien insipide. Sans doute ai-je déjeuné de couleuvres, mais elles resteront savoureuses dans mon souvenir. Car mes enfants sont des enfants qui vivent entre enfants et se foutent pas mal d’imiter les adultes. Sans doute ont-ils raison, et sans doute apprendront-ils à temps.
Remuants, bruyants, imprévisibles, enthousiastes, chamailleurs et curieux. CHIANTS.
Comptines – Publié le 25 septembre 2019

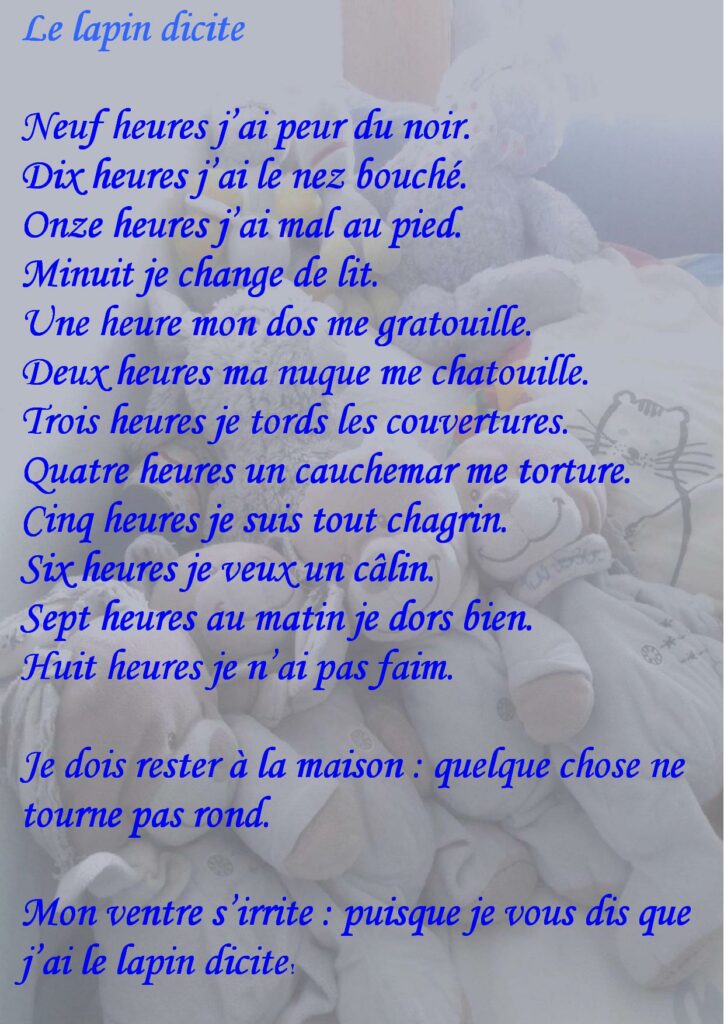
Torpeur – Publié le 31 octobre 2019

En cette grise après-midi, la sieste ressemble à la nuit.
Le Petit qui a hurlé pour ne pas aller se reposer, dort maintenant à poings fermés, conforté dans le sommeil par la tombée du jour.
Le Moyen joue, le visage collé au parquet, à quatre pattes, les fesses en l’air, au milieu de legos, de playmobils, de morceaux de circuits et de livres éparpillés. De sa bouche vrombissent les moteurs de ses voitures miniatures. Une course fait rage dans la lumière électrique crue de la chambre.
La Grande, en signe d’adolescence naissante, a fermé sa porte, heureusement fort bien décorée de photos d’animaux, de dessins, de mots doux et de messages menaçants. De l’huisserie filtrent des chants de marins qu’elle écoute en boucle depuis plus d’un mois. Peut-être lit-elle. Peut-être s’évade-t-elle en tapotant sur son téléphone vers quelque copine partie de l’école primaire pour un autre collège que le sien. Non. Elle invente une vie à ses barbies, assise en tailleur au cœur d’un amoncellement de poupées, d’accessoires et de chiffons. La chrysalide crée ses surprises.
Vaincu par la pénombre de plus en plus épaisse et par la correction de copies tristement mauvaises de lycéens si gentils qu’on leur souhaiterait d’avoir tous vingt, mon mari dort dans le canapé, stylo rouge abandonné, serrant dans ses bras un coussin.
Dehors des enfants du quartier courent et tirent sur les cordes des balancelles doubles du parc, mais les cris semblent assourdis et le manège s’est tout illuminé des néons roses qu’on n’utilise qu’à cette courte période de l’année : quand l’heure tardive de fermeture du jardin d’une fin d’octobre cohabite avec l’obscurité précoce qui est déjà celle de novembre.
Il faudrait ranger, aspirer, sincer*, laver, étendre, repasser. On devrait sortir les devoirs, les cahiers, les leçons. Il serait bon de frotter, pincer, frapper, souffler, marteler piano flûte et violon.
L’atmosphère grise du boulevard est saturée d’humidité. Dans quelques minutes le parc se videra, et le manège éteint disparaîtra dans l’ombre des arbres, masse sombre soulignée par une rangée de réverbères et balayée sur ses frontières par les phares des véhicules pressés de rentrer chez eux.
On me dit qu’il faut méditer. En bouddha ? En silence ? Au soleil ? Je ne sais pas méditer, ni ne le souhaite. Pourtant aujourd’hui l’ennui d’un temps gris m’invite au repos. Pourquoi toujours vouloir qu’il fasse beau ?
J’aime le son des roues sur l’asphalte trempé. J’aime l’obscurité tombante qui me dit que mon corps et mon esprit ont le droit d’être fatigués. J’aime la fainéantise suggérée par la lumière déclinante. Je n’ai envie ni de ranger, ni d’aspirer, ni de sincer*, ni de laver, ni d’étendre, ni de repasser. Je vais laisser pour ce soir l’esprit de mes enfants en jachère, sans orthographe ni partition, comme une terre après la moisson. Je reste assise et ne me lèverai que pour préparer, dans cet appartement assoupi, un dîner de soupe au potiron et de pain perdu.
Fin de vacances, début de week-end, les heures prochaines prévoient d’apporter la pluie. La grisaille s’annonce comme un prélude avorté à l’hibernation. Il faudra retravailler, se lever de nuit, sortir bottes et parapluies, protéger les enfants des gouttes et des flaques sur le chemin de l’école, s’enfoncer frileux et anxieux au plus profonds des aubettes** pour espérer l’arrivée prochaine du bus pris dans les embouteillages indissociables des routes glissantes et des conducteurs moroses.
Dans l’attente de cette reprise qui ignore les saisons, l’automne mouillé nous ankylose et nous offre une pause.
*Sincer : « Passer la serpillère » dans mon parler régional.
**Aubette : « Abri-bus » dans ce même parler régional. Quelle ne fut pas ma surprise en venant travailler à Paris de constater que ce vocabulaire n’était pas universel !
Le petit chemin des enfants gâtés – Publié le 29 novembre 2019
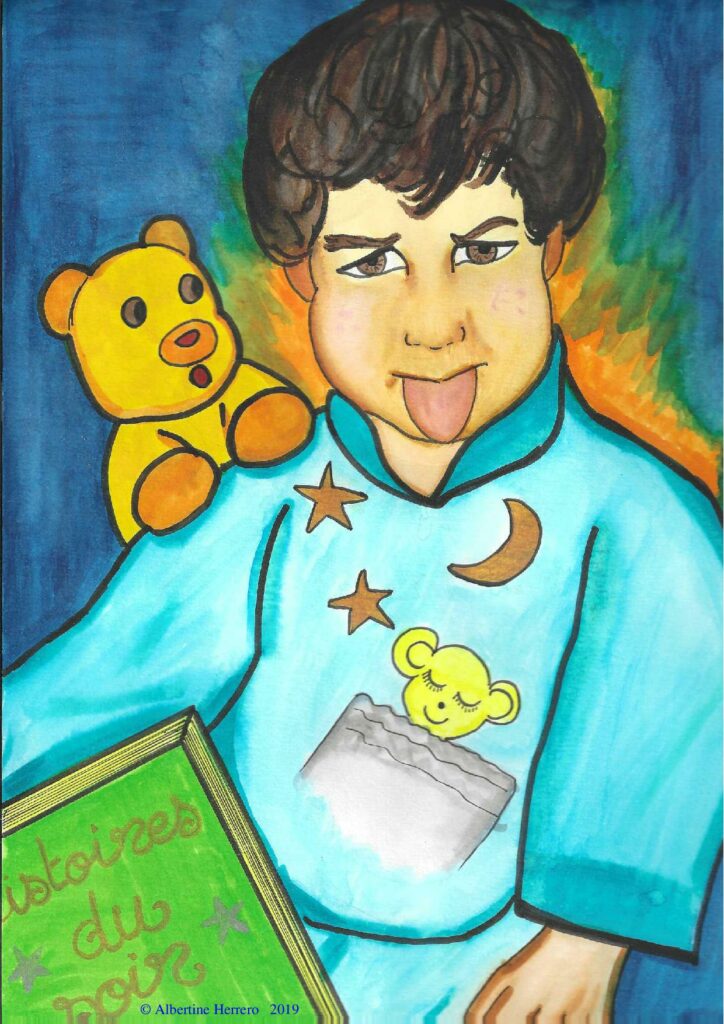
Un enfant de trois ans dormira sûrement si vous empruntez le petit chemin.
Le petit chemin commence par une douche relaxante et bienfaisante à dix-huit heures. Il progresse en trottinant jusqu’à dix-neuf heures quand on éteint tous les écrans. Il s’engage ensuite dans l’harmonieux dîner familial pendant lequel tous s’intéressent à la journée de chacun. Puis, comme en un joyeux ballet, adultes et enfants se lèvent pour débarrasser la table, virevoltent et se croisent dans la cuisine les bras chargés de couverts, de restes et d’assiettes, déposés dans la poubelle ou dans l’évier avec solidarité. Viennent alors le brossage des dents puis la pente douce qui conduit à la lecture du livre à vingt heures, moment d’affection partagée, au câlin, au bisou et au sommeil, naturel, souhaité de tous les partis, inévitable. Il est vingt heures trente et la maison est calme.
L’infirmière scolaire s’est bien habillée pour venir nous raconter tout ça. Nous sommes huit parents dans une salle de classe et nous regardons le power point du petit chemin. A huit heures trente ce matin, j’aurais bien emprunté le petit chemin de la sortie après avoir confié mon dernier à sa maîtresse de maternelle, mais la directrice m’a barré la route : « Vous viendrez bien assister à la conférence de l’infirmière sur le sommeil ! C’est ici et tout de suite ! ». Certains chemins sont pleins de surprises…
Voilà dix ans que chaque soir j’emprunte le petit chemin du sommeil. Il est bourré d’embûches ce petit chemin. Voilà dix ans que je me prends les pieds dans les ornières, les taupinières, les cailloux, les racines et les flaques du petit chemin du sommeil enfantin. Faut-il que je lui dise à l’infirmière qu’il est souvent beaucoup plus long et plus tordu que prévu son petit chemin ?*
Ça ne marche pas. Tout comme ne marche pas l’harmonieux dîner.
Pourtant chaque soir on essaie. Nourriture, écrans et sommeil sont les sujets préférés de l’éducation aux parents dans les milieux infirmiers et enseignants. Les repas doivent être variés, bios, équilibrés, de qualité. Et ne pas oublier le petit déjeuner avec céréales, fruit et produit laitier ! Ça ne marche pas.
Je ne parle même pas des matins où j’habille de force un fou hurleur qui se débat comme aux prises avec un assassin et que je finis par traîner dans la rue, étouffant, tout en marchant, ses cris avec une pompote et des biscuits secs. Je parle du simple dîner quand plus rien réellement ne nous presse. L’harmonie commence en général dès l’entrée par des coups de pied sous la table. Mééééheuuuu !!! S’ensuit la comparaison des assiettes. Pourquoi donc mes enfants ont-ils toujours le nez dans le plat du voisin ? Les conversations vont bon train : moqueries, quolibets, chansons pour attirer l’attention. Les délations bien intentionnées des frères et sœur finissent par nous donner une bonne idée du contenu de leur journée, mais il ne faut pas espérer, entre adultes parents, se raconter le moindre événement. On aurait juste envie de revenir aux temps où les enfants devaient se la boucler en mangeant.
Et parce que la fin du mois et les coûteux calendriers de l’avent ont quelque peu tiré sur les derniers billets du budget, j’ai cru avoir une bonne idée en choisissant d’acheter deux belles cuisses de dinde à sept euros pour la fin de la semaine. Une fois rissolées, je les ai fait rôtir avec des petites carottes, des navets, des pommes de terre qui formeront à la cuisson une peau craquante et dorée, du thym, des oignons et du laurier. Du four s’échappe une bonne odeur et je me crois championne toutes catégories des repas de qualité prônés par les conseils infirmiers.
« C’est quoi cette viande ? Elle est bizarre ». « J’aime pas les navets ». « Et puis elle a du gras cette viande, je peux pas manger ça ». « C’est pas du poulet label rouge ». « Je préfère le saumon, t’en fais pas assez souvent ». « Pourquoi pas du rôti de bœuf ? ». « C’est pas bon ».
Bios, variés, de qualité. Mes sales gosses trop gavés ont tout intégré. Ils renâclent devant leurs assiettes ordinaires. Ils veulent du fromage et des saucisses du marché. De la faisselle au détail. Des poissons panés seulement s’ils sont pêchés sur l’étal du poissonnier. Et même pas merci d’avoir un truc à bouffer ? On les gâte, on ne leur souhaite aucune difficulté, mais là, contemplant ces cuisses de dinde tant dédaignées, j’aurais presque envie qu’ils apprennent un peu à en chier. Je ne le ferai jamais. Ai-je emprunté le chemin de la mauvaise éducation des enfants trop gâtés ? Suis-je en train de créer des petits cons exigeants, blasés et dépensiers ? Penseront-ils que tout leur est dû et qu’ils sont supérieurs parce que j’ai voulu suivre les conseils et leur donner le meilleur ? Chaque repas est un réveillon et l’approche de l’orgie des cadeaux de Noël me déclenche déjà des indigestions.
Demain je leur servirai des coquillettes et du râpé en sachet.
*Voir Au lit ! Septembre 2018
Une voisine bien intentionnée – Publié le 17 décembre 2019

« Il faut parler… S’énerver ne sert à rien… »
Je n’avais pas vu que la voisine du sixième était dans l’ascenseur alors que j’y poussais, avec colère et en retard, mon cadet, pour aller chercher le benjamin à la sortie de l’école. Je ne l’ai jamais vue accompagnée d’enfants, cette voisine à peine plus âgée que l’âge limite pour procréer. Cette voisine est toujours seule, souriante et pomponnée, parfumée, les seins avenants et apparents. Que dit-elle ? Elle insiste.
J’ai le manteau de travers, les chaussures à peine lacées. Décoiffée, pressée, je me bats contre la bride de mon sac à main qui s’est emmêlée avec la bride du sac de goûter. Interloquée, perturbée dans ma perception inquiète des minutes qui passent, saturée d’ire maternel, je regarde la femme. Quatre étages à descendre en compagnie de sa morale vicinale semblent une éternité.
Bien sûr qu’elle a raison. Bien sûr qu’elle a le beau rôle, la gentille dame souriante et parfumée qui caresse la joue de mon fils en l’appelant petit cœur. Il faut parler, expliquer, dialoguer.
_ Mon chéri c’est bientôt l’heure d’aller chercher ton petit frère à l’école, il faut un peu ranger ta chambre.
_ …
_ Tu sais que ton frère va être triste s’il comprend que ton maître était en grève et que tu es resté à la maison alors que lui était en classe. Range un peu pour qu’il ne voie pas que tu as joué toute la journée.
_ …
_ On va bientôt partir ! Tu peux au moins ranger tous ces legos qui empêchent d’ouvrir la porte de la chambre ! Tu es resté à la maison et tu t’es gavé de chocolats, tu peux au moins faire ça !
_ …
Cause toujours. Le pire est-il la désobéissance ou le silence, insolente ignorance ? Super voisine m’explique pendant ces quelques secondes dans notre parallélépipède rectangle lancé en translation rectiligne quasi-uniforme vers le rez-de-chaussée, qu’il faut expliquer onze fois quand dix n’ont pas suffi. Son ton est doux et pédagogique. Cambrée, adossée au miroir de l’ascenseur, son sourire est ravageur, son regard supérieur. Avec son piercing dans le nez et sa féminité si excessive qu’elle peut se permettre un crâne complètement rasé, elle me gonfle, la voisine qui ose coller sa poitrine contre le visage déconfit de mon mouflet.
La voisine parle, explique, dialogue. Je devrais adopter la technique de mon fils : cause toujours. Elle m’emmerde la voisine. Agrippant mon gosse pour, enfin descendue, me jeter dans la rue, je lui suggère d’appeler sans tarder les services sociaux. Cause toujours. Et de quoi je me mêle.
Vous avez le complexe de Wonder Woman m’a dit la psychiatre d’un air blasé. C’est un tort, mais alors pourquoi faut-il toujours que des gens bien intentionnés viennent vous faire chier en vous demandant d’être plus que parfait ? Pourquoi fallait-il cet après-midi que l’obsession de la perfection fasse irruption jusque dans mon ascenseur sous la forme d’une voisine qui peut facilement professer le dialogue apaisé puisqu’elle sort seulement à 16 heures en élégant négligé pour juste chercher son courrier, et qu’elle semble avoir eu comme unique tâche dans sa journée de se vernir les ongles des pieds ? Pourquoi cette dictature qui va jusqu’à me coincer dans un moment de faiblesse avec une conne indiscrète dans un espace confiné ?
Il ne faut pas s’énerver. Surtout quand on est en arrêt de travail depuis des mois et que la vie est devenue oisive, facile et tranquille. Sans travail tout est simple. Le Petit qui dans une quinte de toux hivernale a vomi une aigre bouillie de crêpe maison et de chocolat de l’Avent sur la table du petit déj, et qui accuse avec haine et déception la crêpe – maison – mais pas le chocolat – industriel. Les dix kilomètres à pied le matin pour dégoter au pas de course le dernier cadeau de Noël avant le rendez-vous chez le coiffeur du Moyen dont l’école est fermée, loisir bienvenu pour lui faire couper les tifs chez une ancienne candidate de la droite mafieuse à la Mairie, avec qui je me dois d’être plus qu’aimable et polie pour que les tours d’oreilles de mon gamin soient réussis. Le déjeuner avec les deux Grands qui n’ont plus de cantine depuis deux semaines et qui se sont tapés dessus pour tricherie, se battant et hurlant à midi au milieu des débris d’un circuit. Les repas pour deux jours à anticiper et le cake salé gentiment mais fermement souhaité par la maîtresse pour garnir le buffet qui suivra la chorale des maternelles, ce soir. La robe de princesse du réveillon commandée par la Grande – une histoire de couture et de chiffons entre mère et fille – dont je me demande comment je finirai les manches à temps alors que je dois rendre avant samedi un devoir sur la ponctuation dans le cadre de ma formation.
Mais j’y pense : ne suis-je pas arrêtée pour burn out et choc post-traumatique ? psychiatriquement atteinte ? fragile, folle ? instable, barge ? médicamentée, shootée, médicalement droguée ? Ne pourrais-je en faire la publicité ? Ne faudrait-il pas en informer la voisine bien intentionnée ? Attention voisine : la mère du quatrième est fêlée. Vous devriez garder vos leçons : elle pourrait mordre ou péter un plomb !!!
2020 – Publié le 07 janvier 2020

J’ai commencé l’année avec deux pieds droits.
C’est toujours mieux qu’en mettant les pieds dans le plat.
Pour le 1er janvier j’avais impérativement besoin d’escarpins. A Paris en ce moment les chaussures de marche sont plus utiles que les talons aiguilles, mais pouvais-je assortir ma robe du nouvel an de godillots ou simplement rester en collants ? J’étais pieds et poings liés.
J’ai le pied sensible, mais j’ai surtout les pieds sur terre. Les dépenses futiles ne sont plus de mise depuis que j’ai arrêté de travailler. Le médecin m’a dit de lever le pied. Le gauche ou le droit, peu importe. Sans doute devais-je rattraper celui que le travail avait déjà fait glisser vers la tombe.
En 2020, de ma carrière commencée en 2002, il ne me reste à percevoir que trois mois de salaire. Une misère avant l’inconnu et peut-être la galère. Il aurait fallu que je sois bête comme mes pieds pour mettre ma dernière fortune dans une stupide paire de cothurnes.
Je suis allée au marché de mon quartier. Un peu à l’écart des étals pour riches fêtards, loin des chapons, des marrons, des poulardes, des farces, des cerises en hiver et des fromages affinés à la coupe, un vendeur faisait son maigre beurre de godasses en tissu et plastique à prix cassé. Voilà qui m’enlevait une épine du pied.
L’amoncellement de chaussures bon marché produisait son effet. Une cohue de femmes tenues, faute de monnaie, à distance des appétissantes coquilles Saint Jacques au caviar et des tournedos Rossini, s’abandonnaient à leurs appétits de consommation en faisant le pied de grue autour de boîtes qu’on aurait dit tombées du traîneau trop pressé du Père Noël. Ou d’un camion.
Me jetant dans la mêlée, je crus découvrir chaussures à mon pied dans une paire de sandalettes en velours noir et talons de huit centimètres. Deux euros, deux euros, pas cher madame, pas cher ! Deux euros les deux pieds ? J’essaie ! A l’étal des marchandises en vrac, on essaie debout à cloche pied. On se déchausse la chaussette en l’air. Il faut être équilibrée, un peu musclée, avoir bon pied bon œil. Campée sur mon pied gauche, le plus solide, j’enfilai la sandalette droite. Un moment chancelante, j’osai poser le talon de huit centimètres sur l’asphalte. Les rombières mes voisines me regardèrent de travers : ici on essaie la chaussure neuve en marchant sur le couvercle déchiré d’une boîte ou sur un papier. On ne salit pas les semelles ! Nom d’une ballerine en dentelle !
Cliente débutante, je me corrigeai, sautant à pieds joints sur un carton. Peu importait : la chaussure m’allait. Je tendis la sandalette droite au vendeur, dans l’espoir d’obtenir sa sœur . Plus agile d’une seconde, une femme me coupa l’herbe sous le pied en brandissant la sandalette gauche qu’elle avait déjà essayée. Sous son regard noir je m’effaçai et abandonnai la paire.
Le départ victorieux de ma concurrente me laissait prioritaire sur un escarpin droit égayé d’un joli nœud. Cinq euros. La note augmentait mais l’opportunité restait belle. Je me décidai et arrachai enfin au vendeur contre un billet la deuxième chaussure glissée, emballée d’une feuille de soie, dans un léger pochon plastique à usage unique.
Fière de ma bonne affaire je rentrai chez moi, souriant mentalement au pied de nez triomphant que je pouvais faire à tous les escarpins Louboutin. Puis, sans plus y penser, je fourrai dans ma valise le pochon avec ma prise.
Au 1er janvier, le pochon se révéla contenir deux pieds droits. C’est donc pieds nus que je m’en fus embrasser sous le gui mes amis.
J’ai commencé 2020 avec deux pieds droits mais l’important est qu’aucun de ces deux pieds ne se remettra dans un lycée. J’aurais pu en sortir en 2019 les pieds devant. Je pourrais être six pieds sous terre. Et pourtant 2020 est là, et la débâcle financière des prochains mois s’annonce comme une joie.
Et puis vous savez quoi ? J’ai deux pieds droits mais il y a pire car dans cette histoire, quelqu’un dans ma ville s’est découvert deux pieds gauches.
Bonne année 2020 à tous !
Diable ! – Publié le 23 janvier 2020
Le supermarché expose un grand déballage de promos. A l’affût de la bonne affaire je déambule avec les autres ménagères. Je m’arrête devant un lot de neuf paquets de gâteaux secs soldé 6,66€ au lieu de 10,42€. L’achat me tente mais j’hésite.
« Non, mais, vous avez vu le prix ? » me lance une brune quincagénaire. Surprise, j’avoue timidement que je ne trouve pas le prix si mal. « Comment ? Mais ils l’ont mis à 6,66€ ! C’est le chiffre du Diable ! Moi qui en voulais pour mes petits enfants, je n’en prends pas ! ».
Le raisonnement de la mamie balaie mon indécision. « Au diable la superstition !! » dis-je, attrapant résolument le premier paquet à ma portée. La gourmandise n’est-elle pas déjà un péché ?
Les pouilleux – Publié le 23 janvier 2020

La boule au ventre j’ai pris rendez-vous chez la coiffeuse. Mes racines sont blanches et mes pointes n’ont plus vu de ciseaux depuis des années. Pourtant le rendez-vous est pour mon fils le Petit dont les boucles, depuis le début de l’automne, ont poussé, de plus en plus denses, comme pour narguer – dans un insolent contrepied – la saison et les arbres du parc qui se dénudaient.
Je n’aime pas la coiffeuse, mais elle coupe bien les cheveux. Que chercher d’autre chez une coiffeuse si ce n’est qu’elle sache coiffer ? Sise dans la rue la plus chère de la ville, la coiffeuse se flatte de plaire à la clientèle propriétaire des rues les plus en vue au Monopoly du quartier.
Pour moi ou pour mes garçons, j’ai toujours détonné dans ce salon. Pas maquillée, mal habillée, que venais-je y faire ? Peut-on reprocher à sa coiffeuse sachant coiffer d’avoir été groupie politique de Didier Schuller* ? Peut-on reprocher à sa coiffeuse sachant coiffer de grenouiller à la Mairie pour avoir un mois sur deux sa photo dans le journal municipal ? Pouvais-je reprocher à ma coiffeuse sachant coiffer d’avoir été incrédule quand je lui avais naïvement affirmé être la voisine de pallier d’une autre de ses clientes, toujours précieuse et pomponnée, qui était à ses yeux manifestement trop élevée dans la société pour partager avec moi un seuil et un escalier ? Pouvais-je reprocher à ma coiffeuse sachant coiffer que la madeleine et le thé Mariage Frères qu’elle me servait, ne rendaient pas son mépris moins amer à avaler ? Pouvais-je reprocher à ma coiffeuse sachant coiffer mon incapacité à répondre, à jouer moi aussi avec les armes de l’indélicatesse, des indiscrétions et des commérages, quand je savais que la voisine si précieuse et pomponnée se préparait à quitter notre immeuble avec un arriéré de dix mille euros sur les charges de copropriété ?
J’ai laissé repousser mes cheveux. J’ai appris à les teindre moi-même, et j’ai goûté au repos d’une vie sans coupe-couleur à cent euros.
Plus tard, j’y suis retournée pour offrir à mes garçons la belle opportunité d’une coiffeuse sachant coiffer. Mes enfants y étaient toujours trop remuants, trop bavards, trop insolents, sans doute en difficulté à l’école n’est-ce pas ? Discrète et modeste comme une pauvresse, pétrie de la hantise de la vantardise, je répondais non, simplement, sans insister sur leurs belles réussites scolaires. Je n’acceptais plus le thé Mariage frères et je laissais glisser le mépris au sol en même temps que les mèches coupées qui s’éparpillaient à nos pieds.
J’étouffais en léger malaise ce qui aurait dû être de la colère. Une vie à tripoter le crâne et à balayer les cheveux des bourgeois empêche-t-elle d’avoir une conscience de classe ? Consacrer sa vie aux brushings des riches donne-t-il l’impression de partager un bout du piédestal social ? Tenais-je là, la clé pour comprendre comment nous pouvions accepter que des journalistes et des hommes politiques parlent « d’anonymes » et de « France d’en bas » ? Faut-il donc être à ce point abêti par l’admiration des noms, des titres et des fortunes, que nous croyons nous élever quand nous les servons ? Au point que la France d’en bas c’est toujours l’autre et jamais soi, par exemple moi dans ce salon ?
Ce soir j’ai amené mon fils le Petit chez la coiffeuse sachant coiffer. Il était heureux : quelle aventure ! A l’entrée, deux employées – dont une stagiaire adolescente à l’acné copieusement plâtré de fond de teint – se sont précipitées pour longuement scruter la tignasse du gosse inconscient de la suspicion et ravi. Attrapant un point blanc, la coiffeuse qui jugeait sans doute peu rentable un moutard frétillant dont elle ne coiffait pas la mère, lança son verdict : « ce sont des lentes, il a des poux, nous n’avons pas le droit de nous en occuper ».
Pouilleux.
Reconduits sans un sourire sur le trottoir, mon fils et moi nous sommes regardés. Étais-je submergée de honte même si les poux s’installent sans distinction de mérite ni de caste ? N’en avais-je pas, petite, fait l’expérience ? Voulais-je demander pardon d’avoir fait rentrer des parasites même pas riches dans un salon chic ? Qu’avais-je fait de mal pour créer cette humiliation ? Était-ce une punition pour avoir prétendu, malgré mon apparence, à une coupe dans la rue la plus chère ?
_ Maman, pourquoi j’ai des bêtes dans la tête ?
Percé de pitié maternelle et d’injustice, mon moi poli a soudain réclamé la Révolution. Le mépris n’était supportable que lorsqu’il n’éclaboussait pas mon fils de quatre ans. Mère louve pas plus pauvresse en réalité que la coupeuse de tifs, redevenue fière, je ne pouvais plus me taire. Mon bébé n’avait pas de bébêtes dans la tête. Ai-je été contente de moi quand deux heures plus tard, après avoir fait constater par un pharmacien, un mari et un autre coiffeur aimable et compétent que le cuir chevelu de mon fils n’avait pas d’habitants, je suis retournée dans le salon pour confondre, en grande dame offensée, la menteuse coiffeuse devant sa clientèle du soir, nombreuse ? Non. Que m’apportait la vengeance publique alors que les cheveux de mon fils s’étaient finalement fait raccourcir et que ma mission maternelle était remplie ? Ai-je pris plaisir à nuire ? Non. Mais je suis mère, et on m’avait déclaré la guerre.

* La politique du 92 est passionnante. Pasqua, Balkany, Schuller… Le feuilleton depuis des décennies ne nous ennuie jamais. Pour preuve un documentaire ancien mais savoureux : La conquête de Clichy de Christophe Otzenberger (1996).
Est-ce que je m’aime ? Publié le 08 février 2020

Un soir tard, alors que nous rentrions d’un concert à pied, ma fille de onze m’a demandé pourquoi les gens se droguaient. La nuit était toute mouillée, la route brillait, et nous longions les grilles en fer forgé du parc. Allez savoir comment de telles idées naissent.
Prise par surprise entre la fin de la musique et l’envie envahissante d’aller au lit, je répondis sans réfléchir : « Peut-être pour oublier qu’ils ne s’aiment pas ».
Quand on est parent, on se sent le devoir de donner des réponses à nos enfants. Même quand nous n’en avons pas. Je ne sais pas la raison des addictions. Un manque d’imagination que je ne regrette pas.
Mais les réponses bidons apportent toujours d’autres questions : « Et pourquoi est-ce qu’ils ne s’aiment pas ? »
Peu de temps auparavant ma psy m’avait soumis sensiblement la même interrogation. Que pensais-je de moi ? Étais-je assez indulgente avec moi-même ? M’aimais-je ?
Prise au dépourvu sur un trottoir humide, prisonnière consentante d’un divan de psy, ou concentrée sur ma page après une longue réflexion, ma réponse au problème reste la même : celle de gonfler les joues, de rouler des yeux, et de laisser échapper un pet d’air perplexe. S’il faut mettre des mots, les seuls qui me viennent sont : « J’en sais rien » et « On s’en fout ».
Un collègue ouvrier de maintenance dans mon lycée avait un jour répondu à un gestionnaire RH lambda qui lui servait un questionnaire stéréotypé destiné à lui faire avouer ses défauts et ses qualités : « Demandez à ma femme ».
Suis-je aimable ? La question peut se poser, mais je ne sais pas. Demandez aux gens qui me côtoient et à ceux qui m’évitent.
Est-ce que je m’aime ? La question n’a aucun sens pour moi. Qu’elle soit centrale pour d’autres, je le vois, parfois, mais elle atteint dans mon cas, les limites de mon intelligence et de ma forme de compréhension. Mon cerveau, coincé dans une boîte trop petite, n’appréhende ni le Big Bang, ni les trous noirs ni la possibilité de m’aimer ou de me détester.
J’aime les autres – ou pas – mais moi, je suis moi. Devrais-je me choisir ? Devrais-je apprécier ma conversation, échanger avec moi-même des opinions ? Devrais-je apprécier ma sensibilité ? Devrais-je avoir peur de me perdre ?
Aimerais-je être moins grosse, plus grande et avoir un nez moins grand ? Oui, sûrement, mais a-t-on vraiment le temps de se regarder quand on est mère de trois enfants ?
Je vois mes mains sur le clavier de l’ordinateur et du piano.
Je vois mes mains pétrir une pâte à tarte et changer les draps souillés d’un bébé qui a fait pipi au lit.
Je vois mes mains plonger dans le seau d’eau javellisée des corvées ménagères.
Je vois mon doigt qui – ouch – vient de se pincer dans le tambour de la machine à laver.
Je vois mes pieds en éventail devant la télé.
Je vois mon œil droit puis mon œil gauche dans un coin de miroir quand je mets mes lentilles le matin.
J’ai mis plusieurs années à réaliser que mes yeux avaient changé de couleur.
Je m’aperçois parfois à moitié dans l’ascenseur.
J’entrevois de temps en temps sans m’arrêter – honteuse d’être surprise dans la contemplation de mon reflet – ma silhouette dans la vitrine d’un magasin.
Je ne suis pas sur les photos car je les prends. Je déteste être filmée et je ne reconnais jamais ma voix. Peut-on s’aimer quand on ne se voit pas ?
Matheuse médiocre, petite prof de banlieue, m’aimerais-je mieux si j’étais Villani ? Euh, non merci.
Pianiste pour toujours élève modeste, sans souffle ni envergure, m’aimerais-je bien si ma vie et mes insomnies étaient celles d’un Alexandre Tharaud, grand concertiste autour du Monde ? Même pas.
Alors quoi ? Alors je fais avec moi.
Quand je suis en colère contre un con, je me dis toujours que la meilleure des punitions serait qu’il voie avec mes yeux sa petitesse de con. Mais ce n’est jamais le cas. Et si je m’aimais sans avoir conscience de ma connerie ? Et si je me détestais à tort ou à raison, quelle solution pour couper les ponts ?
Non mais franchement, est-ce que je m’aime ? J’en sais rien et on s’en fout. Et vous ?
Parisiens mais sympas – Publié le 19 février 2020
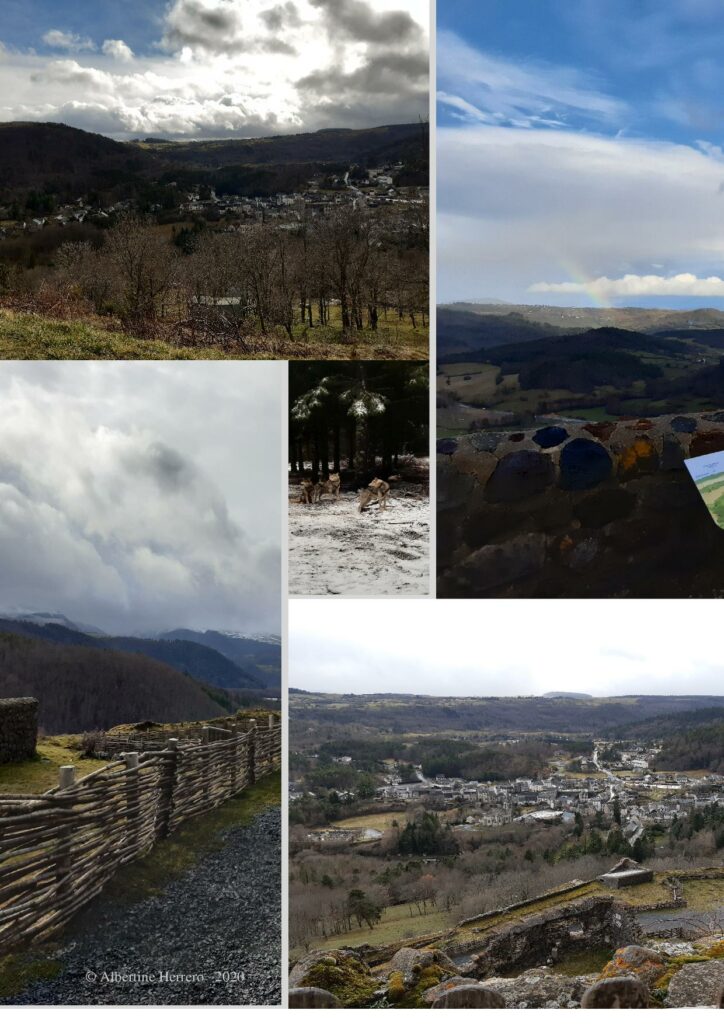
En slip et chaussures de rando, les fesses collées au hublot chaud du sèche-linge en marche, j’espère réussir à sécher ma petite culotte avant l’arrivée d’un autre utilisateur de la laverie automatique de Super-Besse. Il est 10 heures.
Alors que depuis des semaines la météo annonçait des températures désespérément positives et des précipitations quasi nulles, la neige s’est soudain mise à tomber dru quelques centaines de mètres avant notre arrivée à la station de ski, à 8 heures ce matin. A cette altitude il avait neigé toute la nuit, et au petit jour notre point de rendez-vous en forêt se parait de tous les charmes d’un conte de Noël.
Ayant abandonné la voiture au bord de la route, nous grimpions un sentier rude au milieu des sapins blancs. Soucieuse de préserver la magie de ce moment, je tentais de cacher mon essoufflement à monter cette pente à douze pourcents. Je sentais obscurément que je n’étais pas à ma place, mais je voulais faire plaisir à mes enfants.
Sans guide ni indications, nous avancions sur le seul chemin possible quand retentit un horrible vacarme à vous remuer une hérédité issue du fond des âges : des jappements de chiens et des hurlements de loups. Si mon moi contemporain se félicitait – les cris des animaux le prouvaient – d’être au bon endroit, mon cerveau reptilien, lui, m’intimait l’ordre ancestral et viscéral de me barrer fissa. Un instinct millénaire me disait que je n’étais pas à ma place, mais je voulais faire plaisir à mes enfants.
Devant nous se dressait la meute. Gentils chiens ou loups des bois, ces bestiaux n’avaient que peu à voir avec les huskies argentés aux yeux bleus exhibés quelquefois en ville par des bourgeois. La rencontre des chiens de traîneau et des enfants fut assez naturelle, hélas nos manteaux déjà mouillés par les flocons et mon sac à main Ted Lapidus en bandoulière rendaient notre équipée bien cocasse aux yeux du musher* et des autres groupes de touristes vêtus de combinaisons intégrales imperméables et chaussés d’après-skis. Un certain sens du ridicule me susurrait que je n’étais pas à ma place, mais je voulais faire plaisir à mes enfants.

Si je m’étais crue avisée et bonne mère en habillant mes enfants de pantalons de ville doublés et de vestes fourrées sous leurs blousons, je réalisais vite en découvrant le traîneau, qu’il allait falloir garder sourire et bonne humeur au moment de s’asseoir en famille sur les bancs couverts de flaques. Caler ses fesses dans l’eau glacée ne fut que le début de cette folle escapade. La neige qui continuait à tomber achevait de tremper les manteaux d’école et les bonnets de laine. Les orteils dans les chaussures de marche prévues pour un milieu tempéré commençaient à geler. Les doigts dans les gants en polaire même pas étanches s’engourdissaient. Le Petit commença à gémir que les flocons lui piquaient les yeux. L’inconfort, mon postérieur à moins deux degrés et la bosse de mon sac à main au côté, me répétaient que je n’étais pas à ma place, mais faisais-je au moins plaisir à mes enfants ?
Le traîneau filait au milieu des pins, se penchait dans les virages, sautait sur les ornières. Les chiens couraient. Le Petit pleurait. Le Moyen gémissait. Le musher s’interrogeait. Et moi je riais. Je riais fort pour couvrir le bruit des sanglots. Je riais d’autodérision à propos de nos vêtements citadins. Je riais pour rendre le fiasco de la promenade en traîneau aussi chaleureux que mes fesses et mes doigts étaient froids. Je riais pour faire oublier mon sac à main. Je riais pour colorer de bonne humeur la – désormais – certitude que je n’étais pas à ma place et que mes enfants ne se plaisaient pas. Parisiens à côté de la plaque mais sympas.
La fin de la course me laissait en début de journée une famille trempée à gérer. Tout se liquéfiait : les manteaux, les pantalons doublés, les yeux et les nez. J’assurais le musher, ses aides et ses chiens, de notre enthousiasme le plus profond et de notre entière satisfaction. Bien sûr que nous reviendrions. Parisiens à essorer mais sympas.
La descente vers la voiture se fit dans un torrent de larmes bruyantes plus terrifiantes que les loups. Fallait-il rentrer se terrer sous la couette à l’auberge et perdre la journée ? La laverie d’un lotissement de chalets pour vacanciers parés pour l’hiver pouvait nous sauver. J’y trouvais deux mamies devant l’unique sèche-linge. Soucieuse de faire face malgré mes fesses froides, je décidai d’engager la conversation avec ces deux autres galériennes des vacances à la neige. Alors que mes mioches venaient de se répandre en eau et en morve dans le traîneau, elles s’appliquaient, elles, à sauver le linge de leurs petits enfants des dégâts nocturnes de la gastro. Au récit de mes gosses en chaussettes dans la voiture, elles ont bien rigolé. Parisiens imprévoyants mais sympas.
L’histoire s’est bien terminée. Restée seule et presque nue, faisant fi des convenances, j’ai fini par ressortir décente et chargée de vêtements secs. Les enfants restés dans l’habitacle chauffé de la voiture étaient tout roses et mangeaient des gâteaux. Une fois revêtus les pantalons doublés et les vestes fourrées encore tièdes, les parisiens pas très futés mais sympas, pouvaient redescendre dans la vallée, tout heureux de leur matinée. Parce que vous savez ce qu’il en resta une fois en bas ? « Maman, c’était trop beau la balade en traîneau ! ». Et mes enfants étaient contents.
Ce qui est nécessaire – Publié le 19 avril 2020 (un mois de confinement)

Pendant près de deux heures, prise d’une impression de honte et de clandestinité, j’ai tapoté sur mon clavier ma première commande au Super U drive. La honte pour la première fois de ma vie de faire faire mes courses à des employés. La clandestinité de ne pas être bien sûre que mes achats soient de première nécessité. Je me sentais contrebandière, cliquant entre des escalopes de dinde et des saucisses sur une pochette de feutres ; entre de la lessive et du dentifrice sur des tubes de gouache et des feuilles colorées ; entre une boule de pain et une boîte de petits pois sur deux gros sachets de 500 grammes de sel fin. Consciente de l’inadéquation de ma commande avec l’attestation dans la poche arrière de mon pantalon sur laquelle j’affirmais le caractère indispensable de mes emplettes, j’arrivais stressée au point de retrait. Serais-je sermonnée ? Arrêtée ? Et dans ce cas, qu’adviendrait-il de mes enfants enfermés dans la voiture ? A l’accueil du drive, les clients comme les employés semblaient tendus. Peu importait le contenu de mes paquets, mais je devais les charger vite et filer. Je partis sans demander mon reste. Le temps d’une giclée de gel hydro-alcoolique sur les mains et j’étais déjà loin. Une fois garée devant chez moi, je confinais en hâte famille et butin. La porte de l’appartement refermée, le trésor des courses à mes pieds, je pouvais enfin soupirer, soulagée. Nous avions de quoi manger pour dix jours et les enfants criaient de joie autour des sacs épars car nous allions faire de la pâte à sel, peindre et dessiner sans manquer.
Lors de ma deuxième commande au Super U drive, je me sentais capable de tout tenter. Au milieu des patates, du PQ et de la tisane, j’osais céder à la malbouffe qui réconforte et qui pouvait donner des airs de vacances à l’enfermement. Des pains hamburgers, du ketchup et des frites surgelées sont-ils des denrées de première nécessité ? Peut-être oui, quand on est séparés de sa famille et de ses amis. Fébrile, prise d’un fol espoir, je tapais dans ma recherche en ligne de produits alimentaires : « chocolats de Pâques ». Miracle ! Je voyais apparaître des œufs, des lapins, des peluches. Je remplissais mon panier virtuel sans compter car une voix inquiète m’avait récemment demandé : « maman, tu crois qu’il a le coronavirus le lapin de Pâques ? ». Maintenant je savais que pour cette année, ni le lapin ni les cloches ne seraient confinés, et j’imaginais comme la plus grande fête, et peut-être comme ma plus grande réussite, les chocolats du Super U drive cachés sur le balcon et sous les coussins du canapé du salon. J’ajoutais encore à ma liste un stylo plume et un cahier d’école. A l’accueil du drive le personnel avait changé et je trouvais une femme souriante et détendue. Pour son sourire je l’aurais embrassée si mille raisons sociales et médicales ne s’y étaient pas opposées. La peur du virus avait rendu autour de moi tous les visages désapprobateurs et méfiants. Les passants, les voisins, les marchands. Après plus de quinze jours d’évitement, non seulement de postillons mais simplement de regards et de saluts, ce sourire franc qui accompagnait mes sacs dans lesquels pointaient quelques longues oreilles en chocolat, me remplit d’amour et de confiance.
Super U drive était devenu mon allié, peut-être à la limite de la légalité. Jusqu’où pourrais-je aller ? Lors de ma troisième commande je tentais l’impensable, tapant sur mon clavier « jouets », puis tous les mots clés qui pouvaient s’y rapporter. Au tout début des restrictions et des contrôles, un gendarme m’avait dit que je n’avais rien compris à l’esprit du confinement si je pensais que mes enfants pouvaient sortir pour s’amuser vraiment. La loi les autorisait à prendre l’air près de l’appartement, mais pas à prendre du plaisir. Assommée par cette sentence plus morale que médicale, écrasée par la dimension punitive du confinement, j’avais pleuré pendant deux jours. Quel mal y avait-il à offrir de la joie à des enfants privés de leur vie d’avant ? Le virus exigeait-il la pénitence en plus de l’isolement ? Avions-nous péché ? Sans surprise mais avec tristesse, je constatais que super Super U drive ne proposait rien en dehors de l’alimentaire, de l’hygiène et des fournitures scolaires. Je commandais donc de la brioche et le plus gros pot de nutella. L’amie souriante – encore présente – du retrait drive me donna soudain confiance. De loin, alors que j’allais charger mon coffre et décamper, je l’interpellais pour savoir si le magasin Super U dont dépendait le drive avait encore un rayon jouets et si leur achat était autorisé. Son rire, en apercevant trois têtes dans ma voiture soudain aux aguets, chassa soudain tous les mea culpa vendus avec le confinement. Non, mes enfants n’étaient pas tenus – pour combattre le virus – d’expier au pain sec sans autre distraction que les devoirs donnés par leurs cyberprofs sur Internet.
Au lieu de foncer chez moi, poussée par l’espoir soudain bruyant de mes enfants, je décidai donc d’entrer dans le vrai supermarché, celui de toutes les mises en garde et de toutes les contaminations. Je laissais sur le parking au soleil, ma voiture pleine de surgelés et d’enfants prêts à fondre et à se déshydrater. Étais-je folle ? Irresponsable ? Terroriste ? Ma chasse au rayon jouets fut rapide. Les muscles raides, pressée, inquiète, furtive, je jetais dans mes cabas, sans regarder les prix ni comparer, des boîtes de Legos, des coffrets Playmobils, des livres, des albums de coloriages et d’autocollants, un ballon et trois pistolets à eau. En hâte je déposais ensuite au-dessus des sacs, un camouflage fait d’un filet de patates, d’un paquet de pâtes et de pain de mie.
Dans la queue pour payer, un homme qui passait devant moi me fit un clin d’œil complice et me montra gaiement qu’il s’approchait mais qu’il respecterait la distance imposée. La caissière, enregistrant mes futiles achats, ne me regarda pas de travers. Au-dessus de son masque, ses yeux se plissèrent même d’un sourire. Vite sortie et courant vers la voiture, je me sentis riche. Doublement. Riche, pour mes enfants, d’un Noël surprise au mois d’avril. Et riche, pour moi, d’une petite réserve de visages ouverts, de regards solidaires, et d’une humanité que j’avais cru disparus.
L’emploi du temps – Publié le 03 mai 2020 (confinement)

Mon réveil sonne à 9h30. Les premiers jours je l’avais réglé à 7h30. Si j’ai consenti à un décalage de deux heures de notre vie, je n’en ai pas pour autant renoncé à l’emploi du temps.
Volets et fenêtres tremblent sous l’effet des rafales de vent. Il a plu toute la nuit. Trois têtes endormies sortent à peine de la couette. Je goûte un instant cette paix de les voir si près sans qu’ils se battent. Les querelles de la journée précédente ont fondu dans une recherche inconsciente de chaleur et de sécurité. Au réveil, la guerre reprendra.
Je passe de l’un à l’autre, secouant, embrassant, chatouillant, interpelant. A peine quelques grognements. J’ouvre de deux ou trois raies le volet roulant pour laisser entrer, en lignes pointillées, un jour gris. Aussitôt des protestations sortent d’un corps qui vient de s’enfoncer plus profondément : « fait pas beau ; on reste au lit ».
Quelle importance, en confinement, ont la pluie et le beau temps ? Se recoucher est tentant. Mais il y a la dictée, l’exercice sur l’imparfait, le devoir d’anglais, les tables de multiplication et le périmètre du cercle, la musique, la cuisine, et même le film qu’on se projetait de voir après le déjeuner dans notre tour exhaustif et culturel de l’œuvre de Louis de Funès. Les minutes filent sans qu’aucune mèche de cheveux sur les oreillers ne s’agite. Mon programme de la journée est menacé.
Le 13 mars 2019 j’étais placée en arrêt maladie pour ne plus retourner au lycée. Le 17 mars 2020 débutait le confinement. Mars est un mois de poisse. Mais aucun de ces mois de mars ne m’a retenue une journée au lit. Non plus qu’une journée à grignoter devant la télé. Depuis plus d’un an je fais semblant. Chaque jour doit apporter un progrès. Chaque jour a son emploi du temps. Quel sens de se coucher quand rien n’a avancé ? Ni un texte, ni une ligne, ni un peu de ménage ou de repassage, ni un projet qu’il soit ménager, éducatif, artistique ou économique ?
En ces temps de confinement, il est interdit de perdre la notion du temps. D’abord parce qu’il faut écrire le bon jour et la bonne date sur l’attestation quotidienne de sortie d’une heure autour de l’immeuble. Chaque jour, j’hésite et je me pose la question : combien d’amendes ont été payées pour s’être emmêlé dans le calendrier ?
Chaque jour je me demande s’il est vraiment indispensable d’écrire le titre du chapitre de français en bleu sur une feuille mobile rose grand format à grands carreaux et de le souligner à la règle en vert, sachant qu’en zone rouge le collège ne rouvrira sans doute pas. Chaque jour je me demande s’il faut vraiment se battre pour apprendre la poésie de Rimbaud qui décrit une promenade estivale en plein champ quand aucun maître ne la fera réciter et quand depuis des semaines on ne voit que les murs de l’appartement. Tous les profs s’évertuent à nous envoyer des devoirs sur la nature, les parcs et le printemps. La maîtresse de petite section a lancé un projet sur l’océan. Pour qu’on ne les oublie pas ? Pour qu’on sache que, même volets fermés, la verdure et la vie sont encore là ?
Je n’y crois pas vraiment, mais je fais semblant. A moins qu’il me soit indispensable d’y croire un peu. Il faut garder le rythme, maintenir le cap. Se lever, manger à heure fixe. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi la multiplication s’affirme jusqu’à poser des divisions, les verbes se conjuguent en CE2 à côté des boucles de ℓ et d’écailles de poisson au crayon de couleur en maternelle. Les dieux de la mythologie grecque et romaine se bousculent en 6ème. On souligne la date en rouge chaque matin, et je range chaque soir dans le dossier « travail fait » le fichier envoyé par le professeur chaque jour officiellement ouvré. Le mercredi c’est dessin et pâtisserie. A quatre autour d’une table qui sera, quelques heures plus tard couverte de farine et de chocolat, on répond avec nos feutres au thème hebdomadaire proposé à distance par la prof d’art, privée de ses élèves, de son association et de son gagne pain. Mercredi on enregistre aussi une vidéo pour la prof de flûte qui joue le jeu, et samedi une vidéo pour le prof de violon qui semble noyé, écrasé sous l’inactivité. Je ne sais toujours pas s’il est vital de ne pas jouer en croches le passage en noires de la chanson des sept nains qui, eux, rentrent du boulot puisqu’à la mine tout télétravail est impossible, pas plus que je ne connais l’importance de savoir rythmer une syncope dans Kalinka*, mais peu importe. Je frappe la pulsation après chaque goûter avec conviction.
La machine à laver tourne. La javel gagne du terrain. Chaque douche est une victoire. Le mercredi et le dimanche on se lave les cheveux et on change les pyjamas. Le mardi on fait les courses pour la semaine. J’essaie de rapporter un livre ou un jouet : c’est jour de fête, vite oublié. La télé, jamais regardée à l’ordinaire s’est invitée dans notre quotidien et rythme certains de nos choix. Le mercredi on dîne équilibré et coloré devant Top chef. Le samedi, toasts, chips et mayo : c’est « l’apéro-Columbo ». Dimanche on se repose, on s’isole dans son livre ou dans son jeu : une bulle de quelques décimètres carrés.
Il faut y croire, ou le faire croire : l’école continue, les jours sont différents. Et pourtant… Pourtant au bout de sept semaines la monotonie de cette variété forcée fendille les apparences. Les tâches et les projets sont toujours là, mais le sens s’enfuit : il se sera bientôt barré, en vélo et sans attestation de déplacement dérogatoire, à plus d’un kilomètre de notre domicile. Il faut le rattraper, l’amender et lui donner l’ordre ferme de rentrer. Une nécessité avant de pourvoir, enfin, l’imiter.
*Air russe
La distance – Publié le 11 mai 2020 (confinement)
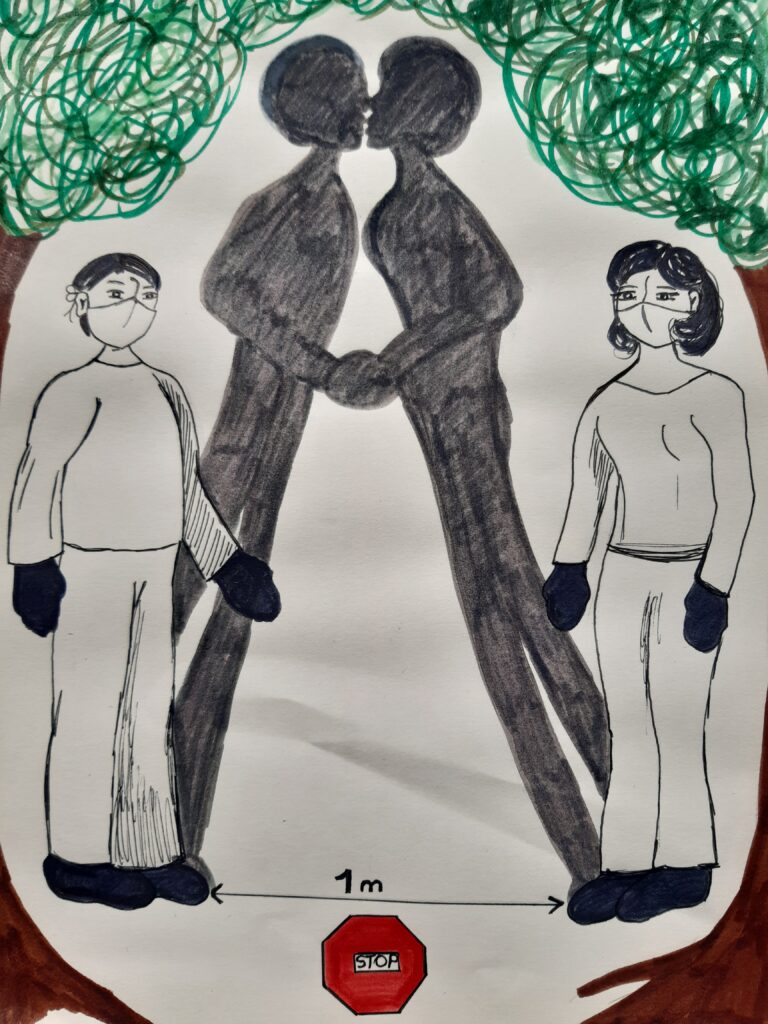
Le confinement s’achève sans trop qu’on sache ce qui change et ce qui restera. La distance restera. La bise ne sera-t-elle plus qu’un mot d’usage à la fin des SMS ? A Nantes on en faisait quatre. A Paris, deux. Dois-je donc perdre deux bises tous les vingt ans ?
Nous devrons conserver l’habitude hygiénique de la distanciation sociale. A force d’en augmenter le rayon, mon cercle s’est encore rétréci. Au cours d’un an d’arrêt maladie longue durée, je n’étais plus guère sortie de mon quartier. Au cours des huit dernières semaines mes relations se sont encore resserrées sur les seules personnes passant sous mon balcon. Des promeneurs de chiens, sans doute croisés avant mais jamais remarqués. Des promeneurs de téléphones. De vieux promeneurs. Des promeneurs aux horaires fixes sous des temps variables. En marcel ou en capuches, aux regards d’abord inquiets, puis curieux, qui se levaient peut-être pour voir la femme sur laquelle leur clébard aboyait. J’aime peu les chiens, mais de solitude j’ai demandé le nom de ceux qui me saluaient ou qui m’engueulaient sous ma fenêtre. Les regards sont devenus sourires, signes de la main, puis conversations. On a crié un peu. C’est loin. On s’est braillé de haut en bas sa vie, sa profession, ses occupations. Une confiance s’est établie sans qu’on ne se soit jamais vus de près. Myope, je reconnais les allures sans distinguer les visages. Un matin une opinion politique a fusé, puis un tutoiement qui m’a surprise et qui est resté.
L’école à distance continuera. Faute de matériel performant en quantité suffisante pour chaque membre de la famille, faute d’espace également, elle nous rassemble assez souvent autour des mêmes activités et du même écran. La classe virtuelle de yoga proposée par la prof de sport de ma Grande est suivie par toute la maisonnée. C’est ainsi qu’il m’arrive de saluer d’un pied en chandelle ou de mains jointes en bougie, le matin, mes voisins déambulant et leurs chiens. Les vidéos du cours d’histoire de 6ème sur Pompéi attirent le Moyen, tandis que le travail de CE2 offrant de réaliser un dessin à la manière de Miró, séduit la Grande et le Petit. Quant à la méduse de petite section de maternelle en chutes de papiers colorés collées, elle fait l’unanimité. Dans ces moments je voudrais sanctifier les profs dont les cours généreux s’exportent, hors des murs, hors des âges et de la classe, à tous les habitants de notre foyer. Un foyer dont le sens, curieusement, semble, autour de la lumière d’Internet, avoir été restauré.
D’autres enseignants ont vu dans la distance un embellisseur d’adolescents. Ils ont idéalisé leurs élèves-charmants confinés au loin. Persuadés que les enfants s’ennuient sans devoirs, et que ce ne sont ni les copains ni l’air, mais la grammaire qui leur manque, ils se déchaînent tous les lundis matins en avalanches de bons sentiments pédagogiques et de documents téléchargeables en trois formats – word, odt, pdf. Forte d’une vie passée à l’école, je m’y perds pourtant, et je panique, incapable de suivre, et de faire suivre à ma jeune collégienne de fille le rythme effréné des cours et des exercices à télécharger. Et je me répète inlassablement : « Mais comment font les autres parents ? »
La sainte distance nous rapproche et, avec le maintien en zone rouge de la fermeture des promenades et des parcs, continuera à nous rapprocher pour des après-midi entiers dans la pièce la plus ensoleillée. Ignorant derrière moi le tapis de jeu, j’essaie de travailler. Tandis que je m’applique à faire mieux connaissance avec les participes passés, des accidents, des embouteillages et des histoires d’amour entre coccinelles et deux-chevaux vrombissent dans mon dos. Je lis le chapitre sur les verbes pronominaux. La volkswagen s’est égratignÉE en passant trop près d’un camion, tandis que la citroën s’est juste éraflÉ une portière en voulant lui prêter assistance. J’essaie de me concentrer : que faire avec en ? Ma cuisse me fait mal. En plus du bruit, ma position me gêne. J’ai pris du poids ces dernières semaines, mes jambes peinent à me porter et j’ai un nerf de coincé. C’est que nous avons fait des tartes et que j’EN ai mangÉ trop ! Il faut dire que j’ai voulu essayer un nouveau four, et les pâtisseries que j’EN ai sortiES étaient délicieuses. Des vaisseaux spatiaux en Lego se sont invitÉS bruyamment au-dessus de la course automobile. Pas facile de comprendre ce qu’il faut faire avec le verbe avoir suivi d’un infinitif. La Grande hurle à ses frères de la fermer : elle ne peut plus lire tranquille ses histoires de dragons ni répondre aux messages de ses copines qui font triling triling. Je m’apprête à intervenir : l’adolescente que j’ai vuE s’énerver et les hurlements sauvages que je lui ai vU pousser pourraient bien dégénérer en combat peu distancié.
Le principe de distanciation nous a fait vivre huit semaines à huis clos. Plus qu’à la Peste de Camus, c’est à Sartre que j’ai pensé. Pour l’instant je ne déplore qu’une lèvre mordue et un œil au beurre noir. Plus de savoir si ce confinement est vraiment terminé ou s’il repointera le bout de son nez, je suis curieuse de connaître le souvenir qu’il nous laissera. Celui d’un enfer familial criard qui nous interdisait de respirer ? Ou celui des devoirs scolaires partagés, des films tous serrés sur le canapé, des jeux, des tartes, des frites et des nuits calmes ou de tempête passées volontairement entassés dans une seule pièce ? En sortirons-nous plus proches ou plus distants, pour longtemps ?
Déconfinement – Publié le 01 juin 2020 (confinement)

Toutes les fois que pendant le confinement j’écrivais le mot « déconfinement » dans un SMS, la saisie automatique de mon téléphone corrigeait ce mot, qui aurait dû vibrer d’espoir, en « déconfiture ».
La déconfiture est arrivée, et par ce merveilleux week-end ensoleillé, les parcs ont enfin rouvert.
En ce beau matin, juin est là qu’on avait quitté en mars. Pendant deux mois et demi mon vieux jogging de toutes les saisons était sans honte le vieux jogging de toutes mes sorties, réduites à la quête hebdomadaire de nourriture. Le trajet était court, les regards échangés rares, et le chargement des victuailles, pressé, se faisait tête baissée.
Avec l’ouverture du parc sous ma fenêtre, je réalise que mon vieux jogging est déformé par les nombreux lavages, et taché de blanc par la javel antivirale de tous les lessivages des sacs, des emballages, des téléphones et des sols. Les pantalons des enfants sont devenus trop courts sans toutefois pouvoir passer pour des shorts. Les T-shirts à manches courtes de l’été dernier sont maculés de traces anciennes des feutres et du jus de fruit des bricolages et des goûters passés.
Je trouve pour moi un ample pantalon froissé au fond de l’armoire. Depuis plus de deux saisons il était tombé de son cintre, et gisait là, tout chiffonné. Impossible de porter ce truc avec des bottines ou des baskets. En fouillant bien je découvre une paire de nus pieds que j’avais oubliée. Dans la glace le résultat est affligeant : j’ai grossi. Le large pantalon, s’il me va toujours, me donne l’allure d’une barrique.
Heureusement le déconfinement et le beau temps referont de nous tous des athlètes de la course en rond dans les parcs, du vélo sans limite de kilomètres, et dans peu de jours, des salles de sport avec leurs machines qui pueront toujours la sueur, mais qu’on se rassure : une sueur désinfectée.
Je n’aime pas le sport. Ni en rond, ni en ligne, ni sur place. Et surtout pas en intérieur dans les odeurs de javel et de sueur.
J’étais déjà trop grosse avant, mais en dix ans et trois enfants, j’avais la fierté de ne pas avoir pris le moindre kilo. En deux mois seulement de super ménagère, de femme au foyer à l’hyper sédentarité forcée, me voici ronde comme un tonneau. Quant au remède présenté comme une libération ludique – le sport – il est pour moi la pire des punitions. La saisie automatique de mon téléphone avait donc raison.
La vie normale reprend. Les cris des enfants et la sonnerie du manège du parc montent jusqu’à mon balcon. On pourra bientôt absorber des verres de calories mousseuses en terrasse, qu’on exorcisera en exercices cardio au son d’une musique électro. On nous le dit : soyez prudents, portez un masque et retrouvez vos activités d’avant.
Et si moi je ne faisais des abdominaux qu’en soufflant dans mon sac à tuyaux ? Le sac à tuyaux – littéralement bagpipe – le biniou, la cornemuse, le truc marrant qui ressemble à un mouton sans tête qui aurait paré de pompons ses pattes irrégulières. Va jouer du biniou dans ton appartement en confinement ! Va sortir ta cornemuse – désaccordée par l’abandon et le changement de saison – au parc en déconfinement !
Peut-on considérer cette pratique étrange comme un sport, aussi légitime – même si plus bruyante – que la course à pied ? La fatigue, le mal au bide et les courbatures aux bras qui en résultent pourraient faire penser que oui. Le premier ministre n’en a pas parlé. La salle – isolée – prêtée au cornemuseux* depuis trente ans par ma ville est toujours fermée. Depuis le 15 mars je n’ai pu jouer que du canard. Du canard du parc ? Non, du canard de cornemuse : de cette flûte qu’on appelle practice et qui n’est plus qu’un biniou sans ventre ni pattes. Un os à ronger, quoi. Un assemblage de deux tuyaux : du suttel – le tuyau par où l’on souffle – au chanter – le tuyau par qui ça hurle – qui cancane des airs étouffés, plus faux que mille appeaux.
Vous jouez de quoi m’avait demandé une voisine ? Du piano pourquoi ? Parce qu’on entend un bruit bizarre parfois ? Ah oui ? Moi connais pas. Personne n’a idée du son du canard dont l’anonymat, confiné, est ainsi préservé.
Mais le biniou et mes abdos ? J’en demande trop. Je pourrais faire du vélo. Ou cacher mes kilos dans mon falzar à fleurs jaunes trop large, et mon visage dans mon masque cousu dans un drap d’enfant imprimé de cœurs et de nœuds bleus. Bien malin qui pourra reconnaître ainsi la barrique qui se promène au parc.
*En vrai on dit « sonneurs de cornemuse »
Pédaler pour manger – Publié le 11 juillet 2020
J’attendais avec impatience ce moment d’aller à mon cours de piano. Parce que j’ai bien travaillé ? Parce que c’est un moment d’art et de détente ? Non, parce que j’attendais d’avoir l’occasion de MARCHER.
Aller à mon cours de piano signifie passer sous le périphérique à pied, et marcher, aller-retour, deux heures, soit une dépense de 510 kilocalories. De quoi avoir le droit de manger.
Pendant les semaines de confinement, j’avais accepté que je ne serais pas Wonder Woman. Gérer l’enfermement, le stress, les devoirs et l’ennui de trois enfants tout en gardant la tête à l’endroit, prise entre mes anti-dépresseurs et les vidéo-consultations avec la psychiatre, me semblait un défi suffisant. Impossible d’ajouter à cela l’horrible contrainte de garder la ligne. Non mais oh !!! En pleine reconstruction psychologique dans un trois pièces avec trois mômes H24, qui regardaient la télé sur mes genoux et dormaient tous dans mon lit, fallait pas me demander en plus d’être belle.
L’après est arrivé, avec ses changements qui sonnent comme un retour au passé : un nouveau poste en lycée à la rentrée et l’impossibilité de retourner bosser avec mes vieilles frusques distendues de femme qui se croyait au foyer. Ai-je envie d’une nouvelle garde-robe de working-girl en 48 ?
Des copines m’ont conseillé de confier à mon téléphone mes fesses et ma santé. Me voici donc esclave de mon portable qui m’autorise, dans un programme personnalisé, 1519 kilocalories par jour. Une misère quand on sait qu’un yaourt aux fruits en vaut déjà 125 et un morceau de baguette, tout sec sans beurre ni fromage, 114.
Vingt minutes d’essoufflement sur mon vélo d’appartement font 7 kilomètres et 125 kilocalories. Qui a envie de pédaler pour éliminer un yaourt ? Mais quand on crève la dalle avec 1519 malheureuses kilocalories, on est prête à suer du sang pour gagner le droit à un bonus, même s’il est aussi tristement sobre qu’un yaourt.
Mon téléphone portable m’envoie des messages pour m’encourager à manger léger et à boire de l’eau. Il me félicite. Toute la journée il me bipe : « Vous avez oublié de rentrer votre déjeuner ! ». Mais non connard, juste je suis en retard. Je me bats avec des haricots verts à équeuter et des carottes Vichy qui sont vachement plus longues à cuisiner que des spaguettis. Il faut déjeuner à l’heure pour être mince ?
Heureusement mon téléphone portable est gentil quand il transforme en « droit à la bouffe » les calories que je dépense en exercices physique, et qu’il les rajoute à ma maigre ration journalière. Si je veux manger, je dois pédaler. Une demi-heure pour un quart de camembert. Huit minutes pour un petit beurre LU. Ou marcher. Mon téléphone portable me propose aussi d’abattre des arbres ou de danser le flamenco, mais c’est hors de propos.
Marcher pour aller à mon cours de piano me fait miroiter le fol espoir d’un morceau de pain frais avec du comté au dîner.
De l’autre côté du périph, j’avance d’un bon pas dans la longue avenue commerçante au bout de laquelle Bach m’attend. Les terrasses colonisent les trottoirs. On y boit des bières servies avec des cacahuètes. Les odeurs de frites me montent aux narines. Aussi des odeurs d’épices. Les traiteurs asiatiques parfument la rue. Peut-on aspirer des lipides et des glucides par le nez ? Un masque anti-covid en protège-t-il ? Aux tables que je frôle presque, on mange des kebabs qui affichent 1000 kilocalories soit trois heures de pédalage au compteur. Dans les brasseries et dans les restaurants turcs on se moque des calories. Certains hommes oisifs attablés laissent traîner leurs regards sur les grosses passantes quadragénaires qui peuvent, malgré leurs bourrelets, encore leur plaire. Les étals de fruits et légumes débordent sur la chaussée. Ça sent la fraise et le melon. Les pâtissiers se sont faits glaciers. Je voudrais une meringue sur un sorbet à la framboise. Ou un gâteau oriental tout collé de miel.
Deux heures de marche, l’escalier du prof à monter et une heure de Bach avec tous les petits muscles que sa toccata agite. Ce soir j’aurai gagné une coupe de glace.
Mais demain ? Quelle activité physique faudra-t-il inventer ?
Les figurantes – Partie 2* – Publié le 14 août 2020

La promenade sur le Mont Dore est fraîche après ces derniers jours de canicule. Plus question de passer sa journée en slip, nous avons chaussé de grosses godasses et enfilé nos Kway.
Je suis assez fière d’avoir trouvé cette promenade décrite sur Internet comme étant une randonnée familiale de trois kilomètres passant devant deux cascades remarquables : celle du Rossignolet et celle du Queureuilh. Une trouvaille trop belle pour ne pas avoir été partagée par beaucoup sur la toile. Le parking au pied du sentier s’est rempli tôt de nombreux monospaces, et à dix heures nous croisons déjà les randonneurs plus matinaux sur le chemin du retour. Ils vont tous par deux : couples, enfants, rassemblement de plusieurs couples avec plusieurs paires d’enfants. Les mioches s’accrochent aux hanches des mères et aux dos des pères. Ils peinent ou en profitent, dominant depuis les épaules des adultes, les ruisseaux.
J’avance avec ma marmaille en nombre impair. Petite joueuse sur le terrain des familles nombreuses dans ma ville de petite couronne parisienne, mère très ordinaire le cul entre les familles d’origines étrangères de l’école publique du quartier et celles – aussi prolifiques – des catholiques vivant sur mon pallier, je suis ici l’anomalie statistique qui perturbe le taux de fécondité français, dernièrement calculé à 1,84 enfant en moyenne par femme en âge de procréer.
J’apprends à mes élèves que les courbes statistiques sont le plus souvent des courbes en forme de cloches qu’on appelle des gaussiennes**. Si le sommet de la cloche – représentant le cas le plus probable chez les familles – se situe à la moyenne de 1,84 enfant par femme, et si je me situe moi, sur le bord droit de la cloche à 1,16 enfant plus loin avec mes trois mioches, je dois, en toute symétrie mathématique, rencontrer mon homologue inverse sur le bord gauche de la cloche, à moins 1,16 enfant de la moyenne, soit à 0,68 enfants, c’est-à-dire pas encore tout à fait un, ou presque zéro.
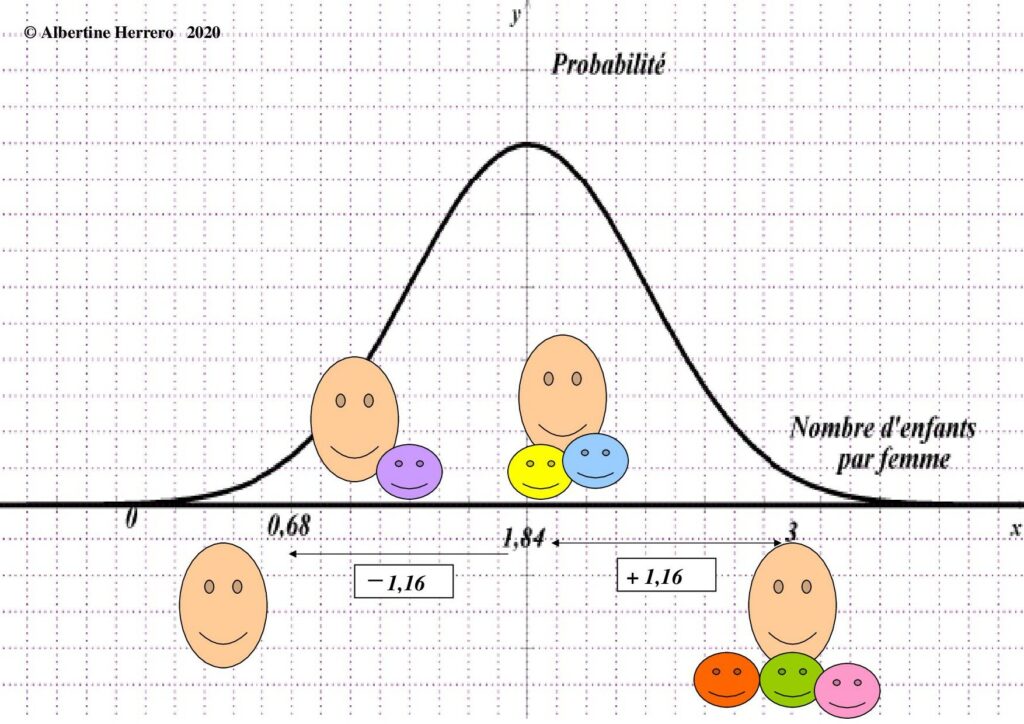
Je ne saurais vous affirmer s’il faut croire en l’Art, en l’Amour ou en Dieu, mais il faut certainement avoir foi dans les statistiques et dans les probabilités. Tout en admirant dans ces paysages les arbres buvant une Dordogne encore jeune, je décide donc de chercher des yeux ma symétrique gaussienne. En en toute logique, elle doit être là.
Nous arrivons au pied de la cascade du Queureuilh. Un petit rassemblement de marcheurs s’émerveille joyeusement de la beauté du lieu et de la fraîcheur des gouttes d’eau. On fait la queue pour prendre une photo. Les enfants s’arrosent et posent. Les parents sortent leurs téléphones portables. Certains patientent en déballant le goûter.
Notre tour semble être arrivé. Je rassemble ma troupe, prête à être photographiée devant la chevelure d’eau qui tombe de la falaise. C’est le moment que choisit mon antagoniste mathématique pour apparaître : je lui vole son tour. Ou plutôt le tour de son conjoint car elle, elle ne fait rien. Elle m’apostrophe vertement. Le ton est agressif. Le visage courroucé. La trentenaire est agacée, bien plus que si une mémère lui avait piqué sa place dans la queue au supermarché. Ce n’est pas l’attente qui la dérange. Ni le sentiment d’avoir été lésée dans sa priorité. Ce qu’elle déteste ce sont les ploucs, les blaireaux, les cons de touristes, les prolétaires, les parents qui photographient leurs enfants quand tout amateur du Beau devrait savoir que la cascade se suffit sur l’image, et qu’elle est bien plus belle, seule, que gâchée par des nains qui bouffent des BN en tâchant de miettes et de chocolat leurs doigts, leurs lèvres et leurs blousons bariolés.
Son conjoint, son mari, son ami, son amant est un artiste. Elle le sait et veut que ça se sache. Elle le promeut et le protège. Alors que je demande pardon d’un geste, reculant d’un pas, et que l’homme, contrarié mais poli, sourit, braquant sur le fameux paysage enfin vierge de connards humains, son appareil photo reflex, la femme garde un air revêche. Petites fesses, muscles serrés, petites lunettes rondes sur petit nez pointu, elle est toute en angles et toute tendue. Elle me fait face depuis un autre versant de la soumission féminine : celle, non pas comme la mienne – commune – à la famille, mais celle – noble – au génial homme-enfant dont elle s’est faite à la fois le vigile et la servante.
Je respire et ravale les mots qui pourraient briser la paix bon enfant de ce lieu. Je me retiens de lui dire, moqueuse et vulgaire : « Attends d’avoir des mômes et tu feras comme tout le monde des photos cons ». Subalterne, elle se voue à l’homme qui fait la photo. Tantôt elle montre ses crocs pour le défendre, tantôt elle le couve d’un regard fidèle et mouillé. Se croit-elle moins figurante que moi, plus en haut de l’affiche, dans cette vie de traintrain sans gloire ?
Sur le chemin du retour, deux sexagénaires s’appliquent à faire un selfie avec leurs trois chiens. Ils ont l’air heureux. Une joyeuse plénitude, un bonheur riant, s’emparent alors de moi. J’ai envie de leur dire merci.
* Ce titre fait référence aux Figurantes – Partie 1, texte que j’ai écrit en août 2018.
* Du nom du mathématicien allemand Johann Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855).
La vie réelle – Publié le 12 septembre 2020
Dans la rue du laboratoire d’analyses médicales, la queue s’allonge sur la chaussée, serpente le long de barrières mobiles, et traverse la rue pour s’étaler dans les jardins publics de la Mairie. Des vigiles baraqués régulent les priorités et le trafic dans cette marée humaine qui, si elle n’a pas encore la covid, l’aura certainement après avoir attendu quatre ou cinq heures debout dans la masse des clients potentiellement infectés du laboratoire.
Si la régulation d’un tel flux passe par la priorité aux parcours coordonnés pour se faire tester, il faudra faire la queue chez le médecin avant de la faire sur le trottoir du laboratoire.
Je passe deux fois par jour depuis la rentrée devant cette infinie file d’attente qui jamais ne semble diminuer, ni le matin, ni le midi, ni le soir.
Aujourd’hui je souffle de soulagement d’avoir fait une semaine entière de cours sans m’absenter. Y aura-t-il d’autres semaines complètes. Je m’inquiète. Mon fils de quatre ans a le nez qui coule depuis deux jours. Au matin, ses bronches encombrées par la position allongée le font tousser. On lui prend sa température : quand il se réveille, quand il joue, quand il dort. On flippe. « Si tu prends ton sirop mon chéri je t’achèterai un œuf Kinder cet après-midi ».
L’école l’acceptera-t-elle ? Les règles de la maternelle, de l’école élémentaire et du collège sont les mêmes : prendre la température de son enfant le matin, ne pas l’envoyer s’il a plus de 38, ne pas l’envoyer s’il a d’autres symptômes (la toux ?), l’amener chez le médecin, le faire tester covid, et ne l’autoriser à retourner à l’école que dûment muni d’un test négatif ou d’un certificat médical.
Mon médecin généraliste n’a pas de rendez-vous libre avant cinq jours. Depuis plus de dix ans qu’il est mon médecin, il a toujours eu des rendez-vous pour le jour même ou pour le lendemain. La petite couronne parisienne échappe aux soucis des déserts médicaux.
Le jour où l’école n’acceptera pas mon morveux d’enfant qui sera marqué du sceau de l’infamie fiévreuse, je devrai sans doute m’absenter cinq jours (sans justificatif médical puisque sans docteur disponible, et donc probablement sans salaire et sans sourire du proviseur) de mon lycée pour garder le mioche et attendre le rendez-vous chez le médecin. Celui-ci me prescrira les cinq heures de queue au laboratoire avant d’espérer trois jours plus tard un test négatif (peut-on croire aux nouveaux tests en vingt minutes ?) ou pire, positif, qui contraindra alors mon enfant à sept jours supplémentaires de quarantaine (septaine ?) et nous conduira tous, ses parents, frère et sœur, à solliciter pour cinq jours plus tard, quatre rendez-vous chez le médecin afin d’aller ensemble faire la queue au laboratoire d’analyses pour juger de la nécessité de retourner sept jours à l’isolement, pour constater peut-être ensuite que son école aura été fermée pour raison de santé.
On se croirait au Monopoly : la case « toux » vous amenant directement aux vacances de la Toussaint sans passer par la salle de classe.
Nos gouvernants ont-ils eu des enfants ? Sans nounou à domicile, précepteurs, jeunes filles au pair et autres bonnes ou personnels domestiques à tout faire, veux-je dire.
Par le hasard d’une porte d’ascenseur bloquée, je croisai hier dans l’escalier une voisine, octogénaire alerte, dont la profession avait été de dessiner des collections de mode enfantine. Toujours très au courant des dernières prises de position de la droite conservatrice, porte drapeau des bonnes pratiques et de la sécurité, elle m’expliqua entre deux paliers, comme ses vacances avaient été enrichissantes, puisqu’elles lui avaient donné l’occasion de rencontrer « des gens de la France vraiment profonde à la Baule ». Ma voisine avait appris, sidérée, que dans notre pays habitaient des gens qui n’avaient pas de boulangerie au bout de la rue ! Ni de médecins ni de labos certainement. Mais enfin, ces gens-là marchaient à côté de leurs bottes puisqu’ils devaient certainement manquer autant de la télé, et du décodeur intellectuel pour la comprendre, que de pain frais tous les matins. Elle s’était sentie la mission estivale de les éduquer. Le monde n’irait-il pas mieux si tout le monde vivait comme nous ?
Comme NOUS ? Comme Macron ? Comme une riche retraitée de petite couronne aisée ? Comme ceux qui croient que les protocoles sanitaires sont réalisables, les médecins disponibles, les laboratoires en nombre suffisants, les enfants jamais enrhumés et toutes les salles de classes équipées de fenêtres qui s’ouvrent et de distributeurs de gel hydro-alcoolique ? Faut-il me résigner ou laisser monter ma colère qui naît de la méconnaissance méprisante qu’ont les puissants de notre vie.
Détective du point mousse – Publié le 25 novembre 2020

J’essaie une recherche Internet, puis une autre. Je tente tous les inspecteurs en replay. L’inspectrice vieillissante et dépressive qui sillonne la campagne du nord de l’Angleterre. La valeur sûre du Poirot maniaque. La vieille Marple avec qui je tricote. Le Maigret qui comprend les gens gris qui vivent dans des décors sombres. Les agents fédéraux américains sans famille, heureux d’être menés au pas et d’exalter les vertus militaires. Columbo qui vous perce à jour en vous regardant de travers. L’inspecteur chef britannique pépère dont la femme planplan traîne la malédiction de s’emmêler les pattes dans un meurtre dès qu’elle sort innocemment de sa maison, pour chanter, randonner ou pour pique-niquer. Le lieutenant sexy qui pourchasse les hors la loi en talons aiguilles, une arme à la main, flanquée d’un écrivain richissime qui est devenu, sur une autre chaîne, un simple et pauvre flic, mais qui n’a rien perdu en changeant de série puisqu’il séduit tout autant les femmes, et cette fois sans Ferrari.
Les pourfendeurs de méchants à la télé sont tous fêlés. De quoi être particulièrement heureuse de ma vie de confinée, assise devant mon écran sans bouteille de whisky, libre des casseroles psychologiques, familiales et alcooliques que se trimbalent nos héros, pourtant garants de la justice et de l’équité dans les séries télé.
Des meurtres, j’en avale ainsi trois ou quatre par jour, confortablement installée. Pour accompagner mon thé. Avec mon plateau télé. En tricotant. En épluchant des marrons, en écossant des haricots, en coupant des pommes. Ça fait que les suspects s’emmêlent un peu dans les mailles, que les flics pataugent dans le cassoulet et que les cadavres se noient dans la compote. Certains meurtres manquent de sel. D’autres sont ficelés serrés comme un chou farci*. Certains m’endorment avant la fin, mais je sais que je les reverrai demain, ou l’année prochaine, en rediffusion et en replay.
Depuis septembre je suis devenue accro aux meurtriers. La faute aux bonnes résolutions post-burn out de me ménager et de faire des pauses « légume de canapé » dans tous les interstices laissés libres par les gosses et par les élèves. Pour guérir d’un syndrome de choc post-traumatique, ma psychologue m’avait conseillé de regarder des reportages animaliers plutôt que des gens appliqués à se trucider. Mais entre un cadavre de pacotille et l’image du dernier lion bouffant la dernière gazelle dans un écosystème agonisant, quel est vraiment le plus traumatisant ?
Est arrivé le deuxième confinement qui n’a rien arrangé. Qu’est-ce qu’on attend de sa journée quand on n’a plus d’amis, plus de sorties, plus de concerts, plus de vie associative, plus de café du matin avec les copains au chômage ou en horaires décalés, et plus de bière du soir avec les mères du quartier avides de ces petits moments de liberté ? Le Graal, devient quoi ? La télé.
La télé quand tu poses tes fesses.
La télé quand tes mômes, enfin au pieux, ont fini de hurler, et que tu leur as dit qu’après 21 heures tu n’étais plus leur mère.
La télé quand ton mari fait la vaisselle que tu as accumulée exprès nombreuse et très grasse quand tu préparais le dîner pour l’occuper longtemps et te donner l’occasion d’être enfin seule dans le salon.
La télé quand tu te dis que tu devrais plutôt jouer du piano ou lire un livre, mais que non, parce que t’as envie de savoir si le commissaire va gagner à la fin.
La télé dont tu regardes pour la dixième fois l’épisode 17 de la saison 12 mais où tu ne sais toujours pas ce qui va se passer parce que tu confonds avec l’épisode 33 de la saison 15.
La télé quand tu te dis que ce serait merveilleux si ton mug de tisane ne te donnait pas tant envie de faire pipi parce que t’as plus envie de te lever.
La télé quand t’as même plus l’ambition de faire croire ou de te faire croire que tes intelligente.
La télé quand la fin de l’automne t’a laissée sans marrons à peler ni pommes à compoter, et que tu te lances dans la confection de saison des chaussettes de Noël, comptant les cadavres entre deux rangs.
Et quand mon épisode sera terminé ? J’irai me coucher avec une chaussette décorée d’étoiles et de sapins à chaque pied, et je m’endormirai, un livre d’Agatha Christie tombé ouvert à mes côtés.
L’imagination des enfants – Publié le 27 janvier 2021
Il y a quelques années, l’école primaire luttait contre les écrans et s’était donné pour mission d’informer les parents. Un enfant scotché la plupart du temps devant un écran, fusse pour des jeux éducatifs, appauvrissait son imagination. Il y a quelques années, une maîtresse m’avait présenté lors d’un rendez-vous une plaquette alignant plusieurs dessins d’enfants du même âge. On y voyait des bonhommes classés du plus simpliste au plus détaillé, et la maîtresse d’expliquer que les bonhommes les moins complexes étaient ceux des enfants les plus accros aux tablettes.
Sans m’étonner, ces dessins m’avaient marquée. J’y ai repensé cet après-midi quand, rangeant le petit bureau de mon fils de cinq ans, je suis tombée sur ÇA :

À la veille d’un possible troisième confinement, et donc d’un deuxième reconfinement (comptons bien), et alors que des titres de certains sites d’actualités en ligne surenchérissent sur la probabilité d’un quatrième confinement en septembre, et pourquoi pas d’un quinzième en 2032, je m’interroge sur le contenu de la tête de mon fils de cinq ans. Sa représentation du monde sera-t-elle la même que celle de ses frères et soeurs un peu plus âgés ? Tous nous attendons la fin de cette galère, mais lui, se construit-il en mode confinement ?
Depuis mars 2020, mon moteur se nourrit de cette devise : « à chaque jour sa bonne humeur ». Chaque départ en vacances, chaque promenade en forêt, chaque sortie même au parc en bas de chez moi, sont des victoires. Deux heures de neige il y a dix jours sont devenues dans notre imagination un séjour aux sports d’hiver. Affamés de flocons nous avons fait provision de plein air, d’images d’arbres blancs, de longues courses et de jeux mouillés et bruyants. Plutôt que de stocker des pâtes, nous faisons provisions de souvenirs et de parcelles de liberté. La cueillette des pommes dans le Val d’Oise. Le pique-nique à Fontainebleau. La marche en bord de Seine. Les rollers dans l’impasse. L’heure de neige au parc départemental. L’album des cinq ans de mon plus jeune enfant se remplit de photos de sorties joyeuses et de nature, qu’on ne croirait pas au bout de la rue.
Feront-ils du sport samedi ? Iront-ils à l’école lundi ? Verront-ils leurs copains ce matin ? Chaque journée normale est un gain où je respire de voir mes enfants sortir, apprendre, avoir des amis et vivre des chamailleries. Les mois passent, la Philharmonie me rembourse mes places de concert. Pas grave : on fait de la musique de chambre au salon, et l’année avance dans des rumeurs d’espoirs ou de catastrophes. On travaille à préserver la bonne humeur. Aujourd’hui nous dessinerons, demain nous regarderons un film en nous gavant de blinis et de macarons. J’ai caché de petits trésors à la cave et dans les placards : fléchettes, livres, DVD, jeux de société. Pour plus tard. Pour quand le parc fermera. Pour quand les parents et les amis ne seront plus que des images qui crachottent sur des écrans. On essaie des recettes. On n’a pas oublié la bûche ni la galette. Bientôt on fera sauter des crêpes en serrant très fort une pièce au creux de la main pour que se réalise le vœu d’être plus riches et surtout plus jamais enfermés.
À chaque jour suffit son illusion. À chaque jour sa compensation : un nouveau petit plaisir gagné pour chaque liberté perdue. Plus de souplesse sur la télé et sur les bonbons. Plus de cadeaux sans raison. À chaque jour une consolation pour le rétrécissement de notre horizon. Et pour chaque activité, son petit cliché à épingler dans l’album photos de notre année confinée qui ne livre étonnamment que des images de verdure, de couleur et de gaité.
Mais au milieu de ces photos riches de beaux paysages et de sourires, je range le dessin de mon fils de cinq ans. Ai-je échoué à sauver les apparences ? Ai-je échoué à préserver son insouciance ? Est-il inquiet ? Angoissé ?? Malheureux ??? Non. Il vit avec les chiffons qui couvrent le visage des adultes et des enfants de plus de six ans. Il s’accommode d’une école maternelle sans sortie, ni à la ferme, ni à la campagne, ni au cinéma, ni au musée. Il ne demande plus d’aller à la Cité des sciences et n’a jamais vu de marionnettes. Il accepte un anniversaire sans fête d’anniversaire. Il supportera des vacances enfermées. À cinq ans, il connaît le mot « confinement » et construit naturellement et sans révolte son imagination dans un monde masqué et fermé.
Vacances d’hier – Publié le 24 février 2021

Quand tu es prof, tu as beaucoup de vacances. On te le dit souvent. On te fait aussi remarquer que même en période scolaire tu ne fiches pas grand chose. Avec quarante heures de cours par deux semaines, tu es, même à plein régime, un demi-actif ou un demi-fainéant. Tu as renoncé à parler de tes copies à corriger et de tes cours à préparer. C’est un tel cliché !Si tu laisses échapper devant une copine que tu es submergée de travail elle te répond invariablement : “ C’est normal avec trois enfants ! ”. Tes cent trente élèves ne comptent pas. Si on voit que tu vis chichement en médiocre fonctionnaire, on te pardonne le plus souvent. Mais si on te découvre prospère propriétaire de ton appartement, on te regarde de travers. Tu es une femme prof, épouse d’un docteur ou d’un ingénieur ? Ça passe encore. On associe bien prof avec meuf : un salaire d’appoint, une version modernisée de la femme au foyer mais livrée de série avec toutes les compétences pour superviser les devoirs des mouflets. Si par contre tu es la moitié d’un couple de profs sans pour autant pleurer misère, on déblatère.
Imagine que tu es une prof complètement vidée en vacances d’hiver. Tu t’en fous complètement que les remontées mécaniques des stations de ski soient fermées parce que tu ne vas jamais skier, et parce que là tout de suite maintenant t’as juste envie de dormir. Dormir et regarder la télé sur ton canapé. Ton besoin de tout lâcher vient du fait que tu viens de réaliser que tu es deux fois en vacances : en vacances du boulot de prof de tes élèves, et en vacances du boulot de prof de tes enfants. Parce qu’en temps normal tu ne peux pas t’en empêcher : aux heures ouvrables tu fais bosser tes élèves, et après l’école tu fais bosser tes gosses. Tout est pareil sauf qu’avec tes élèves tu ne parles que de maths, mais qu’avec tes enfants tu deviens multi-tâches et perds plus rapidement patience. Ton élève le plus buté est toujours pour toi un enfant intelligent qui finira par comprendre s’il n’est pas brusqué. Ton gosse par contre devient rapidement un abruti d’andouille s’il fait une faute en te récitant sa leçon. Sortie de ta zone de confort pour laquelle l’Éducation Nationale t’a donné le titre de prof en journée, tu dois t’improviser experte en grammaire, en physique et en anglais le soir. Et comme tu as l’habitude de tout savoir devant tes élèves, tu ne peux pas admettre ne pas tout savoir devant la chair de ta chair. Alors tu révises en douce les conjonctions de subordination et la diffraction de la lumière. Quand tu crois que tu as triomphé des devoirs de toute la fratrie parce que tu as extirpé de ta mémoire le souvenir des deux premières déclinaisons latines et que tu as réussi à inventer des phrases débiles à traduire à ta fille dans le genre : “Le maître dans le temple de la déesse aime les roses de la servante”, ton fils en CM1 t’apprend qu’il doit conjuguer pour le lendemain le verbe “choir” au futur. Bigre. Soit tu la joues pédagogie intelligente en expliquant à ton fils comment devenir autonome en cherchant la réponse dans le Becherelle posé sur l’étagère, soit tu perds toute dignité en faisant carrément semblant de le laisser réfléchir pendant qu’une envie pressante te permet d’aller regarder la réponse dans ton téléphone portable aux toilettes. “La bobinette cherra”, c’était donc ça ? En même temps, si la vieille avait tiré le verrou au lieu de nous faire chier avec son verbe choir, elle ne se serait pas fait bouffer par le loup.
Épuisée, en vacances d’hiver, ta seule aspiration n’est donc pas de voyager, de te distraire ni de te cultiver, mais simplement de laisser choir tes responsabilités et d’abandonner enfin à l’ignorance tes élèves et tes enfants. Hélas, si pour tes élèves planqués hors de portée tu ne peux rien faire, une petite voix te susurre que ce serait péché de laisser tes gosses oisifs et enfermés. Maintenant que les devoirs sont ajournés, tu commences à développer le complexe de la promenade culturelle ou de santé et tu te crois obligée de les sortir en forêt. Mens sana (nominatif) in corpore sano (ablatif). Rassemblant tes bonnes intentions, tu renonces à ton canapé et à ta série décérébrée de l’après-midi, pour coller ta famille avec gants et bonnets dans la voiture et partir à Fontainebleau randonner. Mais alors que la radio te dit que les routes de la région sont dégelées, tu te rends compte que toute la glace restante d’Île de France s’est donnée rendez-vous sur la pente de ton garage. Tu t’en fous, t’es en mission pédagogico-sportivo-écologique. Tu appuies sur l’accélérateur, ta voiture monte, s’arrête, patine, glisse et redescend. Tu avises une pelle contre la porte de garage : celle de l’homme de ménage. Tu la saisis avec rage et tu tapes sur la glace, tu fends, tu casses, tu fermes les yeux pour éviter les éclats qui giclent, coupant comme du verre. Tu racles, tu prends de l’élan, moulines de grands gestes avec la pelle et vlan. Tu insultes la couche d’eau gelée. Tu cries, ahanes à chaque coup comme une tennis woman tapant dans une balle à Rolland Garros, mais sans la jupette. Tu t’écorches la main, tu te bousilles le bras, mais tu ne sens rien parce que tu as une mission. Tu dois sortir et tu sortiras ! Et au moment où, haletante, tu poses quelques secondes ta pelle pour répandre sur le verglas trois poignées de sable sale piqué dans un seau qui traînait là, un voisin viril arrive en sauveur. Sa femme, élégamment bottée est restée sur le siège passager de sa grosse cylindrée, bloquée par ton petit monospace qui bouche l’entrée. Elle tapote, ennuyée, sur son Iphone. L’homme te montre la pelle, s’en empare, propose de t’aider, décroche sans façon quelques glaçons et t’annonce que le danger est passé, que tu peux reprendre tes mioches et ta voiture pour redémarrer. Dépossédée de ta victoire, obligée de remercier en femme en détresse celui qui n’a fait que de retirer aimablement trois flocons, tu te dis que, décidément, ce n’est pas de ta vocation à enseigner et à bien élever que viendra la gloire. Dégoûtée, fatiguée, tu rangeras demain Wonder Woman et Wonder Mother dans les cartables. tu soigneras tes écorchures et tes muscles endoloris en partageant avec tes gosses ton canapé, tes DVD idiots et de très gras et très sucrés apéros. Parce qu’en fait, pendant ces vacances d’hiver, tu as juste envie de somnoler et de bouffer dans ton canapé.