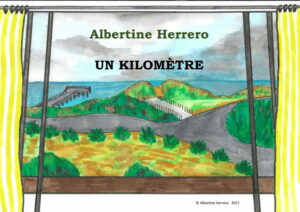
Voici la suite du roman Un kilomètre publié au rythme d’un chapitre par semaine environ. Pour le lire par ordre chronologique dans son état d’avancement actuel, vous pouvez cliquer sur l’onglet « Un kilomètre (roman) » du menu d’accueil. Merci de votre visite.
Quand le confinement devint permanent, au début du mois de mars 2023, les parents d’Armelle s’installèrent en Vendée dans une barre d’immeubles en bord de mer. Tous ceux qui l’avaient pu s’étaient déjà retranchés dans des maisons avec jardins. Les autres, qui vivaient dans un habitat collectif et qui n’avaient pas les moyens de déménager, étaient restés chez eux, profitant pour les plus chanceux de balcons qui constituaient – avec la télé, les réseaux sociaux et le supermarché une fois par semaine – leur ouverture sur le monde.
L’appartement choisi par les parents d’Armelle en bord de mer n’avait pas de terrain, ni privé ni partagé. Ils avaient pu l’acheter pour rien. Pas le moindre petit lopin dans lequel courir en rond et jouer aux boules. On ne pouvait installer ni balançoires ni chaises longues. Les vacances n’avaient plus de sens, et le grand ensemble, autrefois prospère, de résidences secondaires fut déserté faute d’offrir à ses habitants un carré de pelouse et un potager. Ce fut même la station balnéaire toute entière qui se vida des retraités aisés qui aimaient y séjourner au moins la moitié de l’année. Passer l’hiver à la mer inquiétait, mais plus encore, alors que tout le monde devait s’isoler, la peur de mourir seul sans un voisin pour s’alarmer d’un volet qui n’aurait pas été ouvert un matin, terrifiait. Les lotissements en banlieue des villes, avec leur agaçante uniformité et leurs nuisances venues de la haie mitoyenne, furent plébiscités.
La famille d’Armelle avait décidé qu’elle se suffirait à elle-même. Il faudrait partager : Armelle qui venait d’avoir treize ans dormirait dans la même chambre que ses deux jeunes frères de cinq et neuf ans. La petitesse du logement serait compensée par la fenêtre ouverte sur l’immense océan. La mère d’Armelle disait que cette fenêtre était ce qu’ils avaient de plus précieux car elle leur permettait de rester conscients de l’existence de la planète. A l’extrémité ouest de l’appartement commençait l’espace visiblement sans fin qui manquait à tous.
L’appartement, en rez-de-chaussée légèrement surélevé, construit pour accueillir avec plus d’efficacité que de charme des vagues de vacanciers, était un rectangle orienté dans sa longueur d’Est en Ouest et constitué de pièces en enfilade. A l’Est les deux chambres, la salle de bains et les toilettes se succédaient, desservies par un couloir étroit. Plein Ouest, le salon-cuisine occupait plus de la moitié du logement et donnait, par une baie vitrée, sur la terrasse. Rectangulaire elle aussi, cette terrasse n’était totalement ni dehors ni dedans. Par beau temps, située à une trentaine de mètres à peine des dunes et de la plage, elle baignait dans l’air marin. Quand il pleuvait, on la fermait par des panneaux de verre coulissants, parfois perméables aux plus fortes rafales. Elle offrait ainsi au spectateur armé de seaux et de serpillières un abri, certes humide, mais assez confortable pour observer les gouttes d’eau, la mer sombre et le ciel aux innombrables dégradés de gris.
C’est aussi accoudé à la rambarde de la terrasse qu’on pouvait accrocher des bribes de vie sociale. La plage, interdite aux baigneurs, aux promeneurs, aux chiens et aux surfeurs n’était plus foulée que par quelques travailleurs qui portaient autour du cou une petite sacoche en plastique remplie de précieuses attestations, de laissez-passer, papiers d’identité et autres documents officiels autorisant leur présence sur les lieux.
Le métier de goémonier avait fait son retour dans la région. Des hommes dans la force de l’âge chargeaient dans leurs remorques des pelletées de goémon, ces algues abandonnées par la marée. Alors que les couches moyennes et supérieures de la société se numérisaient, on avait abandonné tout projet d’automatisation de cette tâche ingrate car la main d’œuvre locale, non qualifiée et bon marché, suffisait. La récolte, ainsi effectuée en bordure du continent par des parias oubliés de la modernité, servait de matière première à la fabrication d’engrais bio. L’entreprise chimique locale prospérait. Les goémoniers passaient sous la fenêtre en compagnie d’une population, très réduite mais plus variée, de personnes des deux sexes et de tous âges qui avait sollicité des autorités le droit de vivre de la pêche à pied. Anciens commerçants, vendeurs de frites et de chichis, loueurs de vélos et de rosalies(1), marchands de glaces et de cerfs-volants : la disparition du tourisme les avait laissés sans argent. Piétaille armée de seaux, de haveneaux et de râteaux, vêtus de shorts en été et de cuissardes en hiver, ils raclaient et grattaient le sable pour survivre.
Penché par la fenêtre, Tarek le père d’Armelle hélait parfois une ancienne vendeuse de barbe à papa, pour une araignée de mer ou pour un saladier de pignons – ces petits coquillages pleins de sable qu’il fallait faire dégorger longtemps avant de les frire à l’ail. Parfois, il achetait une poignée de boucots(2) si petits qu’on les mangeait avec les pattes et la peau. Le père râlait bien un peu, maugréant qu’autrefois il serait sorti les pêcher lui-même pour rien, mais il les payait malgré tout, sans marchander, parce que leur goût d’iode au dîner serait un peu un goût de liberté, et parce que sa famille – avec son salaire unique mais régulier et l’appartement qu’elle possédait – restait privilégiée dans une région où trop de personnes s’appauvrissaient.
Sous la fenêtre passaient aussi des gendarmes. Lourdement bottés, armés, ces militaires circulaient à pied, à cheval, en voiture, à VTT et en hélicoptère. Ils se montraient plusieurs fois par jour. Ils n’attendaient pas une menace qui serait, comme au temps des guerres passées, venue du large. Le regard tourné vers l’intérieur des terres, ils surveillaient les maisons. Leur mission était de réprimer sévèrement tous les gens qui pourraient vouloir braver le confinement pour respirer le vent.
Cette époque aurait pu être l’époque de la perte du sens. Plus rien n’avait réellement d’importance. Les élèves des parents d’Armelle, bien que de plus en plus nombreux à être inscrits par le Ministère sur les listes de leurs classes virtuelles, étaient de moins en moins présents. Leurs questions se faisaient rares. Les devoirs n’étaient plus rendus.
Les professions qui demandaient d’avoir étudié des maths ne faisaient plus rêver. Plus personne n’embauchait de jeunes ingénieurs pour construire des voitures ou des fusées. On avait aussi décidé en haut lieu que les statistiques sur la maladie, l’économie, la réussite scolaire des enfants et le pourcentage d’opinions favorables au gouvernement, ne seraient plus calculées par des statisticiens mathématiciens, mais par des statisticiens politiciens. Seuls les futurs informaticiens, les codeurs et une petite élite de scientifiques – indispensables à une société automatisée en télétravail – avaient encore un intérêt à suivre des cours de maths.
Armelle aussi, parfois se demandait, à quoi ses cours servaient. Ses frères apprenaient leurs leçons sans se poser de questions. Compter vite était pour eux une fierté, et lire, la preuve qu’ils grandissaient. Mais à treize ans, Armelle ne jugeait intéressants que les métiers qui pouvaient vous autoriser à sortir : maraîchers, agriculteurs, éboueurs, livreurs, caissiers, jardiniers, goémoniers. A quoi bon les figures de style, les développements-factorisations et les études de fonctions ?
Ses parents pensaient que le choix du métier était sans lien avec la nécessité et le plaisir de se cultiver. Rien n’interdisait à un pêcheur de crevettes d’être poète, et la fenêtre ouverte sur la mer offrait chaque nuit mille raisons scintillantes de vouloir comprendre la physique et l’univers. Quatre jours par semaine étaient ainsi consacrés aux devoirs et au travail : le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. La terrasse était la salle de classe et Armelle, quand elle levait le nez de son ordinateur et de ses cahiers, apercevait le fils du goémonier, qui marchait vers la plage ou qui en revenait, accompagnant son père dans ses corvées. Quelle chance il avait !
Pour Solange, la mère d’Armelle, garder un rythme était la seule façon de garder la tête à l’endroit et le seul remède contre l’intolérable boule d’angoisse qui se formait dans son ventre et remontait à sa gorge, menaçant de l’étouffer, quand elle pensait aux années à venir. Suivre l’emploi du temps à court terme scotché sur la porte du salon était ce qui la faisait tenir, heure par heure. Respecter les horaires devenait une mission, et l’accomplissement des tâches affichées, le seul réconfort à la fin d’une journée qui, sans ce but, n’aurait pas mérité d’être vécue.
Pour différencier les jours, le mercredi était consacré à un cours en visioconférence de yoga le matin, et à plusieurs heures de dessin l’après-midi. Ostensiblement le week-end, on ne faisait rien, ou plutôt rien de prévu. Le temps passait à lire, à s’isoler au creux d’un fauteuil devenu forteresse. Tarek cherchait sur Internet des nouvelles que la situation changeait ou des indices que la Révolution couvait. Hélas le confinement était une réussite. Dix mille virus anciens et nouveaux guettaient les imprudents qui montreraient leur nez, et les portes closes déjouaient efficacement leurs plans. Le gouvernement se félicitait de la bonne santé des gens tout en agitant le spectre d’une rechute. Le monde guérissait grâce aux efforts constants. L’économie ressuscitait. Des héros émergeaient de l’enfermement : ceux qui limitaient leurs courses alimentaires en accommodant les restes, ceux qui acceptaient courageusement de laisser mourir seuls leurs vieux parents, ceux qui n’enterraient plus leurs morts et ceux qui dénonçaient les voisins de palier trop prompts à fraterniser. Il n’était pas rare que les garçons se tapent dessus, énervés par le huis clos et la promiscuité, mais le plus souvent la famille finissait par se rassembler, par se coller sur le canapé, comme pour se rassurer dans ce monde étrange où le dehors et l’autre finissaient par terrifier.
Tous les jours en fin d’après-midi on profitait de l’heure de sortie autorisée aux abords de l’immeuble : un droit imité du premier confinement et reconduit provisoirement en attendant la démocratisation à tous les foyers des équipements de réalité virtuelle qui rendraient le dehors obsolète. Le front de mer était prohibé à la promenade, mais les parkings, déserts sur l’arrière, offraient un terrain de jeu acceptable pour les ballons, les rollers et les vélos, à condition d’accepter de tourner en rond.
(1) Voiturettes à pédales à l’allure rétro, louées à l’heure aux touristes
(2) Petites crevettes grises
À suivre le 04 décembre 2021…
Pour laisser un commentaire, retournez à la page d’accueil, et cliquez sur le nom de l’article en bas de la page. N’hésitez pas : toutes vos réactions m’intéressent ! Merci.